
Par Ron Unz — Le 9 juillet 2024 — Source unz.com
 Dévoilement de la vérité sur l’assassinat de JFK
Dévoilement de la vérité sur l’assassinat de JFK
Il y a deux semaines, j’ai publié un long article sur l’assassinat de JFK, qui contient des preuves écrasantes du fait que Lyndon B. Johnson, vice-président de JFK, avait très  probablement été une figure centrale du complot.
probablement été une figure centrale du complot.
J’ai terminé ce texte en citant quelques paragraphes issus d’un article que j’avais publié plus de six années plus tôt :
… Je n’avais jamais eu le moindre intérêt envers l’histoire des États-Unis du XXème siècle. Pour commencer, il m’apparaissait que tous les faits politiques fondamentaux étaient déjà bien connus et bien relatés dans les pages de mes manuels scolaires d’histoire, ce qui ne laissait guère de place pour des recherches originales, hormis dans les coins les plus obscurs du domaine.
La politique ancienne était également souvent pleine de couleurs et d’exaltations ; on voyait des dirigeants grecs et romains si souvent déposés par des révolutions de palais, ou victimes d’assassinats, d’empoisonnements, et d’autres décès prématurés d’une nature extrêmement suspicieuse. En contraste, l’histoire politique des États-Unis était remarquablement fade et ennuyeuse, et n’était teintée d’aucun événement constitutif propre à l’épicer. Le chambardement politique le plus spectaculaire de toute ma vie avait été le départ forcé du président Richard Nixon sous la menace d’une destitution, et les causes de son départ — des abus insignifiants suivis d’une dissimulation importante — étaient tellement inconséquentes qu’elles affirmaient pleinement la force de notre démocratie étasunienne et le soin scrupuleux avec lequel nos médias gardiens du temple veillaient sur les méfaits des personnages jusqu’aux plus puissants.
Rétrospectivement, je me dis que j’aurais peut-être pu m’interroger sur le fait que les coups d’État et empoisonnements de l’époque impériale romaine furent rapportés de manière exacte à l’époque, ou si la plupart des citoyens porteurs de toges de l’époque purent rester béatement inconscients des événements malfaisants qui déterminèrent la gouvernance de leur propre société.
Au cours de la dernière décennie, ma compréhension de l’histoire des États-Unis au cours du dernier siècle a été remise en question par plusieurs révélations énormes, des découvertes explosives qui m’étaient longtemps resté dissimulées en raison de la bulle de propagande, pratiquée par les médias dominants, et dans laquelle j’avais toujours vécu.
Parmi ces révélations, l’une des plus importantes a été la véritable histoire des assassinats de membres de la famille Kennedy durant les années 1960. J’avais toujours accepté sans ciller le récit officiel selon lequel une paire de tireurs solitaires dérangés avaient tué notre président et son jeune frère. Dans le même temps, j’avais totalement ignoré les vagues affirmations de complot qui étaient relatées de temps à autre avec ridicule dans les livres et articles auxquels je faisais confiance. Aussi, j’ai été bluffé lorsque j’ai fini par découvrir que ces événements historiques extrêmement importants étaient devenus sujets d’un monde souterrain d’études solides, dont l’analyse et la reconstruction semblaient nettement plus substantielles et convaincantes que ce que les sources médiatiques auxquelles je faisais confiance avaient pu apporter.
Après avoir soigneusement digéré et analysé l’ensemble de ces nouvelles informations frappantes, j’ai fini par publier mes conclusions dans une suite d’articles au cours des six dernières années, avec notablement ces articles :
- La pravda américaine : l’assassinat de JFK, première partie – Que s’est-il passé ?
Ron Unz • The Unz Review • 18 juin 2018 • 4,800 mots - La Pravda américaine. L’assassinat de JFK – 2e partie
Ron Unz • The Unz Review • 25 juin 2018 • 8,000 mots - American Pravda: The JFK Assassination and the Covid Cover-Up
Ron Unz • The Unz Review • 19 décembre 2022 • 6,900 mots - RFK Jr. vs. I.F. Stone on the Kennedy Assassinations
Ron Unz • The Unz Review • 31 juillet 2023 • 5,100 mots - La Pravda américaine : JFK, LBJ, et une honte nationale absolue
Ron Unz • The Unz Review • 24 juin 2024 • 10,200 Words
Richard Nixon et John F. Kennedy
Découvrir la vérité sur l’assassinat de JFK avait complètement retourné ma compréhension générale de l’histoire moderne. Mais au fil des années, j’ai également découvert de nombreuses surprises d’une moindre ampleur, pas aussi édifiantes, mais qui restaient tout à fait significatives.
L’une d’entre elles, étroitement entrelacée avec le destin de Kennedy, a provoqué une réévaluation totale de ma part au sujet de Richard Nixon, l’homme que Kennedy battit de peu lors des élections présidentielles de 1960, et dont la résurrection politique ultérieure lui permit d’occuper la Maison-Blanche huit années plus tard. À certains égards, les destins ultimes des deux hommes étaient couplés entre eux, Kennedy devenant le seul président des États-Unis de l’ère moderne à mourir assassiné, cependant que Nixon fut le premier en plus d’un siècle à être confronté à une destitution, un coup légal qui provoqua sa démission, la première démission d’un président étasunien de toute notre histoire nationale.
Je savais que Kennedy et Nixon avaient été contemporains dans notre histoire politique, et le récit médiatique que j’avais tranquillement absorbé les avait toujours décrits comme des opposants absolus de par leurs traits politiques et idéologiques.
Avec sa photogénique jeune épouse Jackie, Kennedy avait conjuré l’image du Camelot étasunien au début des années 1960. À la tête de notre pays comme un couple royal, les jeunes Kennedy avaient été adorés de nos élites nationales, depuis les stars de Hollywood jusqu’aux intellectuels universitaires de premier plan. Bien que la vie de ce jeune et beau prince fût subitement achevée par la balle tirée par un assassin, ses réussites héroïques continuèrent de marquer notre conscience nationale durant les décennies qui suivirent. Il est probable qu’aucune autre figure politique étasunienne du siècle écoulé n’ait reçu un soutien aussi appuyé de la part de nos médias nationaux et de nos élites intellectuelles, et leur hagiographie a influencé l’ensemble de nos citoyens. Par exemple, bien qu’il n’ait occupé le bureau ovale que durant trois années, JFK a récemment été classé à la troisième place des présidents les plus populaires, derrière Abraham Lincoln et George Washington.
Dans le même temps, la même enquête positionnait Nixon en bas du classement, loin derrière tout autre président moderne. De fait, avant l’apparition de Donald Trump, je ne pense pas qu’un autre président ayant exercé durant le siècle passé ait été plus haï et méprisé par nos médias, un verdict sévère qui fut institué bien avant son départ piteux de la Maison-Blanche. Comme je n’étais qu’un enfant durant l’administration Nixon, j’avais absorbé ces sentiments sans jamais y réfléchir, en partie parce qu’ils avaient été répétés largement et naturellement par la plupart de mes proches et des membres de ma famille. Mais bien que je n’aie jamais étudié de près l’histoire moderne des États-Unis, j’en suis venu à m’interroger au cours des dernières années écoulées sur la raison pour laquelle cette hostilité avait été tellement répandue dans nos médias d’élite et dans nos cercles académiques.
J’avais pour impression que les principales accusations portées contre Nixon avaient été sa malhonnêteté, son caractère impitoyable en politique, et son cynisme, comme l’avait montré la tactique d’appât des Rouges qui l’avait aidé à monter sur l’échelle politique glissante. Mais en tournant et retournant ces idées intérieurement, je restais quelque peu troublé. Car ces critiques pouvaient s’appliquer de manière presque endémique à l’ensemble de notre classe politique, et je me demandais si Nixon était véritablement tellement pire que tous les autres. Après tout, on concédait en renâclant que la victoire très serrée remportée par Kennedy lors des élections présidentielles de 1960 avait impliqué d’importantes fraudes électorales dans le Texas et à Chicago, si bien que l’équilibre de la malhonnêteté et de l’impitoyabilité politique n’apparaissaient pas comme tellement exclusives à un camp.
Élu au Congrès en 1946, le début de carrière de Nixon, semblable à un météore, avait été mis à feu lorsqu’il avait été le champion des accusations « Pumpkin Papers » lancées par Whitaker Chambers contre Alger Hiss, via lesquelles l’ancien Communiste froissé accusait l’ultra respectable New Dealer d’avoir été pendant longtemps un agent soviétique. Hiss était l’un des piliers de l’establishment de la côte Est et le premier secrétaire général de la Conférence des Nations Unies, si bien qu’en dépit du fait qu’il fut reconnu coupable de parjure et mis sous les verrous, les affirmations selon lesquelles il avait été piégé restèrent une cause libérale célèbre durant des décennies, et cela explique certainement une grande partie de l’animosité durable que les médias ont entretenue à l’encontre du membre du Congrès qui provoqua sa ruine. Mais la divulgation finale des Venona Decrypts, qui s’est produite durant les années 1990, a prouvé de manière définitive que Hiss était bel et bien coupable, et a totalement justifié Nixon.
Le succès politique remporté par Nixon a inspiré le sénateur Joseph McCarthy à lancer une croisade anti-communiste suivant des lignes similaires, de manière bien souvent plus négligée et imprudente, et Nixon s’attira une animosité considérable de la part de la droite lorsqu’il critiqua indirectement McCarthy pour ses accusations à l’emporte pièce en 1954, au plus haut de la puissance et de l’influence du sénateur. Chose ironique, ce furent en réalité les Kennedy qui se firent les proches alliés politiques de McCarthy, car Robert Kennedy tint lieu d’assistant conseiller au sein de son Sous-Comité Permanent du Sénat sur les Enquêtes en 1953, après avoir été désavantagé face à Roy Cohn pour devenir le principal assistant de McCarthy.
On peut même avancer que Kennedy avait injustement appâté Nixon avec du Rouge durant leurs célèbres débats présidentiels diffusés en 1960 à la télévision. Le candidat démocrate avait été officiellement mis au courant de certains des plans secrets de l’administration Eisenhower pour renverser le régime communiste de Castro à Cuba, mais il accusa alors publiquement le vice-président Nixon de ne rien faire sur ce sujet, sachant que son opposant était obligé par serment de maintenir le silence sur ce projet, et qu’il allait donc forcément apparaître comme faible face au communisme.
Parfois, c’est l’amitié ou l’hostilité de nos médias qui déterminent si des faits controversés sont largement diffusés dans le monde entier ou simplement ignorés. À la fin des années 1930, le patriarche Joseph Kennedy avait mené d’importants efforts pour décourager la Grande-Bretagne d’entrer en guerre contre l’Allemagne nazie, et après que la guerre éclata, il fit tout son possible pour empêcher les États-Unis de rejoindre le conflit. Le célèbre livre Profiles in Courage, best-seller récompensé par le prix Pullitzer et écrit en 1956 par JFK comprenait un chapitre faisant les éloges du dirigeant républicain du Sénat Robert Taft pour avoir dénoncé fermement l’illégalité patente des Procès de Nuremberg d’après-guerre, et citait la déclaration de Taft selon qui ils « peuvent discréditer toute idée de justice en Europe pour les années à venir. » Et dans un article de 2019, j’ai noté la révélation choquante des opinions privées entretenues après guerre par Kennedy au sujet du dictateur allemand décédé.
Il y a quelques années, le journal intime de l’année 1945 d’un John F. Kennedy âgé de 28 ans, voyageant dans l’Europe d’après-guerre, fut vendu aux enchères, et le contenu révéla une fascination plutôt favorable envers Hitler. Le jeune JFK prédisait que « Hitler va émerger de la haine qui l’enveloppe pour le moment comme l’une des personnalités les plus notables ayant jamais vécu » et estimait que « Il a en lui l’étoffe dont sont faites les légendes. » Ces sentiments sont particulièrement notables pour avoir été exprimés juste après la fin d’une guerre brutale contre l’Allemagne, et en dépit du volume colossal de propagande hostile qui accompagna cette guerre.
Je soupçonne fortement que si des éléments semblables étaient apparus dans l’historique de Nixon au lieu de celui de JFK, ils auraient fait l’objet d’une attention négative de la part du grand public nettement plus importante durant des décennies.
Les médias libéraux ont ensuite fustigé Nixon pour n’avoir pas mis fin à la guerre du Vietnam après son arrivée à la Maison-Blanche en 1969. Certes, ces accusations étaient raisonnables, mais le nouveau président ne fit que poursuivre un conflit démarré et fortement escaladé sous ses prédécesseurs démocrates, Kennedy et Johnson.
Dans le même temps, la remarquable percée diplomatique pratiquée par Nixon en Chine maoïste remit complètement à zéro la scène diplomatique et établit les fondations de la détente qui allait suivre avec l’Union soviétique, qui réduisit fortement le risque d’une guerre nucléaire mondiale. Les racines idéologiques personnelles du professeur Jeffrey Sachs ne sont sans doute pas si différentes des miennes, et au cours d’une interview récente, il a évoqué l’idée que bien qu’il ait grandi en méprisant Nixon et les politiques de celui-ci, l’homme avait été l’un de nos rares présidents d’après-guerre à avoir repoussé fortement l’aiguille de la célèbre horloge de la fin du monde, maintenue par nos libéraux du Bulletin of Atomic Scientists. Réduire fortement le risque de destruction thermonucléaire ne constitue pas une réalisation des plus évidentes, et on devrait certainement attendre des progressistes bien pensants qui dominent les mondes médiatique et académique, et pourtant Nixon n’a reçu pour cela qu’assez peu d’éloges.
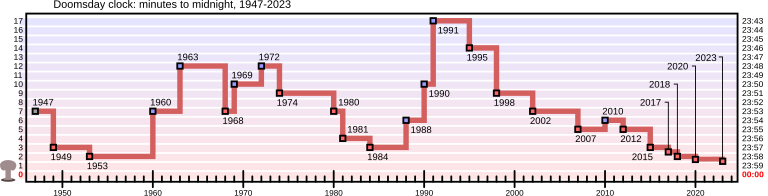 Les conservateurs ont fait la gloire de la victoire des États-Unis à la fin de la longue Guerre Froide, et ils honorent pour cela le président Ronald Reagan, et la plupart d’entre eux méprisent profondément Nixon tout autant que leurs homologues libéraux. Pourtant, sans la réussite remportée par Nixon dans l’enrôlement de la Chine communiste au rang de quasi allié dans la Guerre Froide, les politiques qu’a suivi Reagan auraient été impossibles. De fait, nos conservateurs à forte tête avaient toujours détesté la Chine, si bien qu’ils considéraient souvent le remarquable pari géostratégique posé par Reagan comme l’une des choses les pires à lui reprocher. Nixon était un pragmatique politique et non un idéologue conservateur, si bien que c’est assez naturellement que ceux-ci le méprisent.
Les conservateurs ont fait la gloire de la victoire des États-Unis à la fin de la longue Guerre Froide, et ils honorent pour cela le président Ronald Reagan, et la plupart d’entre eux méprisent profondément Nixon tout autant que leurs homologues libéraux. Pourtant, sans la réussite remportée par Nixon dans l’enrôlement de la Chine communiste au rang de quasi allié dans la Guerre Froide, les politiques qu’a suivi Reagan auraient été impossibles. De fait, nos conservateurs à forte tête avaient toujours détesté la Chine, si bien qu’ils considéraient souvent le remarquable pari géostratégique posé par Reagan comme l’une des choses les pires à lui reprocher. Nixon était un pragmatique politique et non un idéologue conservateur, si bien que c’est assez naturellement que ceux-ci le méprisent.
Au fil des années, certains de ces éléments éparpillés étaient venus frapper ce que je pensais connaître de Kennedy et de Nixon, et je me suis parfois demandé s’ils avaient 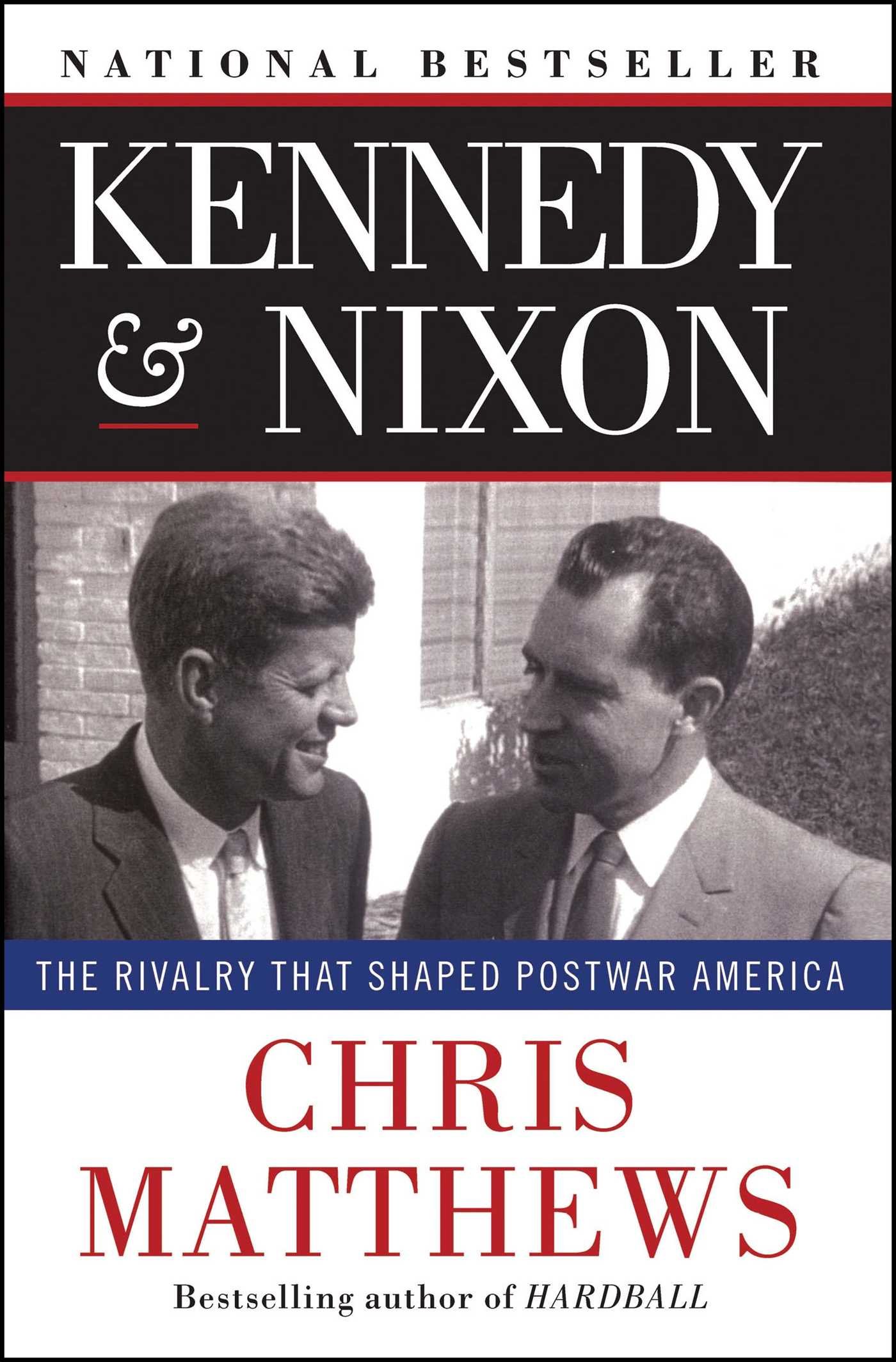 véritablement été des opposés aussi radicaux que le suggéraient nos médias. Mais je conservais cette vague impression de ces deux figures politiques de notre ère d’après-guerre, et je supposais donc qu’ils avaient toujours été de grands rivaux, ou même des ennemis politiques absolus, comme le traitement médiatique totalement différent qui leur était fait le suggérait implicitement. Pourtant, il y a une dizaine d’années, j’ai lu Kennedy & Nixon, un livre écrit par Chris Matthews, journaliste de longue date au San Francisco Chronicle qui finit par obtenir une bien plus grande visibilité nationale comme présentateur de Hardball, une émission d’interview télévisée sur MSNBC. Sa biographie politique conjointe aux deux hommes a totalement retournée ma perception, et sa relecture récente n’a fait que confirmer ce verdict.
véritablement été des opposés aussi radicaux que le suggéraient nos médias. Mais je conservais cette vague impression de ces deux figures politiques de notre ère d’après-guerre, et je supposais donc qu’ils avaient toujours été de grands rivaux, ou même des ennemis politiques absolus, comme le traitement médiatique totalement différent qui leur était fait le suggérait implicitement. Pourtant, il y a une dizaine d’années, j’ai lu Kennedy & Nixon, un livre écrit par Chris Matthews, journaliste de longue date au San Francisco Chronicle qui finit par obtenir une bien plus grande visibilité nationale comme présentateur de Hardball, une émission d’interview télévisée sur MSNBC. Sa biographie politique conjointe aux deux hommes a totalement retournée ma perception, et sa relecture récente n’a fait que confirmer ce verdict.
Matthews insiste sur l’histoire politique entrelacée de ces deux dirigeants, et dès les cinq ou six premières pages de son introduction, il présente de nombreux faits surprenants — et ironiques — à l’attention du lecteur, des éléments que je n’aurais jamais soupçonnés. Nixon et Kennedy étaient tous les deux des anciens combattants de la seconde guerre mondiale, qui avaient remporté la course pour siéger dans le premier Congrès de l’après-guerre sur un terrain trans-idéologique, et Kennedy s’était présenté comme « conservateur combattant » cependant que Nixon s’était engagé dans le « libéralisme pratique. » Les deux hommes n’étaient certes pas des amis proches, mais ils entretenaient des relations tout à fait cordiales, échangeant parfois des notes manuscrites ou se rendant des services politiques l’un à l’autre, et lorsque Nixon se présenta au Sénat en 1950 en dénonçant son opposante démocrate, la représentante Helen Gahagan Douglas, comme ayant la main légère vis-à-vis du Communisme, Kennedy contribua personnellement à sa campagne au travers d’une importante donation financière de la part de sa famille. Des années plus tard, Nixon a raconté ce qui suit lors d’une interview :
Nixon a gagné son siège au Sénat au travers d’un important bouleversement politique, alors qu’il était âgé de 37 ans. Cette victoire, combinée à sa réussite antérieure face à Hiss, persuada Eisenhower de le prendre avec lui pour l’élection présidentielle, deux années plus tard, et l’ascension politique de Nixon le positionna ainsi à un cheveu de la présidence avant même qu’il ait fêté son 40ème anniversaire, ce qui fit de lui l’un des plus jeunes vice-présidents de notre histoire nationale.
Juste derrière lui, Kennedy se hissa également au Sénat au cours de la même élection de 1952. Nixon, officier présidant le Sénat, passa les années 1950 dans un bureau situé en face de celui de Kennedy, avec qui il continua de maintenir des relations cordiales. Lorsque Kennedy dut recourir à des opérations chirurgicales dangereuses pour son dos en 1954, Nixon passa régulièrement le voir pour s’enquérir de son état de santé et il déforma quelque peu les règles parlementaires pour lui venir en aide politiquement, ce qui amena Jackie Kennedy à lui envoyer une note de remerciements personnelle : « Mon époux n’admire personne davantage que vous. » Lorsque Nixon apprit que Kennedy était proche de la mort, un agent des Services Secrets le surprit en train de pleurer : « Ce pauvre et courageux Jack va mourir. Oh mon Dieu, ne le laissez pas mourir. » Même avant les élections de 1960, Kennedy affirma à ses amis que s’il n’était pas désigné comme candidat, il allait voter pour que Nixon soit le candidat républicain, et son père, Joseph Kennedy, affirma la même chose à Nixon : « Dick, si mon garçon n’y parvient pas, je suis derrière toi. » Quatre années plus tôt, en 1956, Robert Kennedy avait voté pour réélire le duo Eisenhower-Nixon à la présidence, délaissant Adlai Stevenson, le candidat démocrate.
D’évidence, le monde de la politique implique que des conflits se produisent lorsque deux personnalités ascendantes sont membres de partis rivaux, et l’on connaît également diverses anecdotes voyant Kennedy et Nixon se critiquer et s’opposer l’un à l’autre, surtout au vu de l’intensité avec laquelle la puissante base libérale du parti démocrate se sentait repoussée par Nixon. Mais le tableau général de leur longue relation était très différent de ce que j’avais toujours été amené à penser.
Chose ironique, alors que Kennedy et Nixon semblent avoir maintenu des relations très cordiales avant les élections de 1960, leurs relations avec les autres personnalités politiques étaient parfois nettement plus tendues. Nixon et Eisenhower n’étaient pas du tout en bons termes, et Kennedy et Johnson restèrent toujours résolument hostiles l’un envers l’autre.
Les origines de ces deux personnalités politiques contrastaient autant que cela est possible : la famille de Kennedy était l’une des plus riches des États-Unis, alors que les parents de Nixon étaient propriétaires d’une petite épicerie qui connut des difficultés durant la Grande Dépression. Kennedy avait étudié au sein des établissements les plus chers et les plus élitistes avant d’entrer à Harvard, l’alma mater de son père, alors que Nixon, bien que ses capacités lui permissent d’étudier également à Harvard, ne put y entrer car sa famille ne disposait pas des ressources pour s’y transporter ni pour s’y loger : il fit ses études au Whittier College, à côté de chez lui, puis travailla pour pouvoir se payer l’école de droit de Duke. Mais au moment où ils entrèrent au Congrès, en 1946, les deux hommes n’étaient guère éloignés sur le plan idéologique ; tous deux critiquaient l’establishment du New Deal et se montraient fermement anti-communistes.
Les perceptions du public au sujet de la menace communiste connurent une forte croissance après la victoire de Mao en Chine, en 1949, qui fit basculer le pays le plus peuplé du monde dans le camp communiste, et ces préoccupations crurent encore davantage lorsque la Guerre de Corée éclata, l’année suivante ; l’armée des États-Unis subit au départ des défaites militaires sévères après l’intervention dans le conflit d’une grande armée chinoise. Nombreux étaient ceux qui pensaient que ces revers résultaient d’une subversion politique communiste au sein du gouvernement des États-Unis, si bien que le Communisme devint un sujet de premier plan dans de nombreuses courses électorales durant les années 1950.
Matthews apporte des exemples aussi fascinants qu’inattendus sur la manière donc le Communisme joua dans certaines des premières campagnes électorales menées aussi bien par Nixon que par Kennedy. Mes manuels d’histoire avaient toujours diabolisé Nixon pour avoir remporté sa campagne de 1950 au Sénat en accusant d’être Rouge son opposante, la très libérale Helen Grahagan Doublas, et en la qualifiant de « Pink Lady », mais c’est elle qui avait mis ce sujet sur la table en premier, en distribuant du matériel de campagne accusant Nixon d’avoir adopté une ligne pro-communiste en s’opposant à l’envoi d’aide en Corée.
De même, lors des élections sénatoriales de 1952, Kennedy parvint à vaincre le sortant républicain Henry Cabot Lodge, en ardent anti-communiste, en recourant à certaines insinuations malhonnêtes selon lesquelles Lodge se montrait très tolérant envers le communisme, et en l’accusant d’être un « soutien à 100% » de la « politique d’administration apaisante de Truman en Chine et en Extrême-Orient, » tout en « chevauchant » les accusations de subversion communiste lancées par McCarthy contre le département d’État. Et Kennedy défendit par la suite publiquement McCarthy en le qualifiant de « grand patriote américain ».
Ainsi, Kennedy comme Nixon insistaient sur le sujet du Communisme dans le cadre de leurs campagnes politiques de manières très semblables, ce qui n’a pas empêché mes manuels d’histoire de présenter systématiquement Nixon comme le principal pourfendeur de Rouges.
Sur les sujets idéologiques qui virent Kennedy et Nixon revêtir des positionnements très différents l’un de l’autre, les positions qu’ils adoptèrent ne sont pas toujours ceux que nous pourrions penser. Par exemple, en 1957, Kennedy fit sienne la position des Dixiecrat sur la Civil Rights Act de la même année, en espérant consolider le soutien que lui accorderaient les Démocrates du Sud pour sa participation aux élections primaires pour la présidentielle de 1960, alors que Nixon soutint cette loi sans réserve, ayant toujours été un fervent soutien des droits civils pour les Noirs.
Lorsque Martin Luther King Jr. fut mis en prison à Atlanta en 1960, le célèbre appel téléphonique de Kennedy en soutien à sa femme Coretta Scott King, juste avant les élections présidentielles, fit l’objet de débats houleux parmi les organisateurs de sa campagne, car son frère Robert y était fermement opposé, de crainte de perdre les voix des Blancs du Sud. Le budget illimité alloué à la campagne permit de résoudre ce dilemme en recrutant des dirigeants noirs pour faire les éloges des actions de Kennedy et condamner Nixon pour son silence, puis en imprimant à deux millions d’exemplaires un opuscule insistant sur ces affirmations et en le distribuant dans les églises de Noirs le dimanche précédant les élections, ce qui minimisa le risque de réactions négatives de la part des Blancs du Sud.
Matthews est un Catholique irlandais du côté de sa mère, et il était adolescent durant l’Administration Kennedy, et au début de la vingtaine lorsque RFK fut assassiné. Ses racines politiques sont profondément démocrates, et avant de commencer à travailler dans le journalisme, il a passé de nombreuses années à travailler comme aide auprès de nombreux membres démocrates du Congrès, allant jusqu’à occuper le poste de chef du personnel pour Tip O’Neill, l’orateur de la Chambre qui avait hérité du siège occupé par Kennedy. Au vu de ces origines, je suppose que Matthews a longtemps admiré voire adulé Kennedy tout en méprisant Nixon, et j’ai le sentiment que la découverte qu’il a faite des véritables positions politiques de ces deux hommes et leur relation personnelle ont dû le surprendre tout autant qu’elle m’ont moi-même surpris. Mais à son grand crédit, son livre m’est apparu comme totalement honnête sur la véracité de ces faits.
Mes manuels d’introduction et la couverture médiatique que j’avais pu absorber décrivaient toujours Nixon comme « Tricky Dick », un acteur politique impitoyable dont la longue histoire de malhonnêteté a fini par culminer dans le Watergate, alors que Kennedy était souvent décrit comme un chevalier blanc idéaliste. Et si les 400 pages du livre de Matthews sont bel et bien emplies d’une longue historique d’énormes pots-de-vin, de tricheries politiques dégoûtantes, et d’illégalité flagrante, presque toutes ces actions sordides furent commises par Kennedy dans le cadre de diverses élections et durant sa brève présidence, avec un point de départ lors de sa toute première campagne, en 1946. Bien que Joseph Kennedy dépensât sans compter une partie de son immense richesse pour faire entrer son fils au Congrès, le jeune candidat intrépide avait oublié de déposer les pétitions déclarant sa nomination dans les délais légaux impartis, si bien que lui-même ainsi qu’un complice commirent un crime grave en cambriolant en personne le siège de la législature de Boston, et en allant à cette occasion déposer lesdites pétitions dans le bureau du gouvernement qui devait les recevoir. En outre, les actions illégales menées par Nixon à partir de 1970 semblent avoir été en grande partie des réactions à d’autres actions, et pilotées par sa crainte énorme de voir le sénateur Ted Kennedy le battre pour sa réélection de 1972, en lançant le type de campagne sans pitié pour lesquelles les Kennedy s’étaient fait tristement connaître.
Matthews apparaît comme un observateur politique très avisé, et il apporte des éclairages que je n’avais jusqu’alors jamais vus. Nixon, après avoir perdu les élections présidentielles en 1960, décida de défier en 1962 le populaire gouverneur de Californie, Pat Brown, et mit en danger sa carrière politique en perdant également ces élections. Bien que les médias hostiles dépeignissent habituellement la campagne menée par Nixon comme une tentative cynique de se positionner pour se confronter de nouveau à Kennedy en 1964, Matthews explique de manière convaincante que l’intention de Nixon était l’exact opposé. Supposant que Kennedy serait imbattable dans le cadre d’une campagne visant à sa propre réélection, il avait décidé d’éviter la pression qui lui serait probablement faite pour qu’il se présentât de nouveau aux élections présidentielles de 1964 en visant le poste de gouverneur de Californie et de jurer de rester en poste durant tout son mandat s’il était élu, afin de se préparer à se présenter de nouveaux aux élections présidentielles de 1968.
Le livre de Matthews, excellent par ailleurs, ne consacre que quelques paragraphes à l’assassinat de JFK, et ce dans la ligne du récit officiel longtemps promue par nos médias dominants. L’auteur soutient l’opinion discréditée de longue date selon laquelle Lee Harvey Oswald était un tireur solitaire dérangé, un marxiste fanatique qui détestait Kennedy et qui l’aurait tué en raison de l’hostilité manifestée par le président envers le Communisme cubain. J’ai trouvé assez difficile de croire que Matthews ne serait jamais tombé sur des éléments probants indiquant le contraire durant sa longue carrière politique et médiatique, mais je peux comprendre facilement sa détermination à maintenir cette position dans son ouvrage. En tant que présentateur à succès pour la télévision, il a compris les conséquences mortelles pour sa carrière s’il en venait, ne serait-ce que dans une seule phrase, à soutenir la moindre « théorie du complot » sur le sujet de l’assassinat de Kennedy. Qui plus est, tout passage de ce type, nonobstant sa brièveté, se transformerait inévitablement en paratonnerre attirant à lui l’ensemble de l’attention de quiconque discuterait du livre, et redirigeant toute l’attention loin des éléments historiques importants qu’il a pu dévoiler. Les éditeurs dominants pouvaient se montrer réticents à publier un tel ouvrage, et il pouvait risquer de perdre tout espoir de réaliser des ventes substantielles et d’obtenir des critiques favorables dans les médias. L’approche que Matthews a choisie apparaît donc comme très raisonnable.
Accusations historiques injustes et accusations justifiées
Il y a quelques années, j’ai lu l’impressionnante histoire en quatre volumes du mouvement conservateur moderne des États-Unis, écrite par Rick Perlstein, et bien que 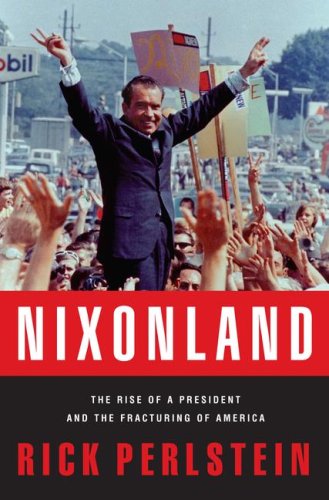 les conservateurs n’aient jamais considéré Nixon comme l’un des leurs, il est présenté comme une personnalité politique centrale par cet ouvrage, dont le second volume porte le titre Nixonland. Mais, alors que le récit produit par M. Perlstein sur 3500 pages produit une masse énorme d’éléments détaillés sur la longue carrière politique de Nixon, l’auteur semble être un historien relevant absolument de l’establishment, si bien que j’ai trouvé nettement plus d’informations intéressantes et surprenantes sur Nixon dans l’ouvrage de Matthews, bien que la taille de celui-ci n’atteigne pas le dixième de celle du livre de M. Perlstein.
les conservateurs n’aient jamais considéré Nixon comme l’un des leurs, il est présenté comme une personnalité politique centrale par cet ouvrage, dont le second volume porte le titre Nixonland. Mais, alors que le récit produit par M. Perlstein sur 3500 pages produit une masse énorme d’éléments détaillés sur la longue carrière politique de Nixon, l’auteur semble être un historien relevant absolument de l’establishment, si bien que j’ai trouvé nettement plus d’informations intéressantes et surprenantes sur Nixon dans l’ouvrage de Matthews, bien que la taille de celui-ci n’atteigne pas le dixième de celle du livre de M. Perlstein.
Nixon, Kennedy et les nombreux conservateurs qui emplissent les volumes produits par Perlstein avaient lancé leur carrière dans les premières années de l’après-guerre en dénonçant la menace de la subversion et de l’espionnage communistes aux États-Unis, mais Perlstein traite ces préoccupations comme des subterfuges politiques cyniques ou irrationnels sans grand lien avec la réalité. Pourtant, les déchiffrements du projet Venona furent déclassifiés des années avant la publication par Perlstein de son premier volume, et nombre de travaux académiques qui en ont découlé ont absolument confirmé ces affirmations politiques si joyeusement écartées par Perlstein. En 2019, j’ai décrit les circonstances étranges des élections de 1940 et critiqué fortement le refus absolu de Perlstein de reconnaître ces faits.
FDR a choisi Wallace comme vice-président pour son troisième mandat, peut-être afin d’obtenir du soutien de la part de la puissante faction pro-soviétique qui existait parmi les Démocrates. Mais il s’en est suivi, surtout au vu de la détérioration de l’état de santé de FDR au cours des quatre années qui ont suivi, qu’un personnage dont la plupart des conseillers les plus proches étaient des agents de Staline, resta en place à un cheveu de la présidence des États-Unis.
Sous la forte pression exercée par les dirigeants du parti démocrate, Wallace a été remplacé pour concourir à la convention démocrate du mois de juillet 1944, et Harry S. Truman a pris la présidence à la mort de FDR, le mois d’avril qui suivit. Mais si Wallace n’avait pas été remplacé, ou si Roosevelt était mort l’année précédente, les conséquences pour le pays auraient été colossales. Selon des affirmations postérieures aux événements, une administration Wallace aurait désigné Laurence Duggan comme secrétaire d’État, Harry Dexter White au secrétariat du Trésor, et sans doute divers autres agents ouvertement soviétiques auraient-ils occupé tous les postes clés du gouvernement fédéral des États-Unis. On pourrait s’amuser à imaginer que les Rosenberg — qui furent par la suite exécutés pour trahison — auraient pu être chargés de notre programme de développement d’armes nucléaires…
Prenons par exemple les volumes d’histoire politique écrits depuis 2001 par Rick Perlstein, et qui ont été récompensés par divers prix. Ces ouvrages retracent l’ascension du conservatisme étasunien depuis l’ère de l’avant Goldwater jusqu’à la montée de Reagan durant les années 1970. Cette suite a reçu beaucoup de louanges, méritées, pour l’énorme attention qu’elle porte aux détails, mais selon les index, le total combiné des presque 2400 pages ne contient que deux mentions fugaces totalement méprisantes de Harry Dexter White, au début du premier volume, et pas la moindre mention de Laurence Duggan, ni, chose plus choquante encore, de « Venona ». Écrire le récit du conservatisme étasunien de l’après-guerre sans s’intéresser à des éléments aussi centraux m’apparaît comme aussi sérieux que vouloir écrire l’histoire de l’implication des États-Unis dans la seconde guerre mondiale sans faire mention de Pearl Harbor.
La réalité irréfutable est qu’au cours de la décennie ayant précédé le début du récit de Perlstein, un réseau d’agents staliniens a bien failli s’emparer du contrôle du gouvernement fédéral des États-Unis. Ces faits ont été totalement ignorés par les médias dominants de l’époque, et restent tout aussi ignorés de nos jours, et Perlstein, tout comme la plupart de ses critiques, semblent parfaitement les ignorer, ou du moins prétendre ne rien en connaître. Mais les activistes conservateurs pensaient, ou soupçonnaient à tout le moins, que ces agents étaient les premiers protagonistes du récit exposé par Perlstein, et cela a sans doute contribué à expliquer leur apparente « paranoïa ».
Ainsi, Kennedy et Nixon sont entrés au Congrès en 1946, quelques années à peine après l’évitement de justesse d’une prise de contrôle staliniste du gouvernement fédéral des États-Unis. Cette réalité contribue à expliquer pourquoi les deux hommes avaient des points de vue semblables sur la grave menace de la subversion communiste dans la société étasunienne.
En outre, Perlstein, ainsi que pratiquement tous les autres historiens, ont gardé le silence sur un autre sujet important. En 1968, après que Nixon parvint enfin à la Maison-Blanche, sa présidence fut très largement dominée par la guerre du Vietnam et par les désordres intérieurs qui s’ensuivirent au sein de la société étasunienne. Il saute aux yeux que Perlstein méprise Nixon, mais de manière ironique, sa réticence extrême à remettre en cause le récit officiel l’amène à dissimuler à ses lecteurs le crime le plus honteux commis par notre 37ème président, une décision qui s’est transformée en scandale national monumental, et qui est restée ignorée durant un demi-siècle par l’ensemble de nos médias dominants.
Le nouveau président était confronté à un puissant mouvement en opposition à la guerre, qui avait déjà fait tomber son prédécesseur, et après des années de combats, rares étaient les Étasuniens qui avaient des idées claires sur les raisons de notre présence au Vietnam, nos objectifs de guerre originels s’étant évaporés. Et selon le récit fait par Perlstein, la stratégie audacieuse suivie par Nixon consistait à recentrer l’attention du public sur le triste destin subi par des centaines de prisonniers de guerre étasuniens détenus par les Vietnamiens, suggérant que le véritable objectif de notre effort de guerre continu était d’obtenir le retour des soldats capturés en menant cette guerre. Nos adversaires vietnamiens affirmaient être tout à fait disposés à nous renvoyer ces hommes dans le cadre d’un accord de paix après notre départ de leur pays, mais Nixon suggéra le contraire de manière répétée, et en matière politique, les émotions prennent souvent le pas sur le raisonnement logique, surtout lorsque ces émotions sont contrôlées par le mégaphone médiatique.
Cet ouvrage a pris fin avec l’éboulement de la réélection de Nixon en 1972, et le livre The Invisible Bridge, publié en 2014, commence par la signature de l’accord de paix. Un chapitre décrit le retour triomphal des prisonniers de guerre du Vietnam avec « Operation Homecoming, » et le plus gros d’un autre chapitre est également consacré à ce même sujet. Il est évident que Perlstein méprise complètement Nixon, ainsi que la stratégie cynique et trompeuse mise en œuvre par ce dernier pour exploiter le sujet des prisonniers de guerre et contourner ses opposants politiques, poursuivant ainsi une guerre qui auraient pu être terminée avec des accords semblables des années plus tôt, ce qui aurait épargné des dizaines de milliers de vies ; et l’auteur se délecte manifestement du glissement de son récit vers le Watergate et la chute du président qui a suivi. Mais le véritable récit des événements est sans doute nettement plus sombre et nettement plus cynique que ce que notre « Hérodote hyper-caféiné » reconnaît dans les pages de son histoire.
Comme le souligne Perlstein, à la fin de la guerre, Nixon avait réussi à définir comme objectif national dominant l’assurance du retour de tous nos prisonniers de guerre, et c’est le pays tout entier qui s’est félicité du triomphe de leur liberté retrouvé une fois que les avions les ramenant au pays commencèrent à atterrir, en 1973. Mais on dispose en réalité de preuves solides établissement que la moitié seulement des prisonniers de guerre ont été rapatriés, et que les autres ont passé le reste de leur vie dans une captivité misérable, cependant que Nixon et ses complices dissimulaient cette vérité pour revendiquer une victoire, sur fond de scandale du Watergate qui menaçant leur survie politique. Nos médias, aussi bien à l’époque qu’au cours des décennies qui ont suivi, se sont fait les complices absolus de ces mensonges, qui constituent l’un des incidents les plus honteux de toute l’histoire des États-Unis, et plutôt que de relater clairement cette histoire, Perlstein s’en tient au narratif officiel de cette dissimulation, sans jamais émettre un mot de doute, alors même que cela revient à protéger la réputation d’un président qu’il n’apprécie pas du tout.
J’ai tiré ces passages de ma longue discussion de l’histoire produite par Perlstein du mouvement conservateur, qui reconnaît l’exhaustivité des détails qu’il produit, mais note également ses omissions flagrantes.
- La pravda américaine : une histoire politique autorisée des années 1960 et 1970
Ron Unz — The Unz Review — 5 décembre 2022 — 10000 mots
Bien que ces faits au sujet des prisonniers de guerre abandonnés au Vietnam aient été discrètement connus ou soupçonnés par de nombreux dirigeants du gouvernement, ce n’est que des années plus tard qu’ils ont été documentés en détail par Sydney Schanberg, lauréat du prix Pulitzer et ancien rédacteur de haut vol pour le New York Times, qui fut l’un de nos principaux reporters de guerre durant ce conflit. J’ai discuté du sujet à de multiples occasions, et les observateurs bien informés ont dans l’ensemble trouvé que les éléments produits par les recherches phares de Schanberg étaient des plus convaincants, comme je l’ai relaté dans un article en 2016.
Je suis convaincu que ces preuves sont écrasantes pour quiconque à l’esprit ouvert, et que le silence universel de nos médias constitue le seul petit indicateur contraire. Il y a quelques mois, j’ai pris part à une commission sur les secrets du gouvernement avec Daniel Ellsberg, qui par son rôle dans la fuite des Pentagon Papers est devenu l’une des voix les plus écoutées aux États-Unis sur les dissimulations de nos secrets militaires embarrassants. Une part centrale de mon intervention était centrée sur les découvertes de Syd sur les prisonniers de guerre, et sur la manière dont le gouvernement et les médias avaient réussi à comploter afin de maintenir ce sujet dissimulé durant plus de quarante ans. Ellsberg a trouvé ces révélations tout à fait renversantes, et a exprimé n’en avoir jusqu’alors absolument jamais entendu parler, il est reparti avec des copies de l’article et de divers éléments en lien avec cette affaire. Lors de la réception et du dîner du lendemain soir, il m’a dit les avoir soigneusement passés en revue, et être absolument convaincu que tout était probablement vrai.
- American Pravda: Was Rambo Right?
Ron Unz • The American Conservative • 25 mai 2010 • 1,300 mots - John McCain and the POW Cover-Up
Sydney Schanberg • The American Conservative • 25 mai 2010 • 8,200 mots - La Pravda Américaine : L’héritage de Sydney Schanberg
Ron Unz • The Unz Review • 13 juillet 2016 • 3,500 Words
Washington : des scandales majeurs à la babiole du Watergate
John F. Kennedy est mort il y a soixante ans, après trois années passées à la Maison-Blanche, et je pense que la grande majorité des Étasuniens contemporains ne se souviennent que de trois incidents survenus durant sa courte présidence : l’échec de l’invasion de la Baie des Cochons à Cuba en 1961, la crise des missiles de Cuba en 1962, et surtout son assassinat stupéfiant à la fin de l’année 1963.
Mais la mémoire historique de Richard Nixon, mort il y a trente ans, en avril 1994, est encore plus réduite. Il a été candidat dans le cadre des élections présidentielles à cinq reprises, il a gagné quatre fois, et l’éboulement politique qui s’est produit pour sa réélection en 1972 a constitué le renversement politique le plus important de l’histoire des États-Unis. Il a été vice-président durant huit années, et président durant presque six ans, ce qui a fait de lui l’un des Républicains les plus puissants et influents durant toute une génération, et Matthews note que Murray Kempton, éditorialiste libéral de premier plan, a qualifié les années 1950 de « décennie Nixon ». Durant sa présidence, Nixon a créé l’Environmental Protection Agency, a lancé l’Affirmative Action, et a mis fin à la conscription ainsi qu’à la guerre du Vietnam. Ses ouvertures diplomatiques envers la Chine et l’Union soviétique ont transformé le paysage politique du monde, et lui ont permis de négocier les accords de contrôle sur les armements SALT et ABM, ainsi que la Convention sur les Armes Biologiques. Mais je soupçonne que de nos jours, neufs Étasuniens sur dix ne se souviennent de lui que pour le scandale du Watergate qui a mis fin à sa présidence. Ce nom a même laissé derrière lui un suffixe qui est devenu la marque habituelle de nos scandales politiques, tels le Koreagate, l’Irangate et plus récemment le Russiagate.
En 1995, Oliver Stone a embrayé après l’énorme succès de son film JFK avec une biographie de trois heures sur Nixon. Une fois de plus, ce film fut brillamment dirigé et 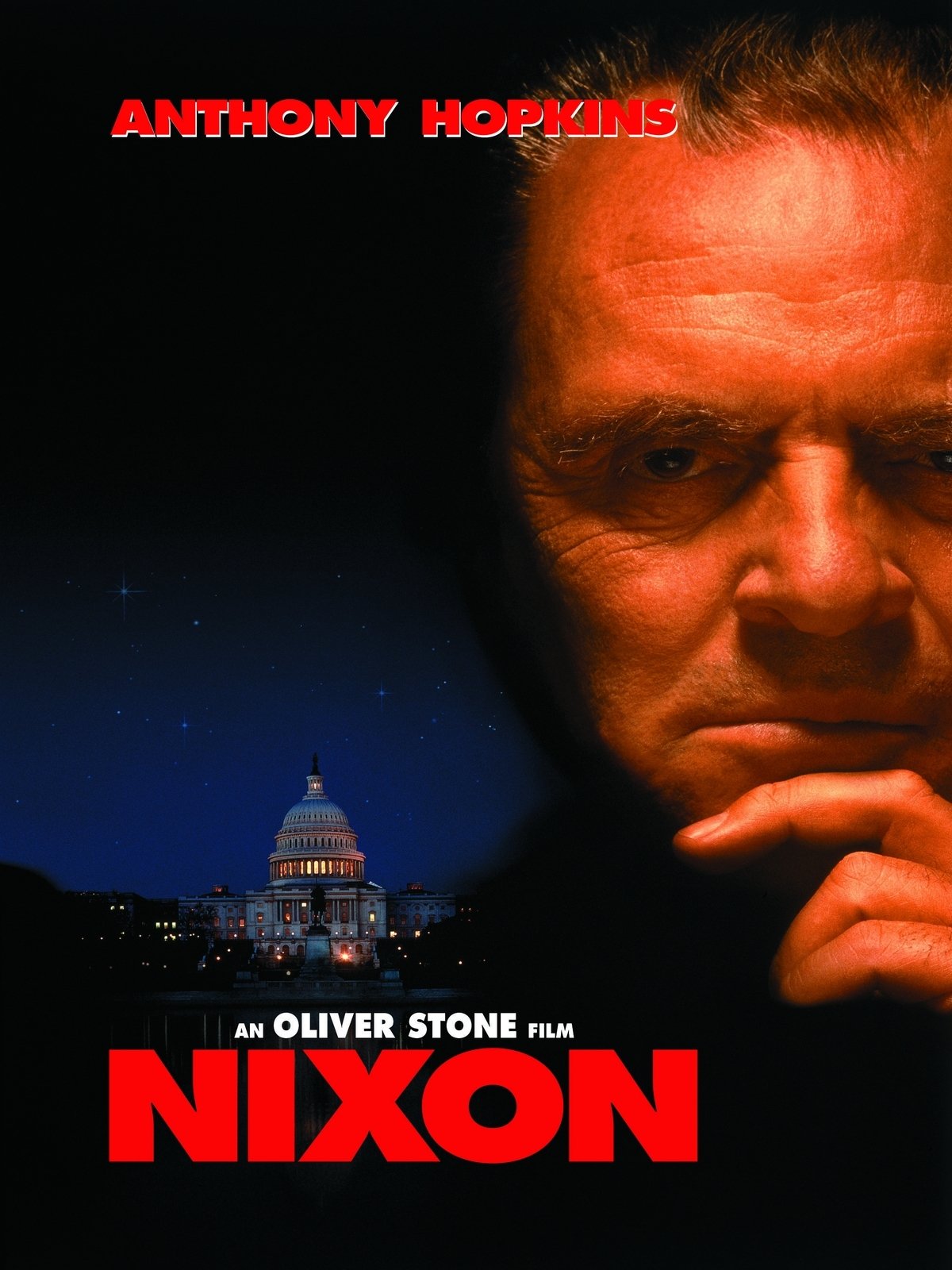 joué, et il couvre toute la vie et toute la carrière de Nixon, y compris son enfance difficile avec une mère Quaker très religieuse et le décès de deux de ses frères pour cause de maladie. L’ascension politique de Nixon et ses négociations emblématiques avec la Chine et les Soviétiques ont reçu une couverture considérable, mais le Watergate et sa chute du pouvoir dominent largement le scénario. Malheureusement, ces événements importants ne présentent pas le spectacle d’un complot culminant avec l’assassinat d’un président, et c’est peut-être pour cela que le film a eu beaucoup moins de succès dans les salles, et a même semble-t-il échoué à atteindre le seuil de rentabilité.
joué, et il couvre toute la vie et toute la carrière de Nixon, y compris son enfance difficile avec une mère Quaker très religieuse et le décès de deux de ses frères pour cause de maladie. L’ascension politique de Nixon et ses négociations emblématiques avec la Chine et les Soviétiques ont reçu une couverture considérable, mais le Watergate et sa chute du pouvoir dominent largement le scénario. Malheureusement, ces événements importants ne présentent pas le spectacle d’un complot culminant avec l’assassinat d’un président, et c’est peut-être pour cela que le film a eu beaucoup moins de succès dans les salles, et a même semble-t-il échoué à atteindre le seuil de rentabilité.
Trois années après la démission honteuse de Nixon, il s’est laissé convaincre de participer à une longue suite d’interviews télévisées avec David Frost, le présentateur  britannique, et ce sont les débats au sujet du Watergate qui ont largement dominé les négociations qui ont précédé cet accord. Ce sont les points concédés par Nixon sur ce sujet qui ont attiré l’intérêt massif du public, ce qui a débouché sur une audience de 45 millions de téléspectateurs, la plus grande audience de l’histoire pour une interview politique. Des décennies plus tard, en 2006, le récit de ces échanges est devenu une pièce de théâtre à succès connue sous le titre Frost/Nixon, bientôt suivie en 2008 par un film très apprécié du même nom, dirigé par Ron Howard.
britannique, et ce sont les débats au sujet du Watergate qui ont largement dominé les négociations qui ont précédé cet accord. Ce sont les points concédés par Nixon sur ce sujet qui ont attiré l’intérêt massif du public, ce qui a débouché sur une audience de 45 millions de téléspectateurs, la plus grande audience de l’histoire pour une interview politique. Des décennies plus tard, en 2006, le récit de ces échanges est devenu une pièce de théâtre à succès connue sous le titre Frost/Nixon, bientôt suivie en 2008 par un film très apprécié du même nom, dirigé par Ron Howard.
Le scandale du Watergate et les auditions télévisions du Sénat qui l’ont fait éclater au grand jour ont constitué les premiers événements politiques intérieurs que j’aie suivi de près durant mon enfance. Malgré mon jeune âge, j’avais remarqué qu’aucune de ces accusations n’apparaissait très grave en comparaison avec les tirs d’arme à feu et les complots mortels tellement courants dans les films d’espionnage et les thrillers qui passaient à la télévision et que je voyais de temps en temps. Mais comme tous les commentateurs décrivaient les crimes supposés de l’Administration Nixon comme sans précédent, et constituant une grave menace pour nos libertés constitutionnelles, j’avais à l’époque fini par acquiescer et décidé que cela devait être vrai. Apparemment, le système politique des États-Unis était tellement fade et sans tâche que même ces tous petits écarts pratiqués par les hommes de main de Nixon et ses tentatives furtives de les dissimuler représentaient une souillure indélébile pour notre honneur national.
Je n’ai lu aucun livre traitant du Watergate, mais j’ai vu le film primé aux Oscars de 1974 Les Hommes du Président avec Robert Redford et Dustin Hoffman, qui institua 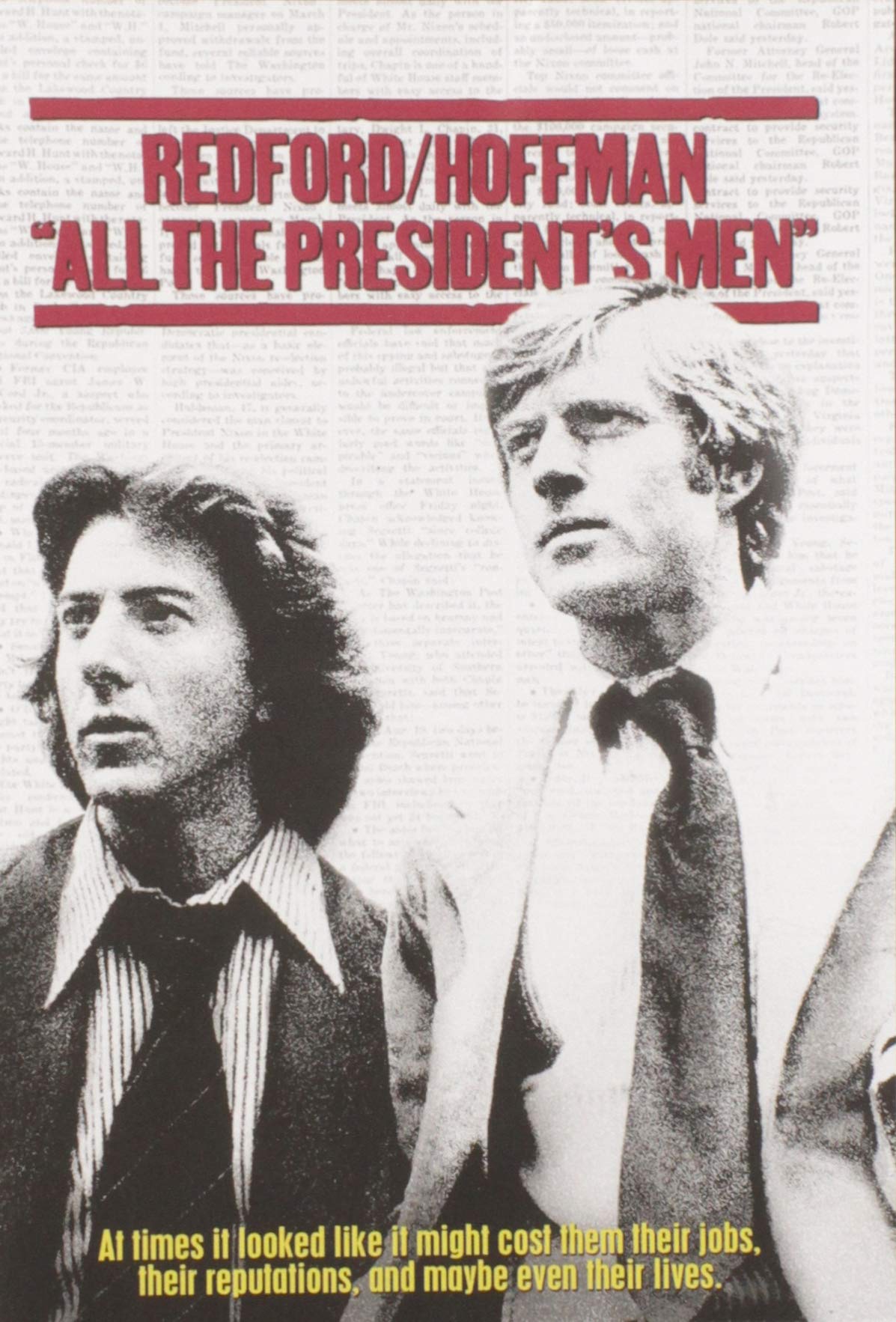 Bob Woodward et Carl Bernstein comme journalistes les plus célèbres du monde. Je me souviens avoir trouvé le film un peu ennuyeux à l’époque, mais il a obtenu une belle réussite, et ce type de film gagne une audience nettement supérieure aux meilleurs best-sellers, ce qui contribue à créer la réalité historique que nous avons en commun. J’ai décidé de revoir le film la semaine dernière, pour la première fois en un demi-siècle, et ce que j’en ai tiré valait absolument les 3.99$ que j’ai laissés à Amazon pour revoir le film.
Bob Woodward et Carl Bernstein comme journalistes les plus célèbres du monde. Je me souviens avoir trouvé le film un peu ennuyeux à l’époque, mais il a obtenu une belle réussite, et ce type de film gagne une audience nettement supérieure aux meilleurs best-sellers, ce qui contribue à créer la réalité historique que nous avons en commun. J’ai décidé de revoir le film la semaine dernière, pour la première fois en un demi-siècle, et ce que j’en ai tiré valait absolument les 3.99$ que j’ai laissés à Amazon pour revoir le film.
Woodward et Bernstein étaient les deux reporters en herbe du Washington Post qui eurent la chance de se voir attribuer l’histoire du petit cambriolage dans le quartier général du Comité National des Démocrates, dans l’immeuble du Watergate. Suivre ce tout petit fil leur a permis de dénouer toute la présidence de Nixon, avec l’aide de Gorge Profonde, leur indicateur bien informé à l’identité secrète qui leur indiquait à chaque fois la direction à prendre. Au fil des années, leur réussite a inspiré toute une génération de jeunes Étasuniens à se lancer dans le journalisme en espérant changer le monde et recevoir des éloges publics aussi soutenus.
Le jeu d’acteur est fabuleux, et l’intrigue est sympathique, mais comme dans mon souvenir, les événements qui ont fini par faire tomber l’Administration Nixon et à envoyer un grand nombre de ses dirigeants en prison semblent ridiculement mineurs. Dans une scène, Bernstein fait face chez lui à l’avocat Donald Segretti, et l’escroc politique se montre terrifié à l’idée que les révélations médiatiques de ses activités pour le compte du président puissent le faire radier du barreau et l’envoient en prison, chose qui se produit ensuite. Le conspirateur de Nixon se défend en affirmant avoir fait des choses bien pires à l’époque de ses études à l’University of South California, des années avant qu’un membre de sa fraternité l’embarque dans la campagne de réélection présidentielle pour répéter ses tours peu reluisants à l’échelle nationale.
Le film a été nominé à huit Oscars et en a remporté quatre, mais la seule décoration majeure qu’il ait obtenue est celle du meilleur acteur de second rôle, remporté par Jason Robards, qui joue le rédacteur en chef du Post, Ben Bradlee. Comme le présente le film, Bradlee était au départ des plus sceptiques vis-à-vis du récit suivi par ses jeunes reporters, et doutait que celui-ci fût assez important pour mériter une couverture de poids par son journal. Cependant, Woodward et Bernstein ont persévéré et l’ont peu à peu convaincu, si bien qu’il a fini par les soutenir jusqu’au bout. La chute politique finale de Nixon a ainsi institué Bradlee comme l’un des rédacteurs en chef les plus puissants des États-Unis, et a fait briller la réputation de son journal, qui a rejoint le New York Times au firmament de nos médias. L’année précédente, le Times et le Post avaient tous deux résisté aux menaces juridiques de l’Administration Nixon en publiant les fuites constituées par les Pentagon Papers, qui révélaient de nombreux secrets nationaux embarrassants au sujet de la Guerre du Vietnam.
Mais en renvoyant ce film en 2024, avec le recul historique, il m’est apparu que de nombreuses scènes entre Bradlee et ses deux jeunes reporters apparaissaient presque comme des sketches de satire politique, teintés d’ironie qui atteignait des niveaux absurdes. Mais presque aucun des spectateurs voyant ce film en 1974 n’en aurait été conscient à l’époque, et cela reste sans doute le cas de nos jours.
Avec un demi-siècle de plus, j’ai trouvé facile de comprendre les doutes manifestés par Bradlee au sujet de l’importance de cambriolage politique mineur. Durant de nombreuses années, l’un des amis les plus proches de Bradlee avait été John F. Kennedy, et moins de dix années plus tôt, JFK s’était fait assassiner à Dallas. Nous avons désormais que la plupart des amis et proches du président défunt étaient convaincus en leur for intérieur qu’un complot avait été la cause de sa mort, mais sans jamais en dire un mot au public, cependant que le Post et tous nos organes médiatiques proclamaient à qui voulait le lire ou l’entendre que c’était un tireur solitaire dérangé du nom de Lee Harvey Oswald qui en avait été le seul responsable, pour se faire lui-même tuer peu de temps après.
Bradlee savait également que sa propre belle-sœur, l’adorable artiste Mary Meyer, avait été la maîtresse de JFK et avait eu une forte influence sur lui, et que moins d’un an après l’assassinat de celui-ci, elle avait été tuée par balle en plein jour dans une rue de son quartier huppé de Georgetown, à Washington DC, et que le crime était resté impuni. Meyer avait été l’épouse de Cord Meyer, un haut gradé de la CIA, et lorsque Bradlee s’était rendu chez elle, juste après sa mort, il y avait trouvé le chef des services de contre espionnage de la CIA, James Angleton, qui essayait de cambrioler les lieux, expliquant qu’il était à la recherche du journal intime explosif écrit par Meyer. Bradlee a affirmé par la suite avoir trouvé ce journal intime, et l’avoir remis à Angleton pour qu’il le détruise.
Durant la campagne présidentielle de 1968, Robert Kennedy a remporté l’énorme primaire de Californie et est apparu comme au bord de remporter la Maison-Blanche : il a affirmé à ses amis que l’un de ses projets les plus importants serait de traquer et de punir les conspirateurs qui avaient tué son frère cinq années plus tôt. Mais il s’est alors lui-même fait abattre à son tour, soi-disant par un autre tireur solitaire dérangé. Au moment des conversations tenues en 1972 entre Bradlee et Woodward et Bernstein, le rédacteur en chef était sans doute au courant que RFK était lui aussi mort dans le cadre d’une conspiration, l’autopsie officielle révélant que la balle mortelle avait été tirée à bout portant depuis l’arrière du crâne, alors que le tireur qui avait été arrêté se trouvait quelques pas devant lui.
Ces faits secrets, que Bradlee connaissait sans doute, constituaient d’évidence des éléments propres à un récit nettement plus spectaculaire et politiquement puissant que les petits débordements et les petites manœuvres politiques peu ragoûtantes menées dans le cadre de la campagne de réélection de Nixon, mais en 1972, rien de toute cela n’avait été révélé au monde, fût-ce dans les pages du Post ou ailleurs. On peut donc facilement comprendre pourquoi le puissant rédacteur en chef a commencé par manifester peu d’intérêt dans les découvertes dérisoires de Woodward et Bernstein. De fait, il a dû ricaner intérieurement et penser vis-à-vis de ses jeunes reporters quelque chose comme « Je pourrais vous en donner, des vrais crimes politiques… »
Tout en supervisant ses jeunes reporters sur le Watergate, le rédacteur en chef du Post gardait le silence sur tous ces faits importants au sujet de l’assassinat de JFK, que mes 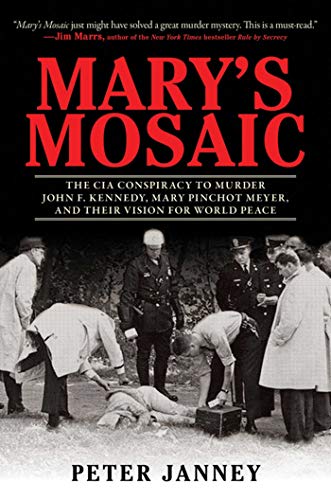 recherches m’ont permis de découvrir au cours de la dernière décennie. Mais il y a quelques jours, j’ai fini par lire Mary’s Mosaic, écrit par Peter Janney, le récit paru en 2012 de la vie et de l’histoire de la maîtresse de Kennedy, tuée en pleine rue, qui suggère que les secrets dissimulés par Bradlee pouvait comprendre certains éléments plus sombres encore.
recherches m’ont permis de découvrir au cours de la dernière décennie. Mais il y a quelques jours, j’ai fini par lire Mary’s Mosaic, écrit par Peter Janney, le récit paru en 2012 de la vie et de l’histoire de la maîtresse de Kennedy, tuée en pleine rue, qui suggère que les secrets dissimulés par Bradlee pouvait comprendre certains éléments plus sombres encore.
La famille de Janney avait été très proche de celle des Meyer, et le fils de Mary, Michael, était son meilleur ami d’enfance. À l’instar de Cord Meyer, le père de l’auteur était un officier haut gradé de la CIA, ce qui était l’une des raisons des liens qui les unissaient, et Janney, l’aîné, avait été la première personne à apprendre la mort de Mary, et avait porté son cercueil lors de ses funérailles. Lorsque, des décennies plus tard, Janney a décidé d’écrire son livre plus de la moitié des 500 pages s’intéressaient à la relation entre Mary et Kennedy, au rôle apparemment tenu par la CIA dans le complot pour l’assassinat de JFK, et comment la combinaison de ces facteurs avait débouché sur l’assassinat de Mary l’année suivante.
Mary avait toujours pensé que c’était une conspiration qui avait été responsable de l’assassinat de son grand amour de président, et sa propre mort survint trois semaines à peine après la publication du rapport de la Commission Warren, dont elle avait annoté lourdement l’un des exemplaires, et dont elle avait précisé à ses amis qu’il s’agissait d’une mystification qu’elle espérait contribuer à faire tomber. Elle fut exécutée par balle lors de sa balade quotidienne dans son quartier huppé et isolé de Georgetown, une balle tirée à bout portant dans la tête et une autre près du cœur. L’enquête menée par Janney a fortement montré que sa mort avait résulté d’un contrat mis sur sa tête par la CIA, l’un des témoins de proximité questionné par la police ayant été un militaire opérant sous fausse identité, avec de nombreux indices montrant qu’il était un agent des renseignements, et que c’est sans doute lui qui a appuyé sur la gâchette.
Mary Pinchot Meyer à la fête du 46ème anniversaire de JFK sur le Sequoia, le yacht présidentiel

Mary Pinchot Meyer lors de la fête d’anniversaire des 46 ans de JFK, sur le yacht présidentiel, le Sequoia
Kennedy était connu pour courir les jupons, et la liste de ses conquêtes, tant avant sa présidence que durant ses années d’occupation de la Maison-Blanche est particulièrement fournie, mais Janney documente le fait que la relation qu’il entretint avec Mary Meyer relevait d’une catégorie tout à fait différente. Mary Meyer provenait de l’élite de la côte Est, le même milieu que lui, et son père, Amos Pinchot, avait été une figure progressiste importante proche de Theodore Roosevelt, si bien que Kennedy la connaissait depuis qu’ils avaient fréquenté le lycée, un quart de siècle plus tôt. Il lui avait couru après, mais elle avait toujours rejeté ses avances jusqu’en 1960, après qu’il lança sa campagne présidentielle.
Selon l’une des sources de l’auteur, le mariage très affiché de Kennedy avec Jackie était alors compromis, mais il se sentait contraint de maintenir les apparences pour ne pas nuire à ses ambitions politiques. Et Mary était l’une des très rares femmes qu’il respectât jamais, en partie parce qu’elle n’avait rien à lui demander, et après qu’il remporta les élections présidentielles, elle devint une personnalité influente de sa présidence.
On pourrait écarter ces dires en les considérant comme très exagérés, mais Janney les étaye par des interviews de plusieurs conseillers politiques proches de JFK, qui ont expliqué avoir de manière répétée fait entrer Mary Meyer en douce à la Maison-Blanche sans que son nom figurât sur les registres officiels. Elle passait souvent du temps avec Kennedy dans le Bureau Ovale, discutant parfois même des lignes politiques et de sujets de sécurité nationale en compagnie de ses hauts conseillers. Un conseiller haut placé a affirmé que Kennedy avait parlé de divorcer d’avec Jackie à l’issue de son mandat et de se marier avec la femme qu’il connaissait depuis l’adolescence.
Mary était de longue date une activiste pacifiste engagée, et durant les premières années de son mariage avec Cord, celui-ci avait eu des idées du même ordre, occupant le poste de président du mouvement des Fédéralistes d’un Monde Unifié, avant de basculer dans un fervent anti-communisme et d’accepter un poste élevé au sein de la CIA, ce qui contribua à l’effondrement de leur mariage. Aussi, selon nombre de ses amis et confidents, elle aspirait à utiliser son influence considérable sur Kennedy pour l’encourager à chercher la paix mondiale.
Lorsque parut le livre de Kanney, les diverses critiques que j’ai consulté faisaient état de ses affirmations remarquables, mais j’avais douté de nombre d’entre elles. En particulier, certaines d’entre elles, étaient relativement choquantes, comme celle qui voulait que Mary prît régulièrement du LSD, et qu’elle avait peut-être réussi à persuader Kennedy de l’accompagner lors de ces sessions hallucinogènes dans l’espoir que ce type d’expérience pourrait contribuer à lui fait adhérer à la cause de la paix internationale. Mais le livre de Janney concrétise certaines de ces affirmations, ce qui pourrait certes contribuer à expliquer les efforts frénétiques menés par Angleton et d’autres pour trouver son journal intime qui relatait les détails des expériences qu’elle avait partagées avec Kennedy.
Janney document également très bien le fait que Bradlee avait entretenu une longue et étroite coopération avec la CIA lorsqu’il avait été journaliste. Il note également qu’au fil des années, le rédacteur en chef du Post avait modifié plusieurs fois le récit de la première fois qu’il avait appris la mort de sa belle-sœur ainsi que son rôle dans les tentatives de fouiller son domicile et de trouver son journal intime. Cela a amené Janney à soupçonner que Bradlee ait pu jouer un rôle dans le meurtre, ou en tous cas dans la dissimulation qui s’en est suivie. Le père de l’auteur fut la première personne à apprendre la nouvelle de la mort de Mary Meyer, et c’est lui qui avait informé Bradlee et Cord, son ancien mari, et des dizaines d’années plus tard, lorsque Janney analysa de près l’agenda très suspect de cette information, il fut choqué d’avoir à conclure que Janney, plus âgé, avait apparemment trempé dans le complot de la CIA qui coûta la vie à Mary Meyer.
La plupart des éléments présentés par ce livre, si l’on ne peut certes les considérer comme formellement prouvés, semblent très bien étayés par des fait concrets, et il convient de tenir compte de ce que ce livre nous apprend. Au début des années 1960, le président John F. Kennedy vivait une histoire d’amour vouée à l’échec avec une femme qu’il connaissait depuis l’adolescence, la belle Mary Meyer, activiste pacifique, qui lui fit peut-être découvrir la consommation de LSD. Leur relation secrète s’est transformée en terrible tragédie lorsqu’ils furent tous deux frappés de mort violente du fait de conspirateurs de la CIA, impliquant peut-être le beau-frère de Mary, Ben Bradlee, du Washington Post. Il ne fait aucun doute que ce complot tiré de la réalité est tout aussi choquant et spectaculaire que tout thriller d’espionnage inventé et produit par un scénariste de Hollywood, mais aucun studio ne l’a jamais adapté à l’écran.
L’ouvrage présente également des informations inédites et importantes au sujet de l’assassinat de JFK. John McCone, directeur de la CIA, était loyal envers Kennedy, et juste après assassinat, il récupéra la copie originale du film de Zapruder qui avait enregistré l’incident, livrée par deux agents des Services Secrets au centre d’analyse photographique de la CIA pour que ce film fût soigneusement examiné. L’expert de la CIA qui a réalisé l’analyse a été interviewé par Janney, et a déclaré que ce qu’ils ont vu à l’époque était substantiellement différent de la version du film qui a été distribuée par la suite, diverses parties du film ayant apparemment été retirées ou modifiées pour produire cette version. Le film original apportait la preuve indubitable de huit coups de feu environ, ce qui a convaincu McCone du fait que plusieurs tireurs avaient agi.
Le Washington Post et l’étrange mort de son éditeur
L’histoire de Mary Meyer et des circonstances entourant sa mort ne sont pas les seuls éléments dramatiques que Bradlee seul était à connaître au moment du Watergate. Une autre mort étrange survenue en 1963 avait également frappé quelqu’un de proche de l’éditeur du Post, et ce avant même l’assassinat de JFK.
Il y a quelques années, j’avais acheté pour 25 cents un exemplaire de The Powers That Be, l’histoire magistrale écrite en 1979 par David Halberstam de quatre empires 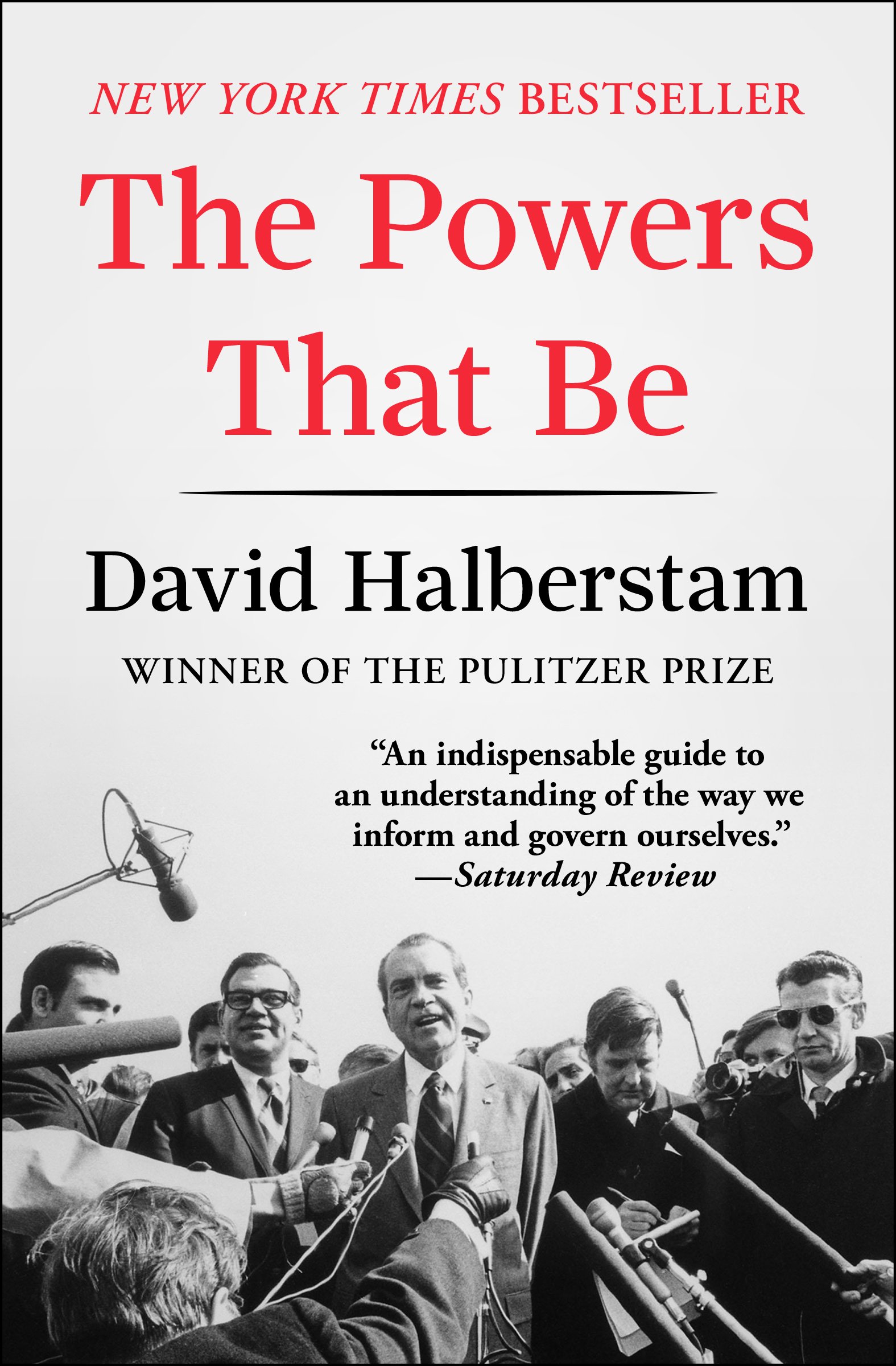 médiatiques dominants aux États-Unis, qui s’étalait sur pas moins de 750 pages. Durant les confinements du Covid, j’ai décidé d’approfondir ce que je savais en lisant enfin cet ouvrage et cet effort a été bien récompensé. L’une des figures centrales présentées par Halberstam est Philip Graham, un nom qui m’était resté jusqu’alors inconnu, mais qui n’en est pas moins l’homme qui a créé le Washington Post moderne.
médiatiques dominants aux États-Unis, qui s’étalait sur pas moins de 750 pages. Durant les confinements du Covid, j’ai décidé d’approfondir ce que je savais en lisant enfin cet ouvrage et cet effort a été bien récompensé. L’une des figures centrales présentées par Halberstam est Philip Graham, un nom qui m’était resté jusqu’alors inconnu, mais qui n’en est pas moins l’homme qui a créé le Washington Post moderne.
Né dans le Dakota du Sud et ayant grandi à Miam, Gaham fut un étudiant modèle, qui fut éditeur du Harvard Law Review et clerc à la Cour Suprême auprès de Felix Frankfurter, puis qui passa une grande partie de la seconde guerre mondiale au sein de l’OSS, l’organisation qui devint par la suite la CIA, sous les ordres directs du général Bill Donovan, dirigeant de cette organisation.
En 1940, il s’était marié avec une membre de la famille qui détenait le Post, qui n’était alors qu’un journal de Washington peinant à joindre les deux bouts, non rentable, et d’une diffusion bien moindre que le Washington Star, qui dominait à l’époque le marché. Il devint rédacteur en 1946, et quelques années plus tard, il reçut 70 % des actions contrôlant la société de la part de son beau-père reconnaissant, les 30 % restants revenant à son épouse.
Selon le récit exposé par Halberstam, en 1954, Graham parvint à réaliser la difficile fusion entre le Post et le Washington Times-Herald, un autre journal de Washington DC, et au cours des années 1950, il fit peu à peu de son Post, récemment agrandi, le principal journal régional, tout en faisant l’acquisition de diverses stations radiophoniques et de télévision. Bradlee, un ancien journaliste du Post, travaillait pour Newsweek, et en 1961, il parvint à le vendre avantageusement à Graham, qui en fit le principal rival national du magazine Time édité par Henry Luce, avec Bradlee au poste d’éditeur à Washington. Ainsi, au début des années 1960, Graham détenait et gérait l’un des quelques plus grands empires médiatiques du pays, qui dominait le marché de Washington DC, et Bradlee était l’un de ses principaux subordonnés.
Graham, en tant que baron régnant sur les médias de Washington DC, jouait évidemment un rôle important dans le monde politique, et il était étroitement allié à Lyndon Johnson, le Démocrate le plus puissant de la fin des années 1950. Ainsi, en 1960, il fut l’une des principales personnalités à faire pression sur Kennedy pour qu’il revînt sur sa décision et choisît pour vice-président son rival détesté, Johnson, une décision qui finit par paver la voie de LBJ à la présidence.
Mais selon Halberstam, durant les quelques années qui suivirent, Graham se montra fortement perturbé, s’éloignant de plus en plus de son épouse Katharine et de la famille demi-juive de celle-ci, tout en exprimant par bouffées un antisémitisme extrême, surtout à l’encontre de son beau-père décédé. Graham avait des antécédents maniaco-dépressifs, ainsi qu’un problème d’alcool, mais ce nouvel état de santé était bien pire, et une lutte de pouvoir se développa bientôt à la tête de son empire médiatique, avec les hauts dirigeants contraints de choisir entre Philip et Kay. En 1963, il avait également entamé une relation amoureuse avec l’une de ses employées au sein de Newsweek, et déclarait vouloir divorcer d’avec sa femme et épouser cette employée.
Halberstam n’en fait aucune mention dans son ouvrage, mais durant cette même période, une âpre guerre froide politique avait éclaté entre les Kennedy et Lyndon Johnson. Graham était proche des Kennedy et plus proche encore de LBJ, et en tant que propriétaire des principaux organes médiatiques de Washington, il était forcément dans le secret de cette situation délicate, qui ajouta sans doute à son stress personnel.
Puis, en 1963, Graham subit un épisode public des plus étranges, alors qu’il assistait à une importante convention d’éditeurs tenue en Arizona ; il prit la parole sur l’estrade et révéla d’une voix forte à l’assemblée l’histoire d’amour entre Kennedy et Mary Meyer tout en avançant de nombreuses autres affirmations scandaleuses, allant jusqu’à dénoncer l’assemblée d’éditeurs de refuser d’imprimer la vérité sur des affaires controversées. Graham fut rapidement maintenu au sol, on lui injecta des tranquillisants, et on le jeta dans un avion en direction de Washington, où il fut enfermé dans un hôpital psychiatrique durant plusieurs semaines, pour être libéré après que son état de santé sembla s’améliora substantiellement.
Mais le 3 août 1963, il connut peut-être une rechute subite, et l’on découvrit son corps dans sa maison de campagne, tué d’un coup de fusil, apparemment tiré par lui-même, bien qu’il ne laissât aucun message.
Peu de temps avant son suicide supposé, Graham avait modifié son testament, pour léguer ses actions de contrôle du Post et du reste de son empire médiatique à la maîtresse qu’il avait prévu d’épouser, et déshéritant ainsi son épouse et ses enfants. Mais à l’issue d’une dure bataille judiciaire, ce testament fut invalidé et considéré comme produit par une maladie mentale, si bien que le contrôle du Post revint à la famille qui en avait disposé au départ, et sa veuve et ses enfants en furent les propriétaires et les éditeurs durant le demi-siècle qui a suivi.
Il s’agit certes d’une histoire des plus étranges et des plus dramatiques, bien plus étrange que toute autre dans le scandale du Watergate qui a suivi, mais malgré son impact colossal sur notre paysage médiatique, je n’en avais jamais entendu parler. Cependant, Bradlee, qui était l’un des principaux subordonnés de Graham, a dû connaître de près les montagnes russes de ces rebondissements. Peut-être que la maladie mentale subite, le suicide de Graham, et l’invalidation de son testament se sont produits exactement comme le raconte Halberstam, sans avoir de portée ou de lien sur d’autres événements. Mais on peut faire l’hypothèse qu’il en fut autrement.
En examinant ce récit de plus près, certaines dates m’ont frappé. À l’été 1963, les Kennedy avaient sans doute déjà formulé leur projet de faire usage de leurs alliés médiatiques pour détruire Johnson en enquêtant et en publiant des informations sur les nombreux crimes qu’il avait commis au Texas ; afin de lui retirer sa candidature à la vice-présidence pour 1964 et l’envoyer derrière les barreaux. Dans le même temps, le complot opposé, visant à assassiner Kennedy était sans doute déjà en préparation, avec Johnson sans doute parmi les principaux conspirateurs ; au mois d’avril, il avait annoncé la visite que Kennedy allait faire à Dallas.
Graham contrôlait les organes médiatiques les plus puissants de Washington, et l’une des deux factions a pu lui exposer les éléments de ses projets, dans l’espoir de le rallier et de s’attirer son important soutien dans la confrontation qui approchait. Cela aurait évidemment placé l’éditeur dans une situation extrêmement tendue, et peut-être même dangereuse, surtout si se levaient des craintes de voir son instabilité mentale l’amener à révéler ces secrets au camp opposé. On peut même imaginer que l’opération de modification de son testament, laissant son empire médiatique à sa maîtresse en déshéritant son épouse et sa famille, constituait en réalité une assurance vie, mais qui ne fonctionna pas dès lors que ce nouveau testament fut déclaré invalide.
À tout le moins, je trouve tout de même étrange la coïncidence qui voulut que la mort du plus puissant propriétaire de médias de Washington par un coup de fusil fut suivie moins de trois mois après par l’assassinat de Kennedy.
L’histoire de l’étrange fin de Graham m’intriguait, et j’ai décidé de voir si je pouvais trouver d’autres informations à ce sujet.
Après que l’on découvrit le cadavre de Graham et que sa veuve Katharine parvint à faire invalider son testament, elle prit totalement le contrôle du vaste empire médiatique qu’il avait créé, régnant comme éditrice indiscutée durant les décennies qui suivirent. Au début des années 1970, le doublé des triomphes des Pentagon Papers et du scandale du Watergate avaient élevé le Post parmi les journaux les plus importants au monde, ce qui attirait évidemment l’attention sur la personne qui le contrôlait, une personnalité éminente de la société de Washington qui figurait également parmi les femmes les plus riches et les plus puissantes au monde. Je suis tombé sur des références à un récit controversé et effacé de la vie de Katharine Graham, publié à la fin des années 1970, et j’ai décidé de le lire.
Alors même que la couverture réalisée par le Post du Watergate contraignait Nixon à  quitter la Maison-Blanche, une jeune journaliste d’investigation du nom de Deborah Davis avait commencé à écrire Katharine the Great, sa biographie non autorisée. Au début de l’année 1978, Harcourt Brace Jovanovich, un éditeur de premier plan, acheta les droits de couverture et prépara une vaste campagne de marketing pour ce qu’il espérait voir devenir un énorme best-seller. Mais Katharine Graham eut vent du projet et se montra extrêmement mécontente de son contenu, menaçant l’éditeur au travers d’un féroce procès pour diffamation tout en envoyant tous ses amis et alliés dans les médias pour dénoncer le livre à paraître comme un « déchet » empli de fausses informations. Comme la pression montait, Harcourt abandonna l’ouvrage et fit broyer les dizaines de milliers d’exemplaires déjà imprimés, violant les termes du contrat signé avec l’auteur et provoquant une bataille juridique difficile et interminable.
quitter la Maison-Blanche, une jeune journaliste d’investigation du nom de Deborah Davis avait commencé à écrire Katharine the Great, sa biographie non autorisée. Au début de l’année 1978, Harcourt Brace Jovanovich, un éditeur de premier plan, acheta les droits de couverture et prépara une vaste campagne de marketing pour ce qu’il espérait voir devenir un énorme best-seller. Mais Katharine Graham eut vent du projet et se montra extrêmement mécontente de son contenu, menaçant l’éditeur au travers d’un féroce procès pour diffamation tout en envoyant tous ses amis et alliés dans les médias pour dénoncer le livre à paraître comme un « déchet » empli de fausses informations. Comme la pression montait, Harcourt abandonna l’ouvrage et fit broyer les dizaines de milliers d’exemplaires déjà imprimés, violant les termes du contrat signé avec l’auteur et provoquant une bataille juridique difficile et interminable.
Davis raconte l’histoire de la suppression de son ivre dans l’introduction d’une édition plus tardive, publiée par un autre éditeur, et également désormais disponible en PDF sur Internet. Lire son récit de la censure féroce qu’elle a eu à subir m’a amené à penser que le texte allait débordait d’éléments explosifs, tous documentés en détail.
Malheureusement, j’ai été très déçu lorsque j’ai commencé à lire ce livre. Une grande partie du texte est consacrée à un récit plutôt ennuyeux de l’histoire de la famille de Katharine avant son mariage avec Philip. En dépit de leur énorme importance politique, les assassinats des frères Kennedy dans les années 1960 ne font quasiment l’objet d’aucune attention dans cet ouvrage, et aucune suggestion n’est même faite que les tueurs aient pu ne pas être des tireurs solitaires dérangés, pas plus que n’est soupçonné que le suicide de Philip Graham puisse dissimuler autre chose. Et malgré cette tentative évidente de se soustraire à toute controverse conspirationniste, le texte ne présente presque aucune référence de bas de page, si bien qu’il est très difficile d’évaluer la crédibilité des nombreuses affirmations avancées au sujet des affaires ou d’autres sujets. La qualité générale du récit et de l’écriture m’est apparue comme lourde et médiocre, et l’absence d’index limite également l’utilité de ce livre.
En contraste, la couverture de ces mêmes éléments dans le livre publié par Janney il y a plus de trente ans m’est apparue nettement supérieure. Apparemment, Mary Meyer avait toujours fait preuve de gros doutes au sujet du présumé suicide de Graham, et Janney lui-même entretenait des doutes importants, allant jusqu’à mentionner qu’une source avait pris contact avec Davis pour lui dire que Graham avait été tué, mais l’auteur ne s’était pas à l’époque occupé d’investiguer à ce sujet. De fait, Janney fait mention qu’au cours d’une interview réalisée en 1992, Davis a décrit les hypothèses répandues selon lesquelles Katharine Graham avait pris des dispositions pour que son mari soit tué ou peut-être que quelqu’un lui avait dit : « ne vous en faites pas, nous allons nous en occuper. » Davis omet soigneusement tout notion dangereuse de ce type dans son livre de 1978 ou dans sa réédition de 1991, si bien que Janney apporte davantage d’informations sur les véritables opinions de Davis qu’elle ne le fait dans son propre ouvrage. Il est vrai que Janney a écrit son livre des années après, lorsque les sujets furent devenus nettement moins sensibles, alors que Davis peut avoir retenu ses coups dans l’espoir que son livre fût publié et promu par une maison d’édition de premier plan.
Il en ressort également que durant de nombreuses années, Graham a apporté un ferme soutien médiatique à la CIA dans ses divers projets de propagande, mais quelque temps après le fiasco de la Baie des Cochons, il avait dénoncé publiquement la manipulation des journalistes pratiquée par l’organisation ; il se peut que son comportement erratique ait en 1963 soulevé des drapeaux rouges vis-à-vis des énormes dégâts qu’il pourrait pratiquer dans l’opinion publique s’il commençait à révéler des secrets de cette nature, ce qui a pu amener à sa mort. Janney émet l’hypothèse selon laquelle Katharine Graham scella un « pacte faustien » avec des éléments de la CIA, promettant de poursuivre les mêmes politiques et arrangements précédemment souscrits par son mari, en échange de la prise de possession complète et du contrôle de ses propriétés médiatiques. Une telle hypothèse m’apparaît tout à fait plausible.
Le gouvernement de l’Empire romain était célèbre pour ses meurtres et ses complots secrets, et j’ai commencé le présent article en suggérant que la véritable histoire politique des États-Unis modernes puisse parfois s’être davantage rapprochée à ce monde que ce que la plupart d’entre nous aimeraient en convenir. Janney semble avoir tiré des conclusions semblables, commençant chacune des sections de son livre par de longs passages de la célèbre mise en scène par la BBC de Moi, Claudius, une suite qui déborde de meurtres, de coups d’État et d’intrigues politiques mortelles qui ont marqué le règne des empereurs Auguste, Tibère, Caligula et Claudius.
Issu d’une famille de Communistes, Carl Bernstein avait toujours eu des difficultés à travailler au Post, et il quitta le journal quelques années après son triomphe du Watergate. En 1977, il a ensuite rapidement publié un gros article de 28000 mots en couverture du magazine Rolling Stone, révélant l’énorme influence jouée par la CIA sur la couverture médiatique aux États-Unis, comprenant sa longue implication au sein du Post et de Newsweek, même s’il cita également divers réfutations à ce sujet.
Lorsque la Washington Post Company fit l’acquisition de Newsweek, l’éditeur Philip L. Graham fut informé par des dirigeants de l’Agence que la CIA fait occasionnellement usage du magazine à des fins de dissimulation, selon des sources au sein de la CIA. « Il était notoirement connu que Phil Graham était quelqu’un à qui l’on pouvait demander de l’aide, » a affirmé un ancien directeur adjoint de l’Agence. « Frank Wisner s’est occupé de lui. » Wisner, directeur adjoint de la CIA entre 1950 et les jours ayant précédé son suicide, en 1965, et l’orchestrateur en chef de la CIA des opérations « noires », qui étaient nombreuses à impliquer des journalistes. Wisner aimait se vanter de son « puissant Wurlitzer », un merveilleux instrument de propagande qu’il avait construit, et utilisé, avec l’aide de la presse. Phil Graham était sans doute l’ami le plus proche de Wisner. Mais Graham, qui s’est suicidé en 1963, ne connaissait apparemment que peu de choses concernant les détails d’arrangements sur des dissimulations pratiquées avec Newsweek, ont affirmé des sources au sein de la CIA.
• The CIA and the Media
Comment les médias d’information les plus puissants des États-Unis ont travaillé main dans la main avec la Central Intelligence Agency et Pourquoi le Comité Church l’a dissimulé
Carl Bernstein • Rolling Stone • 20 octobre 1977 • 28,000 mots
La CIA désignait son projet pour les médias sous le nom d’Operation Mockingbird, et j’ai trouvé cet article de journalisme d’enquête produit par Bernstein nettement plus intéressant et plus important que tous ses autres travaux sur les sales tours politiciens joués par des personnages comme Donald Segretti. Il est également relativement intriguant que Frank Wisner, le haut gradé de la CIA responsable d’influencer les médias étasuniens, se soit soi-disant suicidé au fusil de chasse en 1965, deux ans après que son ami le plus proche, propriétaire et éditeur de l’empire médiatique du Washington Post, ait fait exactement la même chose. Et comme je l’ai découvert en 2018, l’année suivant la mort de Wisner, la CIA a lancé sa campagne médiatique très réussie pour discréditer l’opinion très répandue selon laquelle l’assassinat des Kennedy avait été l’ouvrage d’une conspiration :
Selon Talbot, « À la fin 1966, il était devenu impossible pour les médias bien établis de s’en tenir au récit officiel, » et l’édition du 25 novembre 1966 du magazine Life, alors à l’apogée de son influence nationale, publia le remarquable article de couverture « Oswald a-t-il agi seul? », exposant en conclusion que tel n’avait sans doute pas été le cas. Le mois suivant, le New York Times annonçait constituer un groupe de travail spécial pour enquêter sur l’assassinat. Ces éléments allaient bientôt fusionner avec la fureur médiatique autour de l’enquête Garrison qui commença l’année suivante, une enquête qui intégra Lane parmi les participants actifs. Cependant, dans les coulisses, on lançait également une contre-attaque médiatique puissante.
En 2013, le professeur Lance deHaven-Smith, ancien président de la Florida Political Science Association, publia Conspiracy Theory in America, une exploration fascinante de l’histoire du concept et des origines probables du terme de « théorie du complot ». Il notait que durant l’année 1965, la CIA s’était alarmée de la montée du scepticisme qui montait dans le pays vis-à-vis des conclusions de la commission Warren, surtout après que le public se mit à regarder d’un œil soupçonneux l’agence de renseignements elle-même. Aussi, en janvier 1967, les hauts dirigeants de la CIA distribuèrent un mémo à l’ensemble de leurs relais locaux, les enjoignant à employer leurs actifs médiatiques et leurs contacts au sein des élites pour réfuter ces critiques en faisant usage de divers arguments, insistant notablement sur le soutien supposé de Robert Kennedy envers la conclusion du « tireur solitaire ».
Le scandale du Watergate fut-il un « coup d’État silencieux ? »
Ainsi, au moment où l’éditeur en chef du Post tenait des réunions avec ses jeunes reporters du Watergate plein d’allant, il connaissait des histoires et des scandales politiques nettement plus dramatiques que tout ce que ceux-ci pouvaient être en train de débusquer, et il était peut-être même personnellement impliqué dans certains d’entre eux. Mais il n’était pas non plus sans savoir que si son journal publiait jamais l’un ou l’autre de ces éléments, il allait immédiatement se faire purger de son poste et se voir inscrit sur une liste noire permanente, avec possiblement un risque sérieux de voir raccourcie sa durée d’existence, comme cela s’est produit pour Mary Meyer et Philip Graham.
Bien que les interprétations puissent différer entre elles, la plupart des faits que j’ai discutés à ce stade semblent solidement documentés. Mais comme le récit qu’ils relatent n’a jamais constitué le sujet d’un film majeur produit par Hollywood, seule une petite frange d’Étasuniens en sont aujourd’hui conscients.
De fait, on pourrait facilement imaginer une satire absurde, voire digne des Monty Python, alignant côte à côte tous ces assassinats politiques et toutes ces luttes de pouvoir mortelles dramatiques et les comparant avec les futilités qui firent le fil du scandale du Watergate, les fervents reporters couvrant cette affaire restant totalement inconscients des énormités qui se produisaient autour d’eux. Cela me rappelle les premières scènes de la comédie d’horreur britannique Shaun of the Dead, parue en 2004, où l’on voit le protagoniste paresseux et nonchalant, sorti d’East End, suivant sa routine quotidienne dans la ville de Londres, sans remarquer l’apocalypse de zombies en train d’engloutir la ville, avec même des monstres affamés en train de dévorer divers piétons juste à côté de lui.
Il est indéniable que pendant que Woodward et Bernstein rencontraient Bradlee lors de leurs conférences éditoriales régulières, et lui faisaient connaître leurs réussites et leurs échecs, l’éditeur expérimenté connaissait des secrets énormes qu’il ne pouvait pas leur dévoiler. Pourtant, étrangement, il est également tout à fait possible que Woodward lui-même ait connu des secrets importants et qu’il les ait dissimulés à Bradlee ainsi qu’à Bernstein, son co-auteur.
Je me souviens avoir vu en 1991 des discussions dans les journaux au sujet d’un nouveau best-seller national écrit par deux auteurs inconnus, affirmant avoir renversé le récit établi du scandale du Watergate. Leur livre affirmait que la chute politique de Nixon avait été orchestrée par des éléments de la branche dure de notre establishment de sécurité nationale, enragés par les ouvertures qu’il pratiquait vis-à-vis de la Chine et de l’Union soviétique, avec nombre d’entre eux qui considéraient ses tentatives de mettre fin à la Guerre Froide comme une colossale trahison idéologique. Non seulement l’implication de Nixon et de ses principaux assistants dans les crimes avait-elle été minime, mais John Dean, le lanceur d’alertes qui est devenu l’un des quelques héros de l’histoire dans l’esprit du public, avait en réalité joué le rôle de l’une des pires canailles, lui qui fut à la fois personnellement responsable du cambriolage qui déclencha l’affaire et une figure centrale de la dissimulation qui a suivi.
Les rares critiques et commentaires que j’avais vu sur Silent Coup: The Removal of a President, écrit par Len Colodny et Robert Gettlin étaient fortement négatifs, dénonçant 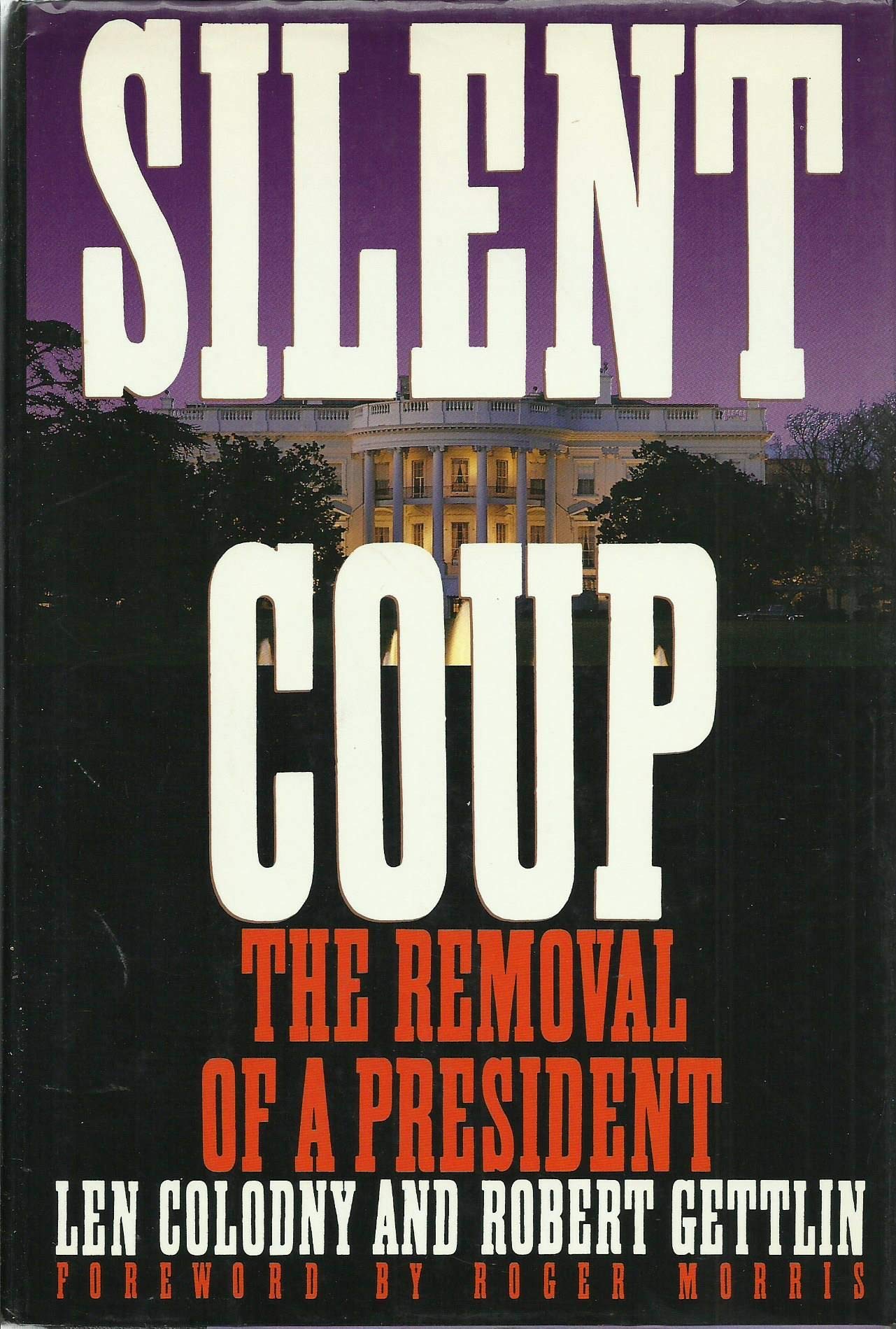 cet ouvrage comme une théorie du complot malhonnête, si bien que j’avais vaguement penché dans la même direction, et étant donné mon manque d’intérêt de l’époque pour l’histoire moderne des États-Unis, je n’étais jamais revenu sur l’idée de lire ce livre. Mais j’en avais gardé le titre à l’esprit, et lorsque je suis tombé dessus chez un bouquiniste, je l’ai acheté pour 0.25$ et j’ai fini par le lire il y a quelques années. J’ai peu à peu découvert qu’une longue liste de récits conspirationnistes, qui s’étaient fait ridiculiser et rejeter par les médias dominants, étaient en réalité bien plus plausibles que je ne m’y attendais, et ce livre tombe précisément dans cette catégorie.
cet ouvrage comme une théorie du complot malhonnête, si bien que j’avais vaguement penché dans la même direction, et étant donné mon manque d’intérêt de l’époque pour l’histoire moderne des États-Unis, je n’étais jamais revenu sur l’idée de lire ce livre. Mais j’en avais gardé le titre à l’esprit, et lorsque je suis tombé dessus chez un bouquiniste, je l’ai acheté pour 0.25$ et j’ai fini par le lire il y a quelques années. J’ai peu à peu découvert qu’une longue liste de récits conspirationnistes, qui s’étaient fait ridiculiser et rejeter par les médias dominants, étaient en réalité bien plus plausibles que je ne m’y attendais, et ce livre tombe précisément dans cette catégorie.
Ce que nous désignons sous le terme de scandale du Watergate englobe une vaste collection de divers crimes et abus politiques commis par l’Administration Nixon et par son appareil de campagne, et les détails en sont très complexes et déroutants, surtout aux yeux de quelqu’un qui, comme moi, n’a jamais enquêté de près sur cette affaire. Je ne dispose pas de l’expertise spécialisée sur l’histoire du Watergate pour affirmer si le narratif produit par cette reconstruction des événements est plus plausible que le narratif orthodoxe qu’il remet en question, mais la plupart des éléments semblent très bien documentés. Les auteurs ont passé sept ans sur ce projet, à comparer et analyser soigneusement la masse colossale de témoignages produits devant le Congrès, les écoutes de Nixon, et divers mémoires personnels, non sans y ajouter plus de 150 interviews enregistrées de presque tous les participants d’importance. Mon édition de poche s’étale sur plus de 600 pages, en comptant les annexes, et je pense que cette analyse mérite bien plus d’attention qu’elle semble n’en avoir reçu durant les quelque trente années depuis qu’elle a fait son apparition.
Le livre de Colodny et Gettlin se divise en trois sections principales qui s’intéressent aux différentes découvertes majeures que les auteurs affirment avoir faites, et qui sont relativement indépendantes les unes des autres.
Ils ouvrent leur récit en documentant lourdement le fait surprenant qu’en 1971, l’Administration Nixon avait découvert être pénétrée par un réseau d’espionnage majeur organisé par les propres hauts dirigeants militaires des États-Unis, sous la houlette de l’amiral Thomas Moorer, président de l’État-major conjointe. Nixon et Henry Kissinger, son conseiller à la sécurité nationale, avaient formulé des plans visant à une ouverture politique, tout d’abord en direction de la Chine, puis de l’Union soviétique, afin de redéfinir la carte géopolitique aux avantages des États-Unis, et également afin de négocier une fin plus favorable à la guerre du Vietnam. Ils savaient qu’une grande partie des dirigeants était constituée de guerriers de la guerre froide, relevant de la ligne dure anti-communiste, et qui risquaient de résister fortement à cette tentative. Ils craignaient donc qu’en informant le Pentagone de ces leurs tentatives, quelqu’un pût torpiller les négociations à un moment sensible, par exemple en faisant fuiter ces développements dans les médias, si bien qu’ils maintenaient le plus grand secret sur leur projet.
Mais lorsque les dirigeants du Pentagone ont compris qu’on les maintenait dans le noir, ils ont ordonné aux officiers militaires travaillant au sein de la Maison-Blanche d’entamer une opération d’espionnage massive, consistant à voler ou à copier des milliers de documents en catimini pour les remettre à leurs chefs. Il est possible que ce genre de chose se soit déjà produit par le passé, mais l’ampleur de cette opération est apparue comme totalement inédite.
Ce réseau d’espionnage militaire fut découvert par pur accident au mois de décembre 1971, lorsque l’un de ses agents clés fut soumis au détecteur de mensonges, car on le soupçonnait — à tort — de s’être rendu responsable d’une fuite sur un autre sujet auprès d’un éditorialiste politique. La réponse de Nixon fut avisée et calculée. Comprenant que la divulgation de ce scandale allait mettre au jour l’âpre conflit qui l’opposait aux dirigeants militaires, et diminuer ses chances de réélection, il décida de supprimer l’affaire et au lieu de punir ou de virer Moorer, il le nomma par la suite au plus haut poste militaire des États-Unis, ce qui contraignait l’homme à un contrôle politique nettement plus resserré.
Bien que les auteurs n’en fassent aucune mention, plusieurs années plus tôt, Moorer s’était indigné de la dissimilation perfide pratiquée par le président Johnson sur le sujet de l’attaque israélienne lancée en 1967 contre l’USS Liberty, qui avait tué ou blessé plus de 200 hommes, et cet incident avait constitué l’un des facteurs sous-jacents à ses lourds soupçons à l’encontre des politiques menées par Nixon et Kissinger. Qui plus est, quelques années après la découverte de ses opérations d’espionnage, il s’indigna également de l’abandon par Nixon de centaines de prisonniers de guerre étasuniens au Vietnam, et c’est peut-être l’emprise puissante que le président avait gagnée sur lui qui le contraignit à maintenir le silence sur ce dernier sujet.
Les sentiments extrêmement amers des officiers militaires impliqués dans l’espionnage de la Maison-Blanche sont suggérés dans une interview menée par les auteurs avec l’un des participants clés à cette opération, plusieurs années plus tard. Lorsqu’on lui a demandé quels étaient les objectifs du projet, il a expliqué : « Eh bien, faire tomber Nixon. En réalité, se débarrasser de Kissinger — Kissinger mettait une véritable pagaille à ce qu’il touchait. » Ces officiers militaires considéraient les tentatives de Nixon et de Kissinger pour mettre fin à la Guerre Froide comme proches de la trahison.
Un autre aspect important de l’affaire, souligné par les auteurs mais sans doute inconnu de Nixon, était la quantité considérable d’éléments laissant à penser que le général Alexander Haig, alors assistant de premier plan de Kissinger, et devenu par la suite chef du personnel de Nixon, ait pu être associé avec cette opération d’espionnage militaire, ou qu’il en fût au moins informé. Si tel est le cas, cela suggère que la loyauté politique de Haig ait pu être nettement découpée très tôt dans l’histoire.
Ce dernier point est lié avec l’un des éléments les plus dramatiques et les plus disputés du livre. Les auteurs affirment et s’appesantissent sur l’idée que l’histoire personnelle de Woodward et son rôle dans l’éclatement du scandale du Watergate aient pu être très différents de ce qui a été présenté dans le récit médiatique standard.
Woodward était issu d’une famille de Républicains, où les convictions de droite étaient profondes, et son discours d’entrée au lycée s’intéressait fortement à Conscience of a Conservative, écrit par Barry Goldwater, mais il a toujours affirmé que ses années à Yale l’avaient poussé dans une direction nettement plus libérale sur divers sujets, comme celui de la guerre du Vietnam. Pourtant, les interviews complètes menées par les auteurs remettent fortement en cause cette transformation idéologique, et ils notent également qu’avant d’avoir fait son service dans la marine, Woodward avait été initié dans l’une des sociétés secrètes les plus élitistes de Yale, qui tenait souvent lieu de vecteur de recrutement pour les agences de renseignements. Contrairement aux affirmations avancées par Woodward selon lesquelles son service militaire avait été routinier et des plus ennuyeux, il fut en réalité impliqué dans des travaux de renseignements et se porta volontaire pour rester une année de plus afin de poursuivre sa mission exaltante, dont une partie s’était déroulée « dans les sous-sols de la Maison-Blanche. »
Le rôle joué par Woodward était celui de produire des résumés de renseignements pour l’élite, et d’apporter des informations cruciales aux dirigeants importants, parmi lesquels figuraient l’amiral Moorer et le général Haig. Comme Robert Sherrill l’a expliqué dans son excellente critique parue en 1991 dans The Nation :
Durant deux ans (1969 et 1970), « après avoir briefé Moorer à neuf heurs du matin… Woodward se rendait souvent dans les bureaux du sous-sol Ouest de la Maison-Blanche, pour y transportant des documents remis par Moorer, pour les remettre à Alexander Haig et briefer ce dernier sur les mêmes sujets déjà portés à la connaissance de Moorer. »
Cela n’aurait rien de particulièrement explosif si l’on omettait le fait que Woodward a de manière répétée réfuté cette histoire. Citons précisément la critique de Sherrill :
Lorsque Colodny et Gettlin ont interviewé Woodward pour préparer cet ouvrage, il affirmé n’avoir jamais rencontré ni parlé à Haig avant « une date antérieure au printemps 193 — trois ans après avoir quitté la Navy et un an après le début de l’éclatement du scandale du Watergate. En outre, il a réfuté avec véhémence avoir jamais eu pour tâche de présenter des briefings : « Je ne m’occupais pas de ça, » affirme-t-il. « Ça n’est jamais arrivé. Je vous regarde droit dans les yeux. Vos sources sont mauvaises. » Et de poursuivre : « Je vous mets au défi de produire quelqu’un qui dira que j’ai fait un briefing. » Colodny et Gettlin ont produit plusieurs personnes l’affirmant. L’amiral Moorer avait affirmé que Woodward était l’un de ceux qui le briefaient et « oui, bien sûr », il briefait également Haig. Melvin Laird, ancien secrétaire à la Défense, a par la suite affirmé à Colodny et Gettlin : « Oui, j’étais au courant que Woodward s’occupait de briefer Haig, » et Jerry Friedheim, qui avait été l’assistant de Laird, l’a également confirmé. Roger Morris, qui était membre du NSC de Kissinger jusqu’à sa démission pour protester contre le bombardement du Cambodge (et qui fut par la suite le biographe le plus éminent de Nixon), soutient que Woodward « connaissait bien Al Haig, et allait et venait dès les premiers temps dans le sous-sol Ouest. »
Comme l’indique Sherrill, l’un des aspects très intrigants Watergate fut qu’un reporter en herbe comme Woodward pût disposer d’un accès immédiat à la source extrêmement bien informée connue sous le nom de Gorge Profonde, dont les informations ont joué un rôle central pour faire éclater l’affaire, et ainsi faire tomber l’Administration Nixon. Une fois de plus, il est intéressant de citer l’observation sagace produite par Sherrill :
L’une des questions les plus embarrassantes du journalisme moderne est de savoir comment Bob Woodward a pu connaître cette source intérieure d’informations qui voyait tout, entendait tout, et qu’il a fait connaître au monde sous le nom de Gorge Profonde ? Comment Woodward a-t-il réussi à établir ce lien ? Pourquoi une source comme Gorge Profonde a-t-elle accepté de déballer ses munitions puissantes en passant par quelqu’un comme Woodward, qui n’était à l’époque qu’un débutant au sein du Washington Post ! Sa seule expérience antérieure dans un journal avait été au sein d’un hebdomadaire de banlieue du Maryland.
Si Woodward briefa pendant des années Haig quotidiennement et en personne à la Maison-Blanche, puis a réfuté coupablement l’avoir même connu à l’époque ou même avoir produit des briefings, cela indique certainement que sa relation personnelle avec Haig avait constitué un fait central, qu’il s’employait à dissimuler. Si nous sommes également troublés sur la manière dont un reporter débutant a réussi à nouer ce lien avec la source de haut niveau connue sous le nom de Gorge Profonde après avoir passé à peine quelques mois au sein du Post, il est plausible que ces deux secrets puissent être étroitement reliés.
Sur la base de ces éléments, il n’est guère surprenant que les auteurs soupçonnent fortement que même si Gorge Profonde n’était autre qu’une source composite, l’un de ses composants clés était la personne de Haig. Et si l’homme qui devint par la suite chef du personnel de Nixon constitua bien une source centrale dans l’enquête du Watergate, qui fit tomber le président et lui fit perdre la Maison-Blanche, le titre de « coup d’État silencieux » ne semble pas exagéré.
Le Watergate a débuté sur un cambriolage raté dans les bureaux du DNC, et sans cette étincelle initiale aucune des dissimulations ou des enquêtes médiatiques qui ont suivi n’auraient existé, si bien que les machinations de Gorge Profonde, qu’il s’agît de Haig ou de quelqu’un d’autre, ne seraient jamais entrées en jeu. Les auteurs affirment que les origines de ce petit cambriolage et la dissimulation qui a suivi se sont en réalité produits de manière bien différente de ce que l’on a pu croire.
Selon le récit conventionnel, les cambrioleurs avaient été envoyés par John Mitchell, le Procureur Général, afin de mettre sur écoute les téléphones du bureau du président du DNC, Larry O’Brien, dans l’espoir d’obtenir des informations utiles contre les Démocrates. Mais les auteurs affirment que cette théorie semble contredite par le plan d’occupation des locaux hébergeant ces bureaux, des téléphones que les cambrioleurs comptaient mettre sous écoute, et l’emplacement de leur point de guet. Ils affirment que la cible était en réalité toute autre, à savoir les postes téléphoniques du DNC qui étaient habituellement utilisés pour contacter une agence de call girls, et que l’opération d’écoutes visait à salir sexuellement les Démocrates. Et ils pensent que John Dean, le jeune conseiller de Nixon, fut le véritable responsable de cette opération de mise sous écoute.
Dean, qui est devenu par la suite l’un des grands bénéficiaires publics du scandale du Watergate, était alors un jeune avocat plein de mordant, âgé d’une petite trentaine d’années ; il comptait bien faire son ascension au sein de l’Administration Nixon et était convaincu que découvrir des saletés salaces reliées à d’importants Démocrates constituait une méthode excellente d’y parvenir.
Selon les auteurs, la petite amie de Dean — qu’il épousa par la suite — avait travaillé à temps partiel pour cette agence de call girls, et c’était sa colocataire qui en était la patronne. Sur la base des histoires qu’il avait personnellement entendues, l’ambitieux et jeune avocat décida donc d’organiser un cambriolage et d’en tirer des informations embarrassantes sur les Démocrates, qui feraient de lui un héros parmi ses collègues républicains plus âgés.
Comme il ne disposait pas de l’autorité personnelle nécessaire à lancer une telle action, il a simplement fait semblant de transmettre des directives édictées par ses supérieurs, puis a paniqué lorsque les cambrioleurs se sont fait prendre et a organisé les premières phases de la dissimulation en s’y prenant de la même manière. Comme toutes ces actions étaient illégales, aucun des ordres n’était transmis par écrit, ce qui permettait facilement à un subordonné de confiance, comme Dean, de prendre des décisions de son propre chef tout en faisant semblant de ne faire que les transmettre, sans que personne ne remette ses directives en question. Ce type de sale coup restait naturellement fondé sur le cloisonnement de l’information, si bien que personne au sein de l’Administration Nixon ne fut véritablement choqué de découvrir ces projets de cambriolage du DNC, ou de la nécessité de les dissimuler quand ils sont partis de travers.
Dean était un jeune personnage totalement obscur, alors que les médias ainsi que les Démocrates du Congrès détestaient Nixon et ses principaux conseillers, si bien que Dean n’eut aucune difficulté à transmettre l’ensemble des accusations sur ses supérieurs, ce qui lui permit de sauver sa peau et de devenir un lanceur d’alertes héroïque aux yeux du Congrès et des médias, et par leur entremise aux yeux du peuple étasunien et jusque dans les livres d’histoire.
Comme les auteurs l’ont établi en réalisant cette reconstruction alternative des événements, diverses personnalités informées du Watergate, comme Mitchell et Gordon Liddy, ont déclaré l’avoir trouvée tout à fait plausible, étayant la théorie avec des informations supplémentaires. D’évidence, le soutien de ces personnes a pu servir leurs propres intérêts, et la thèse qu’établissent les auteurs est fortement circonstancielle, mais de nombreuses portions de cette thèse semblent mieux correspondre aux faits que le récit conventionnel.
Ainsi, selon le scénario proposé par Silent Coup, deux éléments totalement séparés se sont conjugués pour faire tomber l’Administration Nixon.
Pour des raisons personnelles et carriéristes, un jeune et ambitieux membre de l’équipe de Nixon, du nom de John Dean, a autorisé le cambriolage et la dissimulation qui s’en est suivie après qu’il a mal tourné. Il a ensuite amené ses supérieurs à venir à la rescousse sur son projet, et a fini par les jeter aux loups lorsque les enquêtes du Congrès et des médias se sont trop rapprochées de sa personne. Un opportunisme et une déloyauté aussi rampants ne semblent que chose trop commune parmi les nombreuses personnes à entrer dans le monde politique.
Puis, une fois démarrés ce crime initial et la dissimulation, un individu bien informé, voulant faire tomber l’Administration Nixon, sans doute pour des raisons idéologiques, et qui entretenait déjà une relation avec Woodward — Haig apparaît comme un excellent candidat — se mit à donner pour béquée au journaliste les indices et informations qu’il lui fallait pour faire tomber la dissimulation, et avec elle la présidence de Nixon.
Pour le lecteur intéressé par une présentation raisonnable du livre par ses auteurs, je peux recommander leur interview d’une heure sur C-Span, menée par Brian Lamb :
• Silent Coup: The Removal of a President
Len Colodny and Robert Gettlin • C-Span Booknotes • 25 juin 1991 • 59m
Cette interview, et une grande quantité d’autres éléments liés à ce livre et aux éléments sous-jacents à sa reconstruction, est disponible sur un site Internet établi par les auteurs, et l’on y trouve même la version PDF de nombre des chapitres de ce livre.
• Watergate.com: The Colodny Collection
La seconde dissimulation du Watergate ?
Nombre des affirmations que soulève Silent Coup sont certes surprenantes, mais les éléments factuels semblent bien documentés et raisonnablement plausibles. Le livre est devenu un best-seller national en 1991, et j’ai été vraiment surpris qu’il semble n’avoir eu qu’un impact très minime sur le récit accepté du Watergate au cours des 33 années qui ont suivi sa publication. Cela démontre en partie l’inertie colossale qui caractérise les narratifs installés, même lorsqu’ils sont remis en cause par des alternatives supérieures.
J’ai souligné mon propre manque d’expertise sur le sujet complexe du Watergate, mais un nombre relativement importante de personnes bien informées ont semblé partager mon opinion très positive du livre de Colodny/Gettlin au moment de sa publication.
Roger Morris a été membre senior de l’équipe dédiée à la sécurité nationale sous les Administrations Johnson et Nixon, et est ensuite devenu un historien et auteur respecté, récompensé par des prix journalistiques, et l’on trouve parmi ses nombreux livres des ouvrages sur Kissinger, Haig et Nixon. Il fut tellement impressionné par l’analyse produite par Silent Coup qu’il contribua une préface soutenant fortement la thèse de ce livre, et faisant l’éloge de sa réussite à ressusciter l’« histoire cachée » de cette ère.
Le journaliste d’investigation Robert Sherrill avait beaucoup écrit sur le Watergate, et je recommande fortement sa longue critique parue dans The Nation, une publication qui n’est pas spécialement connue pour son amitié envers Nixon, alors que Robert Scheer, un autre critique acerbe de Nixon, a pris la même position dans le Los Angeles Times. Dans le même temps, le professeur Herbert Parmet, un historien émérite et auteur de sept livres, dont un sur Nixon, a publié son évaluation très favorable dans National Review. Le site Internet associé au livre contient des descriptifs favorables écrits par divers autres journalistes et universitaires.
Les liens disponibles en ligne sont récapitulés ici pour en faciliter l’accès :
• Préface de Roger Morris
• Critique par Robert Sherill, The Nation, 7 octobre 1991
• Critique par Robert Scheer, The Los Angeles Times, 23 juin 1991
• Critique par Prof. Herbert Parmet, National Review, 12 août 1991
Durant presque vingt ans, on a considéré le Watergate comme l’un des événements politiques fondamentaux de l’histoire récente des États-Unis, et on en a fait le récit dans des milliers de livres et d’articles, ainsi qu’un film à succès qui a fait de Woodward et Bernstein les journalistes les plus célèbres du monde, mais voici que Silent Coup venait gâcher le tableau. Au vu de ces circonstances, j’ai trouvé tout à fait remarquable que ce nouvel ouvrage ait attiré de réactions aussi favorables de la part d’experts de premier plan, dont l’opinion s’affichait sur toute la gamme du spectre idéologique, allant de Nation au National Review. Voilà qui m’aurait très certainement impressionné à l’époque si j’en avais eu conscience.
Mais malheureusement, à la sortie de ce livre, en 1991, je ne lisais régulièrement aucune de ces publications, si bien qu’aucune des discussions favorable à son sujet ne parvint à mon attention, et à une importante exception près, l’ensemble des nombreuses publications que je lisais ignorèrent totalement ce livre, ce qui m’a amené à supposer vaguement qu’il n’avait été l’ouvrage que de farfelus.
Un facteur majeur derrière ce silence assourdissant de la part des médias a sans doute été un éditorial produit par le critique médiatique du Washington Post, le lendemain même de la publication du livre, le dénonçant comme faux et citant des réfutations prononcées par Moorer, affirmant alors n’avoir jamais parlé aux auteurs. Cette dure attaque fut distribuée aux centaines d’organes médiatiques installés dans tous les États-Unis et abonnés au service de nouvelles du Times-Post, et elle eut sans doute un impact dévastateur. Cependant, comme Sherrill l’a indiqué dans sa critique, l’interview de Moorer avait été enregistrée sur bande magnétique et les auteurs avait déjà distribué des parties de leur enregistrement lors de leur conférence de presse, si bien que Moorer revint bientôt sur ses réfutations. Mais le Post n’a jamais corrigé l’information qu’il avait publiée.
J’ai lu entre-temps le New York Times Book Review, qui publia bientôt une longue critique extrêmement négative écrite par le professeur Stephen Ambrose, un historien qui avait déjà publié deux volumes d’une biographie de Nixon. Les dures critiques émises par Ambrose furent émises peu de temps après la parution du livre, et contribuèrent sans doute à le discréditer auprès d’un grand nombre de potentiels lecteurs, y compris moi-même. Mais comme l’a souligné Sherrill dans sa propre discussion quelques mois plus tard, Ambrose avait pris contact avec les auteurs quelques années auparavant, leur demandant d’échanger des informations sur ce sujet, et après qu’ils eurent rejeté sa proposition, les avait avertis : il pouvait, en tant qu’historien respecté, faire fonctionner leur projet, ou bien le briser.
Au moment de la parution de leur livre, Ambrose était proche de publier le troisième et dernier volume de sa trilogie sur Nixon, fortement centrée sur le Watergate, et si le récit de Silent Coup était accepté, c’est tout son cadre de pensée qui allait se voir détruit. Il se mit donc immédiatement à attaquer le livre, en émettant de nombreuses accusations totalement infondées. Lorsque le Times fut informé de ces faits, les éditeurs ajoutèrent une note de bas de page expliquant qu’ils regrettaient d’avoir assigné la critique de l’ouvrage à Ambrose, mais se mirent à partir de ce moment à ignorer le livre, et l’éditeur du Times Book Review menaça même l’éditeur du livre de représailles lorsque le mot commença à circuler de leur sérieuse bévue.
(Malgré ces embarras, le professeur Ambrose semble être devenu le choix favori du Times pour attaquer les ouvrages controversés remettant en question le narratif accepté sur les événements historiques. Moins de huit mois plus tard, après que fut sorti le film JFK d’Oliver Stone, Ambrose publia une critique de 4000 mots, dénonçant et tournant en ridicule la vague de livres très bien vendus qui remettaient en cause les conclusions de la Commission Warren et affirmaient que l’assassinat de Kennedy avait été le résultat d’une conspiration. Ambrose a également entassé ses critiques sur diverses autres théories « conspirationnistes ».)
Les deux journaux les plus puissants des États-Unis étaient le Times et le Post, et leur couverture très précoce et extrêmement négative de Silent Coup a fortement influencé les réactions des autres médias, les amenant probablement à rejeter ce livre, ce qui explique que je n’en ai presque jamais vu mention dans les publications que je lisais.
Le Post avait bâti sa réputation sur la couverture du Watergate et sa réussite de la chute de Nixon, et si le récit de Silent Coup était correct en substance, le journal n’avait guère été que l’outil d’une conspiration politique. Le Watergate avait fait de Bob Woodward le journaliste le plus connu des États-Unis et de Ben Bradlee l’éditeur le plus célèbre, et la théorie avancée par Colodny et Gittlin menaçait de détruire leur réputation ; il n’est dès lors pas du tout surprenant qu’eux et leurs alliés aient mené des tentatives désespérées pour étouffer ce nouveau récit au plus tôt. Le Times avait entre-temps publié un océan de récits majeurs sur le Watergate au cours des vingt années précédentes, et sa réputation aurait sévèrement eut à pâtir de son ratage à avoir compris le trame de fond du Watergate, ce qui aurait été d’autant plus embarrassant que la vérité se trouvait déterrée par une paire d’inconnus.
Mon édition de poche de Silent Coup, parue en 1992, contient un post-scriptum long de 25 pages, portant le titre bien trouvé de « Protection du mythe — Le Washington Post et la seconde dissimulation du Watergate » qui discute avec moult détails cette tentative de supprimer l’ouvrage et de ses impacts.
Par exemple, Mike Wallace et Sixty Minutes s’étaient montrés enthousiastes à réaliser une émission sur Silent Coup, et après qu’un producteur a passé plusieurs jours à passer en revue les éléments et les preuves, Wallace a interviewé les deux auteurs dans une suite d’un hôtel de New York, ce qui a produit des heures de bandes vidéo, qui devaient être coupées pour en sortir un morceau de quinze minutes à diffuser au sein de l’un des programmes télévisés les mieux notés des États-Unis. Mais les pressions exercées par le Post, peut-être au niveau le plus haut des sociétés, finirent par tuer le projet malgré l’enthousiasme affiché par Wallace, et les auteurs ont émis l’hypothèse raisonnable que la PDG du Post, Katharine Graham, ait pu faire pression sur son ami personnel Larry Tisch, PDG de CBS, sur ce sujet.
Le magazine Time, le principal hebdomadaire des États-Unis, avait acheté les droits de publier un extrait de 12000 mots, destiné à faire la première page, mais sous la pression, il changea d’avis, en partie parce que Bernstein était l’un de ses employés et qu’il se montrait intensivement hostile au projet. De grands nombres de journalistes et d’éditeurs étasuniens à succès avaient également investi l’ensemble de leurs carrières dans le récit en place sur le Watergate.
L’émission Good Morning America, diffusée par ABC, a également subi de fortes pressions pour lui faire annuler son interview sur l’ouvrage, mais les producteurs ont tenu bon et les auteurs pensent que ces 25 minutes, diffusées au cours de l’une des émissions nationales les plus cotées, a pu constituer un facteur crucial de la réussite du livre, qui a bientôt fait l’objet d’un énorme intérêts pour des interviews dans les chaînes de télévision locales, qui se comptèrent à plus de cent. Mais bien que les ventes ait fini par atteindre les centaines de milliers d’exemplaires, ce qui a fait du livre un énorme best-seller national, les premières attaques lancées par le Post et par le Times avaient empêché la marée montante sur les médias d’élite qui restait nécessaire pour arracher et remplacer un narratif historique bien implanté.
L’une des raisons pour lesquelles je trouve le récit présenté par les auteurs tellement crédible vient du fait qu’une bonne dizaine d’années auparavant, Katharine Graham et le Post avaient lancé des actions très similaires pour supprimer le livre écrit par Deborah Davis, et y étaient parvenu. La principale différence était que cette fois-ci, le livre de Colodny/Gettlin était d’une qualité nettement supérieure à celui de Davis, ce qu’il avançait était documenté complètement et dans le détail, et son sujet central était nettement plus substantiel et plus important. Ces facteurs, ainsi qu’un certaine dose de chance, ont permis à Silent Coup de survivre aux attaques furieuses lancées par le Post et est immédiatement devenu un énorme best-seller national, même s’il a malheureusement échoué à détrôner le récit standard du Watergate.
Le Watergate et la CIA
J’ai trouvé très convaincante l’analyse du Watergate portée par Silent Coup, mais en dépit des nombreuses références qu’elle fait de la CIA, cette organisation ne semble avoir joué qu’un rôle périphérique dans l’histoire. Et je pense qu’il est tout à fait possible que l’agence ait été nettement plus impliquée que cela.
Comme j’en ai discuté, les crimes et abus qui ont constitué le Watergate étaient tout à fait bénins en comparaison à d’autres actions menées à l’époque, et cela reste vrai qu’ils aient été orchestrés par John Mitchell ou par John Dean. Pourtant, le mégaphone médiatique du Washington Post les a gonflés pour qu’ils apparaissent comme des transgressions monumentales, propres à provoquer la démission d’un président et l’incarcération de nombreux hauts dirigeants de son administration. Je pense qu’il faut se poser la question de savoir pourquoi le Post et l’ensemble des autres médias nationaux se sont tournés contre Nixon pour avoir réalisé des actions qui étaient vraiment modestes en comparaison avec celles d’autres présidents ou du FBI de J. Edgar Hoover.
Si l’ensemble des dirigeants publics de Chicago acceptent des pots de vin, mais qu’un seul d’entre eux se fait jamais arrêter et poursuivre, il est certes coupable, mais on doit se demander pourquoi il a été le seul à être puni.
Comme nous l’avons vu plus haut, le Post semble avoir opéré sous une influence importante de la CIA, et promu ou tué dans l’œuf des récits conformément aux désidératas de cette organisation. Si le Post avait volontairement supprimé toute couverture d’un si grand nombre d’événements dramatiques survenus au cours des dernières années, ignorer un cambriolage de troisième zone comme le Watergate aurait été chose triviale. Mais bien que Bradlee adoptât au départ cette position, il changea rapidement d’avis. On pourrait émettre l’hypothèse que la CIA aura joué un rôle dans cette décision.
Silent Coup a démontré que les dirigeants du Pentagone se montraient extrêmement soupçonneux vis-à-vis de la politique d’ouverture préparée par Nixon envers la Chine et les Soviétiques, et certaines de ces personnalités peuvent avoir décidé de le faire tomber, et de le contraindre à partir, pour l’en empêcher. Et si les dirigeants du Pentagone avaient de telles idées en tête, peut-être que des tenants de la ligne dure au sein de la CIA avaient les mêmes. Il semble exister tout un faisceau d’éléments indiquant que les relations entre Nixon et la CIA n’étaient pas bonnes, et les dirigeants de l’agence refusaient souvent de suivre ses directives.
Mais Nixon avait passé plus de vingt ans comme figure dirigeante de la scène politique de Washington, et il connaissait des secrets importants, dont il put estimer qu’ils lui assuraient une emprise puissante sur cette organisation, chose qui indignait les dirigeants de celle-ci et qu’ils considéraient comme une menace.
Peu après que les cambrioleurs du Watergate furent arrêtés, Nixon demanda à Bob Haldeman, son chef du personnel, de rencontrer Richard Helms, dirigeant de la CIA, et souligna que si l’enquête sur le Watergate se poursuivait, l’implication de l’ancien agent de la CIA, Howard Hunt, pourrait l’amener à ouvrir « l‘ensemble du machin de la Baie des Cochons. » Haldeman fut très gêné par cette référence, car l’échec de l’invasion de la Baie des Cochons remontait à plus d’une décennie, et ne constituait plus du tout un sujet brûlant, mais il fit ce que Nixon lui avait demandé et fut choqué de voir Helms réagir en criant : « Je ne suis pas du tout préoccupé par la Baie des Cochons. » Haldeman a par la suite conclu que « l’ensemble du machin de la Baie des Cochons » était une phrase codée désignant l’assassinat de JFK et les informations ou les forts soupçons qu’entretenait Nixon sur le fait que Hunt et d’autres membres de la CIA avaient été impliqués dans la mort de Kennedy.
S’employer à soumettre au chantage une organisation disposant de la puissance de la CIA est une chose risquée, même lorsqu’on est président des États-Unis, et il se peut que Helm ait décidé de répondre en amenant ses subordonnés de l’Operation Mockingbird à encourager le Post de déclencher la couverture du Watergate pour affaiblir ou endommager l’administration Nixon. Il est possible que Helm, comme ses homologues du Pentagone, ait été très mécontent des initiatives adoptées par Nixon vis-à-vis de la Chine et de l’URSS, ce qui a pu renforcer sa décision.
Le film JFK, produit en 1991 par Oliver Stone a établi que les projets de Kennedy de mettre fin à la Guerre Froide a amené à sa mort de la main des tenants de la ligne dure, avec parmi eux des éléments de la CIA. Son film Nixon, produit en 1995, présente une scène poignante au cours de laquelle le président rencontre Helm, et les deux dirigeants s’affrontent sur le ses sujets de la Guerre Froide, avec Helms allant jusqu’à insinuer que Nixon ferait bien de retenir les leçons à tirer de la mort de son prédécesseur.
Il existe également des soupçons raisonnables selon lesquels l’implication de la CIA dans le Watergate a pu être nettement plus directe et substantielle que je ne l’ai suggéré. De nombreux aspects du cambriolage raté semblent déjà en soi très suspects, et les personnages clés impliqués dans l’incident présentaient un historique avec la CIA. Si la direction du Pentagone avait établi un réseau d’espions au sein de la Maison-Blanche, et visait à faire tomber Nixon, peut-être que les espions professionnels de la CIA menaient des actions parallèles suivant des lignes différentes, infiltrant et sabotant les opérations illégales menées par l’Administration Nixon, en se préparant à faire usage de l’affaire criminelle qui allait en découler pour contraindre au départ le président dont ils n’aimaient pas les décisions politiques.
Bien que je n’ai pas enquêté en profondeur sur cette possibilité, un extrait d’une vidéo sur laquelle je suis récemment tombé produit un résumé excellent des énormes faisceaux d’éléments étayant cette théorie.
Comme je l’ai expliqué au début de cette discussion, bien que Kennedy et Nixon soient largement considérés comme des pôles opposés, ils avaient passé la plus grande partie de leur carrière politique en entretenant des relations cordiales l’un avec l’autre, et leurs lignes politiques étrangères et intérieures n’étaient en réalité pas si éloignées. En tant que présidents, les deux dirigeants essayèrent de réduire les tensions avec nos adversaires de la Guerre Froide, et rencontrèrent de fortes oppositions face à ces politiques de la part de tenants de la ligne dure au sein de notre establishment de la sécurité nationale, dont certains au sein du Pentagone et de la CIA.
Les éléments semblent indiquer de manière écrasante que ces différends concernant les lignes politiques ont amené certains éléments de la CIA à s’impliquer dans l’assassinat de Kennedy, et qu’une décennie plus tard, des facteurs similaires ont amené des tenants de la ligne dure du Pentagone, et peut-être également de la CIA, à jouer un rôle important dans la déchéance de Nixon, cette fois suivant des moyens moins mortels. Bien que nos médias et que nos manuels d’histoire standards aient glorifié la présidence du premier, et diabolisé celle du second, on trouve des similitudes frappantes lorsque l’on s’attarde davantage sur les faits. Kennedy et Nixon sont tous deux entrés au Congrès en 1946, et ont mené une bataille pour la Maison-Blanche incroyablement serrée en 1960. Les deux hommes s’étaient fait connaître pour leurs faits d’armes anti-communistes dans le cadre de la Guerre Froide, mais une fois au pouvoir, ils modifièrent tous deux leur politique étrangère dans une direction différente, et c’est en partie pour cette raison qu’ils ont payé le prix de se voir retirer le pouvoir, même si dans les deux cas les moyens employés furent substantiellement différents.
Parmi ceux qui ont enquêté sur l’assassinat de JFK, nombreux ont conclu que ces événements avaient relevé d’un coup d’État politique, dont la réalité avait été dissimulée par les médias des États-Unis, et je pense que l’on peut en dire autant de la dépose de Richard Nixon dix années plus tard, même si ce second coup d’État fut cette fois silencieux, et mené suivant des méthodes judiciaires.
J’ai commencé cet article en citant plusieurs paragraphes que j’avais publiés il y a presque exactement six ans, en insistant que jusqu’il y a une dizaine d’années, j’avais considéré l’histoire moderne des États-Unis comme trop insipide et ennuyeuse pour qu’on s’y intéresse, en contraste absolu avec les coups d’État politiques et les assassinats des empires romain et hellénistique. Bien que de nombreux décès très suspects de personnalités importantes des États-Unis se soient produits au plus près de l’assassinat de JFK en 1963, une suite encore plus remarquable de morts tout aussi mystérieuse s’était produite peu après la fin de la seconde guerre mondiale, et j’ai couvert ce sujet dans ce précédent article.
Parmi ceux qui deviennent sceptiques à l’égard des verdicts des médias de l’establishment, il y a une tendance naturelle à devenir trop soupçonneux et à voir des complots et des camouflages là où il n’en existe pas. La mort subite d’une personnalité politique de premier plan peut être imputée à un acte criminel, même si les causes étaient entièrement naturelles ou accidentelles. « Parfois, un cigare n’est qu’un cigare. » Mais lorsqu’un nombre suffisant de ces personnes décèdent dans un laps de temps suffisamment court, et que des preuves accablantes suggèrent qu’au moins certains de ces décès n’ont pas eu lieu pour les raisons longtemps considérées, le fardeau de la preuve commence à se déplacer…
Je ne pense pas qu’une liste semblable de personnes comparables pourrait être produite pour la Grande-Bretagne, la France, l’URSS ou la Chine au cours de cette même période. Dans l’un des films de James Bond, l’agent 007 affirme que « Une fois est hasard, deux fois est coïncidence, trois fois est action ennemie. » Et je pense que ces six exemples en quelques années devraient suffire à faire sourciller même les plus prudents et les plus sceptiques.
Les dirigeants étrangers indignés par les gaffes internationales destructrices de l’Amérique ont parfois décrit notre pays comme possédant une puissance physique énorme, mais ayant une élite politique dirigeante si ignorante, crédule et incompétente qu’elle tombe facilement sous l’influence de puissances étrangères sans scrupules. Nous sommes une nation avec le corps d’un dinosaure mais contrôlé par le cerveau d’une puce.
L’après-guerre des années 1940 a certainement marqué un sommet important de la puissance militaire et économique de l’Amérique. Pourtant, il semble qu’au cours de ces mêmes années, un mélange varié d’assassins soviétiques, britanniques et sionistes ait pu librement marcher sur notre sol, terrassant ceux qu’ils considéraient comme des obstacles à leurs intérêts nationaux. Pendant ce temps, presque tous les Américains sont restés béatement inconscients de ces développements importants, se laissant bercer par « notre Pravda américaine« .
- La Pravda américaine. Notre monde implacable autour des politiques d’après-guerre
Ron Unz • The Unz Review • 2 juillet 2018 • 5,700 mots
Traduit par José Martí pour le Saker Francophone
