
Par Ron Unz — Le 5 décembre 2022 — Source unz.com
 L’Edward Gibbon du mouvement conservateur
L’Edward Gibbon du mouvement conservateur
Dans mes jeunes années, le livre Histoire de la décadence et de la chute de l’Empire romain, écrit par Edward Gibbon, était synonyme d’importantes histoires.
Je ne l’avais jamais lu, ni ne connaissais quiconque l’ayant lu, mais ce célèbre ouvrage constitué de six volumes, écrit au XVIIIème siècle, était presque synonyme d’une très grande longueur, même si les presque 4000 pages du livre ne semblaient guère excessives : il racontait l’histoire du plus grand Empire que l’Europe ait jamais connu. De fait, j’ai découvert récemment sur Internet que plus de la moitié de l’ouvrage est consacrée à des événements qui se sont produits longtemps après la chute traditionnelle de Rome, en 476 après J. C., comme les conquêtes islamiques, l’ascension de l’Empire mongol, et les histoires des Byzantins et des Turcs qui se sont étalées jusqu’en 1590. C’est donc environ 1700 pages qui sont consacrées à l’Empire dirigé par Rome.
À notre époque contemporaine, l’historien Rick Perlstein a œuvré à produire une tétralogie d’un poids similaire, documentant la montée du mouvement conservateur moderne jusqu’à l’élection de Ronald Reagan en 1980. Chacun de ses quatre volumes est de taille à caler une porte, et si l’on compte les notes, l’ouvrage entier s’étale bien au-delà des 3500 pages. En 2002, l’un de ses premiers critiques l’avait salué comme Hérodote de la Droite étasunienne moderne, mais peut-être le qualifier de Gibbon de ce mouvement aurait-il été plus exact. De fait, à de nombreux égards, les recherches et les écrits de Perlstein feraient honte à son illustre prédécesseur britannique, si l’on considère qu’il consacre un nombre de pages de recherches approfondies deux fois plus grand à deux décennies d’un mouvement idéologique étasunien passager que Gibbon n’en utilisât pour décrire la période de cinq siècles du légendaire Empire des César.
À partir de 2001, j’ai lu avec application les critiques, le plus souvent ardentes, de l’opus de Perlstein au fur et à mesure que les volumes qu’il produisait paraissait, et la plupart de ces livres trônent dans ma bibliothèque depuis quelques années. Même en laissant de côté l’histoire des conservateurs étasuniens, les années entre 1960 et 1980 ont figuré parmi les plus tumultueuses de notre histoire, qui a connu la crise des missiles de Cuba, l’assassinat de Kennedy, la guerre du Vietnam, les soulèvements raciaux des années 1960 et le Watergate. Il y a quelques mois, j’ai donc fini par décider de m’attaquer à ses livres, dans l’espoir de combler les vastes lacunes de mes propres connaissances de l’histoire politique moderne des États-Unis, et ce projet de lecture a absorbé trois semaines de mon temps environ.
Le premier livre de la suite produite par Perlstein relate la montée du sénateur Barry Goldwater, icône conservatrice, de la fin des années 1950 à sa défaite tonitru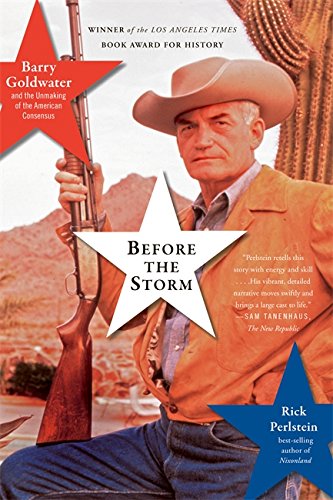 ante face au président Lyndon Johnson en 1964, et couvre également les élections très serrées qui virent s’opposer Kennedy et Nixon en 1960. Bien que Before the Storm reste de loin le volume le plus court, il n’en contient pas moins presque 700 pages, dont 150 pages de notes et d’index, et il a fait l’objet de critiques extrêmement favorables aussi bien de la Gauche que de la Droite, remportant le Los Angeles Times Book Prize for History et consacrant la réputation de son auteur. Des conservateurs de premiers plan ont exprimé leur stupéfaction qu’un auteur aux tendances démocrate-socialistes auto proclamées ait pu traiter leur propre mouvement avec une justesse aussi scrupuleuse et ait même pu dévoiler un si grand nombre de détails historiques qui leurs étaient jusqu’alors restés inconnus. L’édition de poche dont je dispose avait été publiée par Nation books, et exposait une notice publicitaire écrite par William Rusher, l’ancien éditeur de National Review, ainsi que de nombreux autres hommages en provenance des deux ailes idéologiques.
ante face au président Lyndon Johnson en 1964, et couvre également les élections très serrées qui virent s’opposer Kennedy et Nixon en 1960. Bien que Before the Storm reste de loin le volume le plus court, il n’en contient pas moins presque 700 pages, dont 150 pages de notes et d’index, et il a fait l’objet de critiques extrêmement favorables aussi bien de la Gauche que de la Droite, remportant le Los Angeles Times Book Prize for History et consacrant la réputation de son auteur. Des conservateurs de premiers plan ont exprimé leur stupéfaction qu’un auteur aux tendances démocrate-socialistes auto proclamées ait pu traiter leur propre mouvement avec une justesse aussi scrupuleuse et ait même pu dévoiler un si grand nombre de détails historiques qui leurs étaient jusqu’alors restés inconnus. L’édition de poche dont je dispose avait été publiée par Nation books, et exposait une notice publicitaire écrite par William Rusher, l’ancien éditeur de National Review, ainsi que de nombreux autres hommages en provenance des deux ailes idéologiques.
Puis, Nixonland est paru en 2008, couvrant la résurrection politique et la présidence de cette figure emblématique jusqu’à la fin de la guerre du Vietnam en 1973 ; suivi de The Invisible Bridge en 2014, relatant la chute de Nixon, la présidence Ford, et l’ascension de Ronald Reagan, ainsi que sa tentative échouée de déchoir un président en exercice durant les primaires républicaines de 1976 ; ainsi que Reaganland, paru en 2020, qui décrit la montée et la présidence de Jimmy Carter, et qui prend fin avec son échec face à Reagan en 1980. Chacun de ces volumes successifs est plus long que le précédent, alors qu’il couvre parfois une période de temps plus réduite. Et bien que les réactions se soient faites un peu moins radieuses — de nombreux conservateurs du mouvement dominant ont mal reçu certaines des remarques négatives formulées par Perlstein sur Reagan, qui reste pour eux une idole — le verdict d’ensemble dans les plus de vingt critiques que j’ai pu lire restait très nettement positif.
Je connaissais déjà les contours généraux cette histoire, pour avoir suivi personnellement la vie politique étasunienne depuis la fin des années Ford, mais j’ai découvert grâce à ces ouvrages un grand nombre d’éléments importants qui m’étaient alors restés inconnus. Les deux décennies qui ont culminé avec les élections de 1980 auront constitué une période turbulente de la vie politique des États-Unis, avec les carrières de Goldwater, Nixon et Reagan qui façonnèrent le Parti républicain et l’ensemble de notre nation, et les trois semaines que j’ai investies ont fortement multiplié mes connaissances sur cette époque. Que l’on s’accorde ou non avec les interprétations de Perlstein, la richesse des informations qu’il apporte au fil de ses milliers de pages apparaît comme une ressource inestimable pour quiconque s’intéresse à l’histoire des États-Unis, et je recommande fortement la lecture de ses livres.
Certains angles de vue ressortent de tout cela. Depuis l’époque du New Deal de 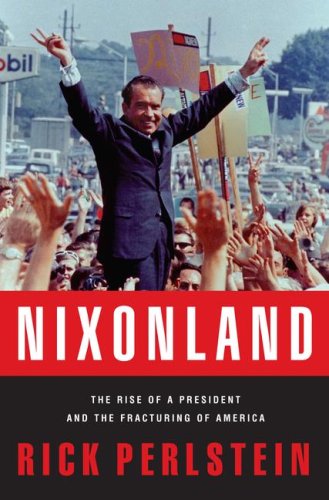 Franklin Delano Roosevelt dans les années 1930, les ethnies urbaines blanches — Irlandais, Italiens et Slaves — avaient constitué un composant central de la coalition dominante du Parti démocrate, mais à partir de la fin des années 1960, la montée du crime et des troubles sociaux dans nos centres urbains a commencé à les refouler, et cela a contribué à l’énorme phénomène de la réélection de Nixon en 1972, ainsi qu’au triomphe de Reagan en 1980. J’avais certes connaissance de ces éléments, mais les recherches menées par Perlstein montrent que surtout durant la période couverte par Reaganland, les élites qui régnaient sur le Parti démocrate ne parvenaient pas à croire ce qui se passait ; elles échouaient à comprendre que la base de leur pouvoir politique, jadis solide, était en train de glisser pour de bon hors de leur portée, alors que les Républicains eux-mêmes ne parvenaient que poussivement à tirer parti de cette opportunité. J’ai lu ces passages durant les dernières phases des élections de mi-mandat en 2022, et j’ai noté les parallèles étranges avec les phénomènes en cours chez les électeurs étasuniens hispaniques ou asiatiques, comme j’en ai récemment discuté dans un article.
Franklin Delano Roosevelt dans les années 1930, les ethnies urbaines blanches — Irlandais, Italiens et Slaves — avaient constitué un composant central de la coalition dominante du Parti démocrate, mais à partir de la fin des années 1960, la montée du crime et des troubles sociaux dans nos centres urbains a commencé à les refouler, et cela a contribué à l’énorme phénomène de la réélection de Nixon en 1972, ainsi qu’au triomphe de Reagan en 1980. J’avais certes connaissance de ces éléments, mais les recherches menées par Perlstein montrent que surtout durant la période couverte par Reaganland, les élites qui régnaient sur le Parti démocrate ne parvenaient pas à croire ce qui se passait ; elles échouaient à comprendre que la base de leur pouvoir politique, jadis solide, était en train de glisser pour de bon hors de leur portée, alors que les Républicains eux-mêmes ne parvenaient que poussivement à tirer parti de cette opportunité. J’ai lu ces passages durant les dernières phases des élections de mi-mandat en 2022, et j’ai noté les parallèles étranges avec les phénomènes en cours chez les électeurs étasuniens hispaniques ou asiatiques, comme j’en ai récemment discuté dans un article.
Un bon exemple de cette situation s’est produit à Boston, le fief des Kennedy qui resta longtemps une place forte pour les Démocrates, lorsque les transports en bus contraints des étudiants de l’école publique entre les quartiers irlandais et les quartiers noirs déclenchèrent une révolte politique de la part des Irlandais, menés par Louise Day Hicks, membre du conseil d’administration d’une école. J’avais toujours vaguement supposé que Hicks était une vague fauteuse de troubles, la George Wallace du Boston irlandais, mais selon Perlstein, il s’agissait d’« une dame distinguée, » qui ne fit que se lever avec ses concitoyens outragés, et malgré les rudes attaques menées par les médias nationaux, elle fut rapidement à deux doigts de destituer le maire démocrate sortant de sa ville en présentant sa propre candidature sur un programme opposé aux bus de transport scolaire.
Les recherches étendues menées par Perlstein m’ont ainsi permis de rencontrer un 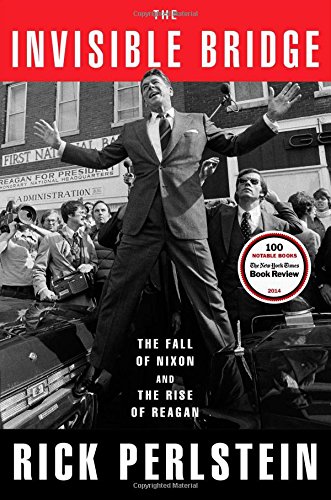 grand nombre de vignettes politiques fascinantes qui m’étaient jusqu’alors inconnues. Par exemple, je n’avais jamais réalisé que Phyllis Schlafly — bien que disposant d’une bonne éducation et bien qu’engagée politiquement — avait été une femme au foyer de l’Illinois, qui élevait cinq enfants et qui était enceinte de son sixième, lorsque la campagne de Goldwater lui avait inspiré de publier par ses propres soins son propre livre ; et sans disposer de la moindre publicité, ni contacter la moindre librairie, plus de 600 000 exemplaires d’A Choice Not an Echo se retrouvèrent en circulation au moment de la convention républicaine de 1964. Avec un lancement aussi puissant, elle devint bientôt une figure influente de la Droite républicaine, et joua un rôle central dans la défaite totalement inattendue de l’amendement Equal Rights féministe durant les années 1970. Perlstein affirme même qu’elle était « peut-être devenue l’organisatrice politique la plus efficace que la Droite ait jamais connue. »
grand nombre de vignettes politiques fascinantes qui m’étaient jusqu’alors inconnues. Par exemple, je n’avais jamais réalisé que Phyllis Schlafly — bien que disposant d’une bonne éducation et bien qu’engagée politiquement — avait été une femme au foyer de l’Illinois, qui élevait cinq enfants et qui était enceinte de son sixième, lorsque la campagne de Goldwater lui avait inspiré de publier par ses propres soins son propre livre ; et sans disposer de la moindre publicité, ni contacter la moindre librairie, plus de 600 000 exemplaires d’A Choice Not an Echo se retrouvèrent en circulation au moment de la convention républicaine de 1964. Avec un lancement aussi puissant, elle devint bientôt une figure influente de la Droite républicaine, et joua un rôle central dans la défaite totalement inattendue de l’amendement Equal Rights féministe durant les années 1970. Perlstein affirme même qu’elle était « peut-être devenue l’organisatrice politique la plus efficace que la Droite ait jamais connue. »
J’avais vaguement eu vent que la chanteuse Anita Bryant avait mené une campagne pour abroger une ordonnance sur les droits homosexuels durant les années 1970, mais je n’avais pas réalisé qu’elle l’avait emporté par un vote écrasant de presque 70% dans le comté libéral de Dade, malgré des ressources financières et politiques écrasantes en face d’elle. Qui plus est, sa victoire de 1977 a rapidement inspiré une suite de mesures d’imitations l’année suivante dans des villes très libérales comme St. Paul, dans le Minnesota ou Eugene, dans l’Oregon, qui furent le théâtre de victoires similaires à 2 voix contre 1 en face d’adversaires du même calibre, et elle faillit être élue vice-présidente de l’énorme convention baptiste du Sud. Ce schéma de victoires conservatrices fut finalement rompu lorsque ses alliés surjouèrent leur main, et que l’Initiative Briggs, nettement plus intrusive, fut mise au vote en Californie par un Sénateur de l’État qui espérait surfer sur la vague pour devenir gouverneur ; en dépit de sa forte avance dans les premiers sondages, l’ancien gouverneur Reagan se persuada de s’élever contre lui, et de nombreux autres conservateurs suivirent bientôt, si bien qu’il perdit dans les grandes longueurs.
J’avais toujours eu en mémoire que le discours du « Malaise » pronon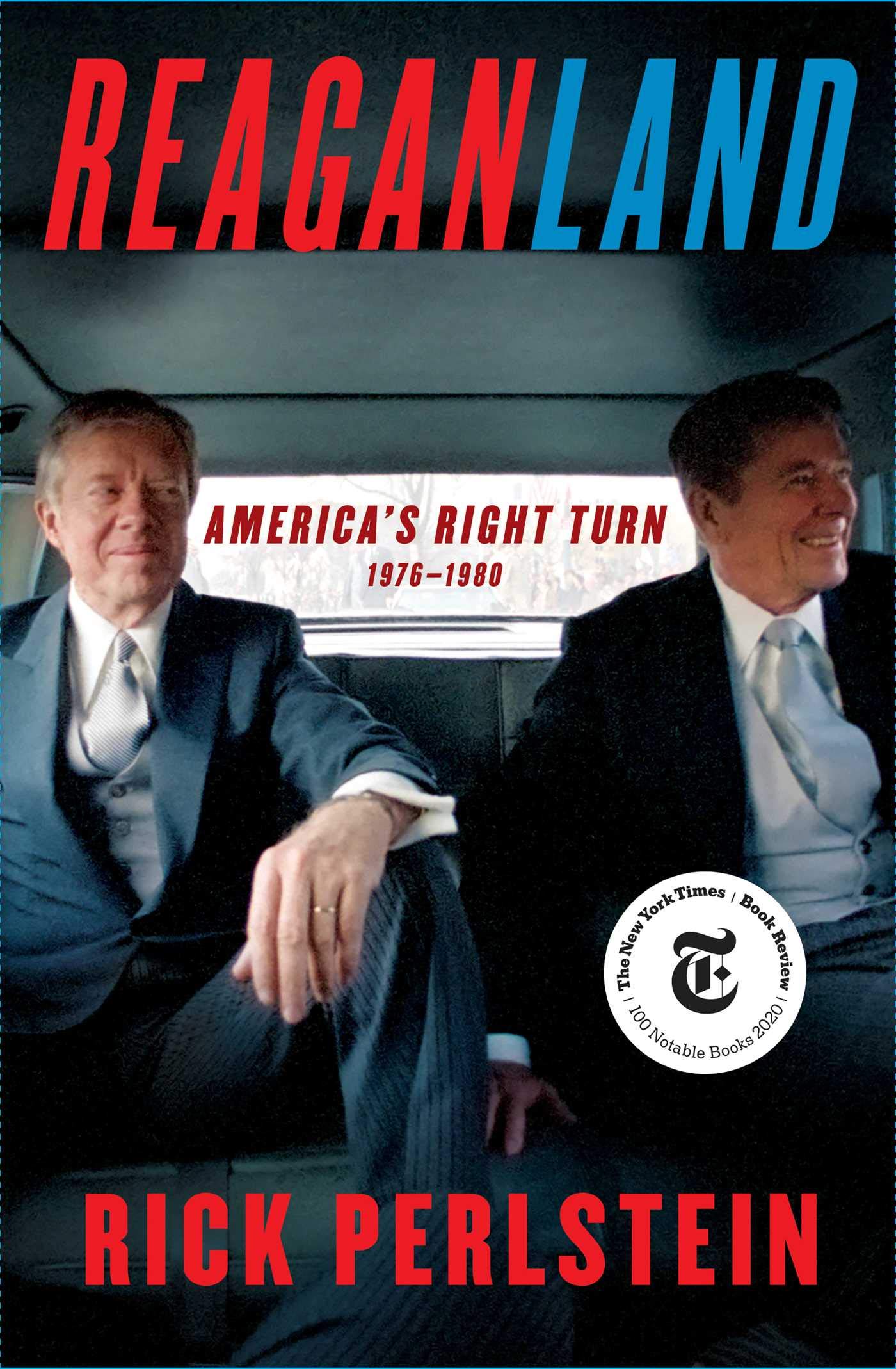 cé en 1979 par Jimmy Carter sur la crise énergétique avait constitué un désastre politique qui avait contribué à plomber ses chances de réélection l’année suivante. Mais ce n’est pas ce qu’affirme Perlstein, qui note dans Reaganland que son allocution nationale avait en réalité produit une montée sans précédent de soutien dans le public, si bien qu’un sondage vit son taux d’approbation monter de 11 points, et un autre de 17 points, avant que l’erreur désastreuse qu’il commit en renvoyant son Cabinet détruisît son prestige.
cé en 1979 par Jimmy Carter sur la crise énergétique avait constitué un désastre politique qui avait contribué à plomber ses chances de réélection l’année suivante. Mais ce n’est pas ce qu’affirme Perlstein, qui note dans Reaganland que son allocution nationale avait en réalité produit une montée sans précédent de soutien dans le public, si bien qu’un sondage vit son taux d’approbation monter de 11 points, et un autre de 17 points, avant que l’erreur désastreuse qu’il commit en renvoyant son Cabinet détruisît son prestige.
Ce même volume se clôture sur le triomphe de Ronald Reagan durant les élections de 1980, et l’auteur apporte ce passage frappant qui décrit le chef de file reconnu par tous durant les primaires républicaines qui se tinrent l’année précédente :
Les hommes qui se levaient pour défier Jimmy Carter ne ressemblaient en général pas à des super héros. La plupart étaient tristement fades. C’est alors, sans surprise, que le premier à sortir du lot fut le plus charismatique du lot — qui avait quasiment le commandement tatoué sur le front.
On l’a souvent photographié dans son ranch, montant un cheval. Il avait connu une enfance pauvre dans l’arrière-pays, était devenu quelqu’un qui comptait sur le campus de son université, avait suivi un test de sélection de Hollywood au plus haut de la Dépression, et avait été gouverneur dans la Sun Belt florissante. Il apparaissait exactement comme ce que désirait une nation déprimée comme président — et la distance qu’il maintenait vis-à-vis de Washington, qu’il considérait comme une « jungle », y était pour beaucoup.
Les éditeurs envoyèrent des journalistes le capturer pour le compte de leurs lecteurs, et les portraits succédèrent aux portraits, qui s’avérèrent être tous les mêmes. Ils parlaient de sa « calèche » et de la manière dont il conservait « absolument toujours le contrôle absolu de lui-même. » De la manière suivant laquelle il disposait d’un « contrôle d’acteur sur son corps, », et n’était « jamais à court de personnage. » (« Même à bord d’un avion ou d’une automobile, il se tient tellement droit qu’il ressemble à un de ces faux passagers gonflables que l’on utilise dans les tests de sécurité. ») Les producteurs de publicités télévisée l’admiraient tout particulièrement. Dans son mémoire dédié à la campagne de 1976, Mal MacDougall, publicitaire de Gerald Ford, parla de diffuser une publicité pour Ford mettant en scène ce spécimen exemplaire à l’essai durant une kermesse de l’État. La première prise fut quasiment parfaite — en dehors du fait qu’elle durait quatre secondes de trop sur le temps prévu. Douglass proposa de couper quelques mots du script.
« Non, » répondit l’acteur. « Je vais juste accélérer ma voix traînante. »
Le directeur lança le mot « Action! » L’acteur récita son texte en précisément quatre secondes de moins. MacDougall a noté son admiration face à sa belle allure, « ce visage texan bronzé, les cheveux d’argent, la chemise blanche immaculée. »
Cet homme n’était pas Ronald Reagan. C’était John Connolly, du Texas.
Bien qu’à l’époque je suivisse déjà la politique, je n’avais jamais réalisé que la plupart des experts politiques avisés estimaient que John Connolly, le Démocrate devenu Républicain et protégé de Nixon, allait devenir le candidat républicain pour 1980, tout en écartant les chances de Reagan en raison de son âge ; il devenait un has-been républicain. En partie pour cette raison, Connolly leva des financements jusqu’alors sans précédent, à hauteur de 11 millions de dollars, mais il ne finit par obtenir qu’un seul délégué, et Perlstein raconte l’histoire saisissante de ce désastre politique épique.
Paranoïa conservatrice et espions communistes
Perlstein a dévolu quelque chose comme un quart de siècle à rechercher et à documenter dans le détail une période un peu plus courte de l’histoire politique des États-Unis, et bien que son analyse des événements puisse sans aucun doute être remise en question, le récit massif qu’il apporte va sans doute constituer le point de départ pour qui à l’avenir voudra recapturer le sens de cette période.
Nos médias créent une réalité populaire, et dans un éditorial publié par la suite, Perlstein a expliqué que pour comprendre correctement la manière dont les Étasuniens de cette ère envisageaient le monde et ses politiques, il avait voyagé sur des milliers de kilomètres pour visiter des centres d’archives vidéos nationales, puis avait passé des centaines d’heures à regarder les émissions télévisées qui façonnaient les perceptions populaires, comme tous les journaux télévisés faisant mention de Ronald Reagan entre 1967 et 1975 ; il a également lu un nombre colossal de récits publiés dans les journaux de l’époque, désormais disponibles en ligne grâce à Google. La rigueur de son projet ne sera probablement jamais égalée, et je n’ai remarqué que des erreurs minimes, comme lorsqu’il identifie à tort l’ancien chef de la police de Los Angeles, Ed Davis, comme Sheriff du comté de Los Angeles, dans son volume Reaganland. Je n’ai aucune raison de douter que les contenus factuels qu’il avance soient corrects à au moins 99,9 %.
Mais il est tout aussi facile de fausser l’histoire en excluant ou en minimisant certains faits suffisamment importants, qu’en représentant d’autres faits de manière incorrecte, et sur ce plan, j’ai remarqué de graves problèmes dans le travail extrêmement détaillé de Perlstein dès mon premier examen, des problèmes que j’ai également trouvés dans tous ses autres volumes. Peut-être du fait de ses techniques de recherche, l’auteur a produit un récit correspondant au « consensus médiatique » de l’histoire politique étasunienne, qui semble laisser de côté les éléments ignorés par les médias à l’époque, sauf lorsqu’ils ont été ressuscités et élevés dans le consensus médiatique révisé existant de nos jours.
Cette approche peut expliquer correctement ce que la plupart des Étasuniens de l’époque croyaient, ou ce qu’ils croient aujourd’hui sur ce passé, mais parfois, la réalité véritable de ce qui s’est produit diffère de ces croyances de manière stupéfiante. Chose intéressante, aucune des dizaines de critiques majeures que j’ai lu ne fait état de l’un ou l’autre de ces problèmes, sans doute parce que tous les critiques, fussent-ils de gauche ou de droite, favorables ou critiques, restaient liés par les limitations du même consensus médiatique que Perlstein lui-même.
Ces énormes trous béants me sont apparus sur-le-champ dès les toutes premières pages de son premier volume sur Goldwater, qui a fait l’objet d’éloges universels. Son récit dans cet ouvrage fait état du début du mouvement conservateur étasunien dans les années 1950, qui finit par amener au phénomène Goldwater, qui plongeait certaines de ses principales racines dans la paranoïa irrationnelle ressentie par nombre de ses figures dirigeantes, qui s’étaient alarmés suite aux actions antérieures menées par l’Administration Roosevelt, et vivaient dans une peur mortelle des conspirations communistes fantômes durant les années 1950.
Pourtant, à peu près au moment où Perlstein entamait ses recherches historiques, la déclassification des Venona Papers avait déclenché une avalanche de livres écrits par des universitaires éminents, qui était venu confirmer les affirmations des conservateurs si joyeusement écartées par Perlstein. En 2018, j’ai résumé certains des problèmes que j’avais découverts, y compris une critique sévère du refus manifesté par Perlstein de reconnaître ces réalités importantes :
J’ai bientôt lu trois ou quatre livres sur le scandale Venona et j’ai été très impressionné par leur analyse universitaire,
objective et méticuleuse, ce qui m’a convaincu de la justesse de leurs conclusions. Et les implications en étaient tout à fait remarquables, et très sous-estimées dans la plupart des articles que j’avais pu lire.
Prenons par exemple le nom de Harry Dexter White, sans doute inconnu de l’écrasante majorité des Étasuniens vivant actuellement, et dont les Venona Papers ont prouvé qu’il fut un agent soviétique. Durant les années 1940, son poste officiel le désignait simplement comme l’un des assistants au Secrétaire au Trésor, travaillant sous l’autorité de Henry Morgenthau Jr., un membre influent du cabinet de Franklin Roosevelt. Mais Morgenthau était en réalité un gentleman-farmer, qui ne savait à peu près rien en matière de finance, et qui avait surtout été nommé à ce poste parce qu’il possédait la maison voisine de celle de FDR, et selon de nombreuses sources, c’était en réalité White qui faisait tourner le département du Trésor, sous l’autorité titulaire de Morgenthau. Ainsi, ce fut White qui négocia en 1944 avec John Maynard Keynes — l’économiste le plus imposant de Grande-Bretagne — pour établir les bases de l’accord de Bretton Woods, du FMI, et des autres institutions économiques occidentales de l’après-guerre.
En outre, à la fin de la guerre, White avait réussi à profondément étendre le pouvoir du Trésor — et donc de sa propre zone de contrôle — dans ce qui aurait normalement du relever du Département d’État, surtout au sujet des politiques relatives à l’adversaire allemand vaincu.
De l’enchaînement particulier de certains événements peut en découler une influence colossale sur les trajectoires historiques. Prenons la figure de Henry Wallace, dont on se souvient sans doute vaguement comme ayant été un des principaux Démocrates orientés vers la gauche des années 1930 et 1940. Issu du Midwest, Wallace s’était illustré comme jeune prodige en matière d’innovation agricole, et il avait été recruté dans le premier cabinet de FDR en 1933 comme secrétaire à l’Agriculture. De l’avis général, Wallace était à 100% un véritable patriote étasunien, qui n’avait aucun indice de la moindre activité néfaste mise au jour par les Venona Papers. Mais comme cela arrive parfois avec les experts techniques, il semble s’être montré remarquablement naïf en dehors de son propre champ de connaissances, particulièrement dans son extrême mysticisme religieux, et chose plus importante, dans les politiques qu’il décida, et un grand nombre de ses collaborateurs les plus proches se sont avérés être des agents soviétiques, qui le considéraient sans doute comme l’homme de paille idéal pour mener leurs propres intrigues politiques.
Depuis George Washington, aucun président étasunien ne s’était jamais présenté à un troisième mandat consécutif, et lorsque FDR décida subitement de le faire courant 1940, en utilisant notamment la guerre en Europe comme excuse, de nombreuses figures de premier plan du Parti démocrate — dont notablement son vice-président depuis 8 ans, John Nance Garner, qui avait été le porte-parole démocrate de la Chambre, ainsi que James Farley, le puissant dirigeant du parti qui avait au départ contribué à élever Roosevelt jusqu’à la présidence — lancèrent une rébellion politique. FDR choisit Wallace comme vice-président pour son troisième mandat, peut-être dans l’objectif d’obtenir le soutien de la puissante faction pro-soviétique qui existait au sein des Démocrates. Mais il s’ensuivit, alors même que l’état de santé de FDR se détériora continûment durant les quatre années qui suivirent, qu’un personnage dont les conseillers les plus proches étaient des agents de Staline, fut à deux doigts d’occuper la présidence des États-Unis.
Sous la forte pression des dirigeants du parti démocrate, Wallace fut remplacé pour la candidature du quatrième mandat de FDR durant la convention démocrate du mois de juillet 1944, et ce fut Harry S Truman qui prit la succession de la présidence à la mort de FDR au mois d’avril suivant. Mais si Wallace n’avait pas été remplacé, ou si Roosevelt était mort un an plus tôt, les conséquences pour le pays auraient certainement été énormes. Selon des affirmations énoncées par la suite, l’administration Wallace aurait intégré Laurence Duggan comme Secrétaire d’État, Harry Dexter White comme responsable du Trésor, et sans doute divers autres agents soviétiques pur jus à tous les postes clés de la direction du gouvernement fédéral des États-Unis. On pourrait s’amuser à imaginer que les Rosenberg — qui furent par la suite exécutés pour trahison — auraient pu être chargés de notre programme de développement d’armes nucléaires.
Il s’est trouvé que Roosevelt vécut jusqu’en 1945, et qu’au lieu de diriger le gouvernement des États-Unis pour le compte de Staline, Duggan et White connurent tous deux une fin subite sur un intervalle de temps assez bref après qu’on se mit à les soupçonner, en 1948. Mais les ramifications du contrôle soviétique au début des années 1940 étaient remarquablement profondes.
Comme exemple frappant, des agents soviétiques eurent vent du projet de déchiffrement Venona en 1944, et peu de temps après, une directive fut émise par la Maison-Blanche, ordonnant l’abandon du projet et la destruction des fichiers concernant l’espionnage soviétique. La seule raison de la survie de Venona, qui nous a permis par la suite de reconstruire les politiques funestes de l’époque, fut que l’officier militaire responsable prit le risque d’encourir la cour martiale, en ignorant purement et simplement cet ordre présidentiel explicite.
À la suite des Venona Papers publiés publiquement il y a vingt-cinq ans et désormais acceptés par à peu près tout le monde, il semble irréfutable qu’au début des années 1940, le gouvernement national des États-Unis passa à un cheveu — ou à un battement de cœur — de tomber sous le contrôle d’un réseau étroit d’agents soviétiques. Pourtant, je n’ai que très rarement vu ce très simple fait souligné dans un livre ou dans un article, alors que cela contribue sans doute à expliquer les racines idéologiques de la « paranoïa anti-communiste » qui était devenue au début des années 1950 une force politique si puissante.
De toute évidence, le communisme ne disposait que de racines très superficielles dans la société étasunienne, et une administration Wallace dominée par les Soviétiques en 1943 ou 1944 aurait sans doute tôt ou tard été balayée du pouvoir, peut-être par le premier coup d’État militaire des États-Unis.
Mais au vu de la fragilité de l’état de santé de FDR, cette possibilité passagère devrait sans aucun doute être mentionnée régulièrement dans les discussions concernant cette époque.
Si des sujets historiques importants sont exclus des médias, la nouvelle génération d’universitaires peut se former sans jamais les connaître, et l’historiographie qu’elle finira par produire avec les meilleures intentions pourra contenir des lacunes énormes. Prenons par exemple les volumes d’histoire politique récompensés par des prix que Rick Perlstein a écrits depuis 2001, retraçant l’ascension du conservatisme étasunien de l’ère d’avant Goldwater jusqu’à la montée au pouvoir de Reagan dans les années 1970. Cette suite a reçu des louanges, à juste titre, pour l’énorme attention qu’elle porte aux détails, mais selon les index, le total combiné des presque 2400 pages ne contient que deux mentions rapides et totalement méprisantes de Harry Dexter White au tout début du premier volume, et aucune mention d’aucune sorte de Laurence Duggan, ou encore, chose plus choquante encore, aucune mention de « Venona ». Il m’est arrivé de blaguer en disant qu’écrire une histoire du conservatisme étasunien de l’après-guerre sans s’intéresser à des éléments aussi centraux est aussi pertinent qu’écrire une histoire de l’entrée des États-Unis dans la seconde guerre mondiale sans faire mention de Pearl Harbor.
La réalité irréfutable est qu’au cours de la décennie ayant précédé le début du récit de Perlstein, un réseau d’agents staliniens a bien failli s’emparer du contrôle du gouvernement fédéral des États-Unis. Ces faits ont été totalement ignorés par les médias dominants de l’époque, et restent tout aussi ignorés de nos jours, et Perlstein, tout comme la plupart de ses critiques, semblent parfaitement les ignorer, ou du moins prétendre ne rien en connaître. Mais les activistes conservateurs pensaient, ou soupçonnaient à tout le moins, que ces agents étaient les premiers protagonistes du récit exposé par Perlstein, et cela a sans doute contribué à expliquer leur apparente « paranoïa ».
Comme j’en ai fait mention dans le même article de 2018, l’histoire de l’Empire romain fut emplie d’événements dramatiques et conspirationnistes, et j’avais toujours supposé naïvement que notre histoire récente était quant à elle exempte de tels événements, et c’est pour cette raison que je trouvais que ce sujet était nettement moins palpitant :
Cependant, je ne me suis jamais intéressé à l’histoire américaine du XXe siècle. D’une part, il m’a semblé si évident que tous les faits politiques fondamentaux étaient déjà bien connus et commodément fournis dans les pages de mes manuels d’introduction à l’histoire, laissant ainsi peu de place à une recherche originale, sauf dans les recoins les plus obscurs.
De plus, la politique de l’Antiquité était souvent colorée et excitante, les dirigeants hellénistes et romains étant si souvent renversés par des coups d’État ou victimes d’assassinats, d’empoisonnements ou d’autres morts prématurées d’une nature hautement suspecte. En revanche, l’histoire politique américaine était remarquablement fade et ennuyeuse, dépourvue de tels événements extra-constitutionnels pour lui donner du piquant. Le bouleversement politique le plus dramatique de ma vie avait été la démission forcée du président Richard Nixon, menacé de destitution, et les causes de son départ de ses fonctions – certains petits abus de pouvoir et un camouflage ultérieur – étaient si clairement sans conséquence qu’elles affirmaient pleinement la force de notre démocratie américaine et le soin scrupuleux avec lequel nos médias surveillants ont contrôlé les actes des plus puissants eux-mêmes.
Avec le recul, j’aurais dû me demander si les coups d’État et les empoisonnements de l’époque impériale romaine avaient été relatés avec exactitude en leur temps, ou si la plupart des citoyens en toges de l’époque étaient totalement inconscients des événements abominables qui déterminaient secrètement la gouvernance de leur propre société.
- La Pravda américaine. Notre monde implacable autour des politiques d’après-guerre
Ron Unz • The Unz Review • 2 juillet 2018 • 5,700 mots
La célèbre œuvre historique de Gibbon aurait été nettement moins intéressante et moins percutante si tous ces développements dramatiques avaient été ôtés du texte. Et au fur et à mesure que je lisais avec attention les quatre volumes de Perlstein, j’ai peu à peu compris que s’il était le Gibbon de notre passé récent des États-Unis, son texte pourrait constituer un Gibbon fortement expurgé, excluant un grand nombre d’éléments susceptibles de remettre en question ou d’offenser le consensus médiatique établi. Les célébrités publient souvent des biographies « autorisées », et peut-être bien que les livres de Perlstein devraient être considérés comme l’histoire politique autorisée d’une importante période de deux décennies.
Le retour du Vietnam des prisonniers de guerre étasuniens
Je n’étais encore qu’un enfant lorsque la guerre du Vietnam a pris fin, et jusqu’il y a une dizaine d’années, je n’avais guère prêté attention à ce conflit. Cette guerre et l’usure qu’elle avait provoquée au sein de la population étasunienne ont constitué un élément majeur du second volume écrit par Perlstein, Nixonland, et ont fortement influencé l’effondrement politique de l’Administration Johnson et l’élection de Richard Nixon en 1968, qui a dès lors hérité d’un conflit qui ne semblait pouvoir être gagné mais dont il estimait qu’il constituerait un désastre pour le pays s’il se terminait par une défaite marquée des États-Unis.
Le nouveau président était confronté à un puissant mouvement anti-guerre qui avait déjà fait tomber son prédécesseur, et après des années de combats, rares étaient les Étasuniens à entretenir une idée claire des raisons de notre présence dans ce pays, la plupart de nos objectifs de guerre initiaux s’étant évaporés. Ainsi, selon le récit prodigué par Perlstein, la stratégie audacieuse mise en œuvre par Nixon fut de recentrer l’attention du public sur le triste destin des centaines de prisonniers de guerre étasuniens détenus par les Vietnamiens, suggérant que le véritable objectif de la poursuite de notre effort de guerre était de faire rentrer au pays les soldats qui s’étaient faits capturer tout en menant ce même combat. Bien que nos opposants vietnamiens affirmassent être tout à fait disposés à nous renvoyer ces hommes dans le cadre d’un accord de paix, une fois que nous aurions quitté leur territoire, Nixon suggéra le contraire de manière répétée, et en matière de politique, les émotions l’emportent souvent sur la logique, surtout lorsque les émotions sont soutenues par le contrôle du mégaphone médiatique.
Ce volume se clôture par l’éboulement provoqué par la réélection de Nixon en 1972, et The Invisible Bridge, publié en 2014, s’ouvre sur la signature de l’accord de paix. Un chapitre décrit le retour triomphal des prisonniers de guerre du Vietnam avec l’« Operation Homecoming, » et le plus gros d’un autre chapitre est également consacré à ce même sujet. Il est évident que Perlstein méprise profondément Nixon et la stratégie trompeuse et cynique déployée par ce dernier pour exploiter le sujet des prisonniers de guerre dans le seul but de surpasser ses opposants politiques, poursuivant ainsi une guerre qui aurait pu être terminée avec des accords similaires des années plus tôt, ce qui aurait sans doute préservé des dizaines de milliers de vies humaines ; et l’auteur se délecte manifestement de la transition de son récit vers le Watergate et la chute du président qui s’en est suivie. Mais le véritable récit de ce qui s’est produit est sans doute nettement plus sombre et nettement plus cynique que ce que notre « Hérodote hypercafféiné » pourrait reconnaître volontairement dans les pages de son histoire.
Comme le souligne Perlstein, à la fin de la guerre, Nixon avait réussi à définir comme objectif national dominant l’assurance du retour de tous nos prisonniers de guerre, et c’est le pays tout entier qui s’est félicité du triomphe de leur liberté retrouvé une fois que les avions les ramenant au pays commencèrent à atterrir, en 1973. Mais on dispose en réalité de preuves solides établissement que la moitié seulement des prisonniers de guerre ont été rapatriés, et que les autres ont passé le reste de leur vie dans une captivité misérable, cependant que Nixon et ses complices dissimulaient cette vérité pour revendiquer une victoire, sur fond de scandale du Watergate qui menaçait leur survie politique. Nos médias, aussi bien à l’époque qu’au cours des décennies qui ont suivi, se sont fait les complices absolus de ces mensonges, qui constituent l’un des incidents les plus honteux de toute l’histoire des États-Unis, et plutôt que de relater clairement cette histoire, Perlstein s’en tient au narratif officiel de cette dissimulation, sans jamais émettre un mot de doute, alors même que cela revient à protéger la réputation d’un président qu’il n’apprécie pas du tout.
Les faits remarquables étaient au départ apparus durant les élections présidentielles de 2008, mais n’avaient reçu que peu d’attention à l’époque. Mais en 2010, j’ai republié ces exposés saisissants comme pièce centrale de la couverture de mon propre magazine, American Conservative, introduit par un petit texte écrit de ma main, dont les passages qui suivent sont tirés :
Au cours des derniers jours de la campagne présidentielle de 2008, j’ai cliqué sur un lien ambigu sur un site web obscur, et je suis tombé dans un univers parallèle.
J’y ai trouvé des preuves nombreuses et détaillées établissant que des centaines de prisonniers de guerre étasuniens avaient été condamnés à mourir entre les mains ennemies par les hauts dirigeants des États-Unis, apparemment parce qu’assurer leur retour au pays aurait constitué un embarras politique majeur. J’ai trouvé de la documentation établissant que la dissimulation de cette trahison s’était poursuivie durant des décennies, et qu’elle avait fini par attirer un certain sénateur de l’Arizona. Selon sa remarquable reconstitution des événements, le cinéphile adolescent moyen des années 1980, qui regardait des films d’action abrutissants comme « Rambo », « Missing in Action » ou « Uncommon Valor » voyait la réalité dépeinte sur un écran, alors que l’expert en politique lisant des articles policés dans les pages de The New Republic et de The Atlantic absorbait mensonges et propagande. Comme j’avais lu et cru précisément ces articles, cette révélation m’a stupéfié.
Mais cette description alternative de la réalité était-elle correcte ? Se pouvait-il que ce seul article fût vrai, et que les innombrables articles affirmant le contraire, que j’avais lu dans les pages des publications les plus prestigieuses des États-Unis, fussent une simple répétition sans fin de la présentation offerte par la propagande officielle ? Je ne peux le dire. Je ne suis pas expert de l’histoire de la guerre du Vietnam et de ses suites.
Mais examinons les sources. L’auteur de ce remarquable exposé de 8000 mots — « McCain et la dissimulation des prisonniers de guerre, » publié sur le site web de The Nation Institute — était Sydney Schanberg, l’un des journalistes les plus connus à avoir couvert la guerre du Vietnam. Son travail lui a valu un prix Pulitzer, et le livre qu’il a ensuite publié sur le Cambodge fut transposé au cinéma avec « The Killing Fields, » un film récompensé aux Oscars. Schanberg a ensuite été l’un des éditeurs en chef les plus prisés du New York Times, et il eut sous sa responsabilité le tiers des reporters de notre journal national de référence. On peut soutenir qu’aucun journaliste étasunien vivant n’est plus crédible que lui pour écrire sur le sujet de la guerre du Vietnam. Et il avait travaillé des années durant à rechercher et à documenter dans le détail le récit des prisonniers de guerre étasuniens abandonnés en Indochine — un récit qui, s’il est vrai, pourrait facilement constituer l’action de déshonneur national la plus colossale jamais commise par nos dirigeants politiques.
Il a présenté une masse de preuves avec des noms, des dates et des détails documentés. Nombre des personnes auxquelles il fait mention sont toujours en vie, et l’on pourrait les interviewer ou les appeler à témoigner. On pourrait ordonner que des archives scellées du gouvernement soient ouvertes. Si les États-Unis décident de déterminer la vérité, ils peuvent le faire.
Mais ce que j’ai trouvé de plus remarquable avec l’essai produit par Schanberg ne réside pas dans ses affirmations historiques explosives : il s’agit du silence absolu avec lequel ces affirmations ont été reçues par les médias dominants. En 2008, le récit de guerre héroïque et le patriotisme manifesté par John McCain étaient des composants centraux de sa quête du pouvoir suprême — un objectif qu’il a été très proche d’atteindre. Mais lorsque l’un des journalistes les plus éminents des États-Unis a publié un rapport complet établissant que le candidat, loin de l’image qu’on se faisait de lui, avait été l’une des figures principales d’un acte de trahison nationale monumental, nos médias ne s’en sont pas inquiétés. Les critiques publiques de McCain et les acteurs de la campagne de son opposant démocrate se saisissaient avec ravissement de la moindre rumeur selon laquelle le sénateur avait déjeuné en privé avec un lobbyiste du monde privé aux pratiques plus que douteuses, mais ils ont ignoré les révélations documentées qui établissaient qu’il avait couvert le meurtre de centaines de prisonniers de guerre étasuniens. Ces allégations étaient assez graves et assez documentées pour obtenir une attention nationale — mais elles n’en reçurent aucune.
Et si les affirmations avancées par Schanberg sont bien exactes, elles révèlent les conséquences mortelles de la fierté nationale démesurée des États-Unis. Après tout, son récit est plutôt simple. En 1954, après la bataille de Dien Bien Phu, les Vietnamiens refusèrent de laisser partir leurs prisonniers de guerre français jusqu’à ce que Paris acceptât de verser une compensation financière pour la guerre. Les dirigeants français versèrent l’argent, et leurs hommes leurs furent rendus. De la même manière, les Vietnamiens ont refusé de laisser partir leurs prisonniers de guerre étasuniens tant que le gouvernement étasunien refuserait de leur verser des réparations. Nixon signa un document promettant précisément d’en verser, mais les Vietnamiens, en hommes prudents, conservèrent captifs un grand nombre de prisonniers de guerre dans l’attente du versement de l’argent. Le Congrès refusa alors d’autoriser de financer ces réparations, parce que « les États-Unis ne perdent pas les guerres. » Nixon et les dirigeants étasuniens qui l’ont suivi n’ont jamais reconnu le destin de ces captifs, de crainte de mettre en colère le peuple étasunien. Et au fil des années et des décennies, et alors que l’on examinait et rejetait des moyens de verser la rançon ou d’aller sauver les prisonniers de guerre, la poursuite de leur existence est devenue un boulet majeur pour de nombreuses figures politiques puissantes, dont les réputations auraient été détruites si le moindre prisonnier était rentré et avait raconté son histoire au peuple étasunien. Par conséquent, aucun d’entre eux n’est jamais rentré au pays.
- American Pravda: Was Rambo Right?
Ron Unz • The American Conservative • 25 mai 2010 • 1,300 Mots - John McCain and the POW Cover-Up
Sydney Schanberg • The American Conservative • 25 mai 2010 • 8,200 Mots - Silent Treatment
My Four-Decade Fight to Report the Truth
Sydney Schanberg • The American Conservative • 25 mai 2010 • 1,700 Mots - John McCain: son véritable bilan de guerre au Vietnam
Ron Unz • The Unz Review • 9 mars 2015 • 4,200 Mots - La Pravda américaine – L’héritage de Sydney Schanberg
Ron Unz • The Unz Review • 13 juillet 2016 • 3,500 Mots
Pour autant que je puisse en juger, presque aucun des éléments présentés dans les milliers de pages produites par Perlstein n’erre bien loin du récit médiatique conventionnel des événements décrits, même s’il les habille d’une énorme richesse de détails accumulés. Et peut-être que c’est ainsi que doivent être les choses, puisque intégrer des affirmations très contraires à l’orthodoxie ou choquantes aurait exigé une forte dose d’argumentation pour les soutenir, ce qui aurait perturbé l’afflux homogène qui caractérise son récit.
Nixonland avait été publié en 2008, et même dans le cas peu probable où Perlstein aurait été au courant des preuves solides concernant les prisonniers de guerre abandonnés, il aurait risqué sa réputation rien qu’en suggérant une telle possibilité, d’autant plus qu’elle était tangentielle à son récit. Au lieu de cela, il a très proprement centré son travail sur les tentatives réussies de Nixon à faire de la liberté des prisonniers de guerre le thème central de son plan de paix au Vietnam.
Mais The Invisible Bridge a été publié en 2014, et le journalisme emblématique de Schanberg avait été publié des années plus tôt, et avait reçu une attention considérable dans les cercles des médias alternatifs, si bien que le manque total de référence à ce sujet par Perlstein est nettement plus troublant. Peut-être s’explique-t-il par son refus d’abandonner complètement les hypothèses formulées dans son livre précédent. Je soupçonne qu’au moins certains des lecteurs ont dû porter par la suite ce sujet à son attention, car il a écrit l’année suivante pour le Washington Spectator un éditorial dénonçant les affirmations sur les prisonniers de guerre comme un bobard raciste et conspirationniste, promu par de cyniques politiques opportunistes. Schanberg fut l’un de nos journalistes les plus éminents sur la guerre du Vietnam, et est une personnalité aux sentiments libéraux les plus impeccables, si bien que ni son nom, ni les importantes recherches factuelles qu’il a menées, ne sont jamais mentionnés dans cet éditorial, qui a surtout régurgité l’analyse de l’auteur déjà parue dans Nixonland. Dans le même temps, Perlstein a lancé contre le film les critiques écrites par un professeur d’études culturelles, et Maoïste défroqué, qui était loin de présenter une stature comparable à celle de Schanberg, tout en citant comme « décisif » un livre plus récent écrit par un jeune universitaire dont les tentatives de démystification s’étaient contentées de faire fi de tous les éléments solides pointant dans une autre direction que la sienne.
- American Pravda: Relying Upon Maoist Professors of Cultural Studies
Ron Unz • The Unz Review • 18 juillet 2016 • 1,900 mots - American Pravda: Will There be a Spotlight Sequel to The Killing Fields?
Ron Unz • The Unz Review • 25 juillet 2016 • 2,700 mots
Les assassinats des Kennedy
Les prisonniers de guerre du Vietnam et les probables mensonges entourant leur retour sans encombre au pays sous Nixon sont discutés sur presque 100 pages des livres de Perlstein, et le traitement qu’il en fait suggère qu’il désire blanchir les crimes perfides d’un président qu’il déteste, pour éviter de remettre en question le narratif médiatique. Il ne s’agit pas ici d’une critique décisive de son ouvrage, étant donné que pratiquement tous les autres journalistes et universitaires inscrits dans le courant dominant en font autant, mais cela devrait nous alerter sur le caractère circonscrit de son projet, qui est très complet à certains égards, mais plutôt limité sur d’autres.
Et de fait, sur d’autres sujets importants, le silence relatif de Perlstein indique qu’il connaît probablement l’existence de certaines vérités dangereuses, mais qu’il a décidé de se protéger en évitant presque toute discussion à leur sujet.
L’événement qui a le plus marqué le XXème siècle restera peut-être l’assassinat du président John F. Kennedy en 1963. Cet assassinat s’est produit au plus haut de la prospérité et de la dominance mondiale des États-Unis, et a produit un traumatisme national qui a marqué de manière indélébile les mémoires de tous ceux qui l’ont vécu à l’époque. Le second assassinat de 1968, qui cibla son jeune frère Robert, eut également un impact colossal sur notre vie nationale, et il pava la voie de l’élection de Richard Nixon l’année suivante. Les assassinats des Kennedy jettent un voile très trouble sur la politique des États-Unis durant la période couverte par les volumes publiés par Perlstein, mais ils ne font l’objet de sa part que d’une attention minime.
Selon ses index, les deux meurtres sont mentionnés des dizaines de fois tout au long de ses quatre volumes, mais presque toutes ces mentions ne sont strictement que des références, et le traitement substantiel se résume simplement à quelques paragraphes sur l’ensemble de ses 3500 pages. De fait, il alloue presque autant d’espace à un résumé détaillé de l’intrigue du film The Parallax View, un thriller d’assassinat politique produit par Warren Beatty, ou au ratage de la campagne politique du président Gerald Ford sur le thème « Vainquons l’Inflation Maintenant » [« Whip Inflation Now » – WIN, NdT] la même année. Si l’on se fonde sur la couverture et le ton de Bernstein, aucun lecteur naïf ne pourrait jamais soupçonner quoi que ce soit de suspect au niveau des circonstances des assassinats, et accepterait au contraire sans doute l’affirmation officielle selon laquelle, en chaque instance, un tireur solitaire dérangé fut le seul responsable, tout en rejetant les sceptiques comme des fêlés et hurluberlus adeptes de théories complotistes, méprisés par l’auteur.
Une fois de plus, l’auteur n’est pas nécessairement à condamner pour cette prise de position, qui ne fait guère que refléter le consensus médiatique de l’establishment invariable depuis soixante ans, un consensus médiatique qui a surmonté une marée de preuves factuelles établissant le contraire. Son ton moqueur est précisément celui que j’ai toujours trouvé dans tous les journaux et autres publications respectables, et constitue précisément la raison pour laquelle jusqu’il y a dix ans environ, j’avais toujours considéré les théories faisant état de complots sur JFK comme des délires, et leurs avocats comme des charlatans. Les livres qui exposent efficacement le narratif figé des médias des soixante dernières années présentent une valeur considérable.
Pour jouer l’avocat du Diable, prenons la seule phrase que dédie Perlstein à résumer les faits de l’assassinat de RFK, et qui englobe également un autre meurtre :
Trois jours après cela, le tueur de Kennedy se retrouvant en garde à vue — son nom était Sirhan Sirhan, et il avait agi suivant de mystérieux mobiles impliquant Israël et la Palestine — James Earl Ray fut arrêté à Londres.
Supposons que l’auteur ait plutôt choisi d’ajouter une phrase faisant mention que le rapport d’autopsie officiel — confirmé par le médecin légiste de Los Angeles — avait révélé que le coup de feu fatal avait été tiré à bout portant de l’arrière de la tête de RFK, à une distance de dix centimètres tout au plus, et que tous les témoins avaient confirmé que Sirhan se tenait debout plusieurs pas devant la victime. Ou qu’un enregistrement audio avait enregistré une dizaine de coups de feu, alors que l’arme de Sirhan n’avait que 8 balles en magasin. Perlstein se serait certainement senti obligé d’ajouter de nombreux paragraphes et de couvrir plusieurs pages pour expliquer et analyser ces étranges incohérences factuelles, ce qui aurait amené à une digression importante, qui l’aurait totalement détourné de la trame de son récit, décrivant le chemin emprunté par Richard Nixon pour accéder à la Maison-Blanche lors des élections de 1968. Il était donc nettement plus simple pour lui de se contenter de poser une phrase encapsulant le récit conventionnel prodigué par les médias dominants, tout en laissant regarder ailleurs quiconque s’intéresse à une discussion détaillée des complots menant à des assassinats.
Dans la même veine, son volume Reaganland s’étale sur plus de 1100 pages, mais ne fait aucune mention d’aucune sorte de l’existence du House Select Committee on Assassinations, dont le rapport officiel, publié en 1979, a conclu que l’assassinat de JFK avait probablement résulté d’une conspiration. Comme cette découverte était en totale contradiction avec l’ensemble du récit jusqu’alors porté par Perlstein au sujet de cet événement crucial, le lecteur s’en serait retrouvé totalement perdu. Autant dès lors éviter les eaux troubles et simplement omettre ce détail troublant.
Plutôt que condamner les milliers de pages de reconstruction politique détaillée produites par Perlstein, mieux vaut reconnaître ce travail pour ce qu’il est, et ne pas le comparer avec ce que nous aimerions qu’il soit. Les volumes constituent le récit autorisé de deux décennies centrales dans l’histoire politique des États-Unis, telles que les ont rapporté les médias dominants. Les agents des stars hollywoodiennes, dont le métier est de les protéger, font parfois écrire des biographies sur ces stars, en faisant garantir par l’auteur que tous les éléments controversés ou douteux resterons confinés aux pages clinquantes du National Enquirer, et un pays aussi vaste et aussi puissant que les États-Unis peut certainement s’offrir sa propre biographie autorisée, allant même jusqu’à consacrer quatre volumes très épais à à peine deux décennies importantes.
Mais pour qui désirerait compléter ce narratif expurgé en y réintégrant quelques-uns des éléments soustraits, voici un long extrait de l’un de mes propres articles parus il y a quelques années, un récit qui souligne la manière dont laquelle j’ai passé presque toute ma vie dans l’obscurité du fait de la couverture tout aussi semblable ou biaisée que j’avais toujours absorbée de la part des sources médiatiques dominantes :
Entre autres choses, des références occasionnelles m’ont rappelé que j’avais déjà vu mes journaux discuter de quelques livres sur JFK récemment publiés en termes plutôt respectueux, ce qui m’avait surpris un peu à l’époque. L’un d’entre eux, toujours controversé, était JFK and the unspeakable publié en 2008 par James W. Douglass, dont le nom ne me disait rien. Et l’autre livre dont l’auteur David Talbot – pour lequel je n’avais pas réalisé à l’origine qu’il traficotait dans des complots d’assassinats – était intitulé Brothers : The Hidden History of the Kennedy Years, 2007, centré sur la relation entre John F. Kennedy et son frère cadet Robert. Le nom de Talbot m’était aussi un peu familier en tant que fondateur de Salon.com et journaliste bien connu quoique de tendance libérale.
Aucun d’entre nous n’a d’expertise dans tous les domaines, donc les gens sensés doivent régulièrement déléguer leur jugement à des tiers crédibles, en se fiant à d’autres pour distinguer le sens du non-sens. Comme ma connaissance de l’assassinat de JFK était nulle, j’ai décidé que ces deux livres récents, attirant la couverture des journaux, pourraient être un bon point de départ. Alors, peut-être quelques années après avoir regardé ce film d’Oliver Stone, j’ai ménagé une place dans mon emploi du temps, et passé quelques jours à lire attentivement les mille pages combinées des deux livres.
J’ai été stupéfait de ce que j’ai immédiatement découvert. Non seulement la preuve d’une « conspiration » était absolument accablante, mais alors que j’avais toujours supposé que seuls les dingues doutaient de l’histoire officielle, je découvrais plutôt une longue liste des personnes les plus puissantes au sommet du gouvernement américain, et les mieux placées pour connaître les faits, qui étaient intimement convaincues d’une telle conspiration et, en général, depuis le début de l’affaire.
Le livre de Talbot m’a particulièrement impressionné, étant basé
sur plus de cent cinquante interviews personnelles et publié par The Free Press, un éditeur très réputé. Bien qu’il ait appliqué un lustre hagiographique considérable aux Kennedy, son récit a été écrit de manière convaincante, avec de nombreuses scènes captivantes. Mais, bien qu’un tel emballage ait sûrement contribué à expliquer certains des traitements favorables de la critique et la réussite d’un best-seller national dans un domaine longuement défriché, pour moi l’emballage était beaucoup moins important que le produit lui-même.
Dans la mesure où les notions de conspiration sur JFK m’avaient déjà traversé l’esprit, j’avais considéré l’argument du silence (de son frère Robert) comme absolument concluant. En effet, s’il y avait eu le moindre doute sur la conclusion du « tireur isolé » entérinée par la Commission Warren, le procureur général Robert Kennedy aurait ouvert une enquête complète pour venger son frère assassiné.
Mais comme le démontre si bien Talbot, la réalité politique de la situation était entièrement différente. Robert Kennedy a peut-être commencé, après cette matinée fatale, à être considéré comme le deuxième homme le plus puissant du pays, mais après que son frère est mort et que son amer ennemi personnel, Lyndon Johnson, a été assermenté comme nouveau président, son autorité gouvernementale a presque immédiatement disparu. Le directeur de longue date du FBI, J.Edgar Hoover, qui avait été son subordonné hostile et qui devait probablement être révoqué pour le deuxième mandat de JFK, est immédiatement devenu méprisant et sourd à ses demandes. Ayant perdu tout contrôle sur les leviers du pouvoir, Robert Kennedy n’avait aucune possibilité de mener une enquête sérieuse.
Selon de nombreux entretiens personnels, il avait presque immédiatement conclu que son frère avait été frappé par un groupe organisé, y compris, très probablement, des éléments provenant du gouvernement américain lui-même, mais il ne pouvait rien faire à propos de la situation. Comme il le confiait régulièrement à des proches, son espoir à l’âge de 38 ans était de parvenir à la Maison-Blanche lui-même à une date ultérieure, et une fois le pouvoir en main, découvrir les assassins de son frère et les traduire en justice. Mais jusque là, il ne pouvait rien faire, et toutes les accusations non fondées qu’il aurait faites seraient totalement désastreuses pour l’unité nationale et pour sa crédibilité personnelle. Ainsi, pendant des années, il fut contraint de hocher la tête et d’acquiescer publiquement à l’histoire officielle de l’assassinat inexplicable de son frère aux mains d’un cinglé isolé, un conte de fées publiquement approuvé par presque tout l’establishment politique, et cette situation le minait profondément. De plus, son acceptation apparente de cette histoire a souvent été interprétée par d’autres, notamment dans les médias, comme son soutien sans réserve à l’histoire officielle.
Bien que la découverte de la véritable opinion de Robert Kennedy ait été une révélation cruciale dans le livre de Talbot, il y en avait beaucoup d’autres. Au moins trois coups provenaient apparemment du fusil d’Oswald, mais Roy Kellerman, l’agent des services secrets dans le siège passager de la limousine de JFK, était sûr qu’il y en avait eu plus, et à la fin de sa vie croyait toujours qu’il y avait eu d’autres tireurs. Le gouverneur Connolly, assis à côté de JFK et grièvement blessé dans l’attaque, avait exactement la même opinion. Le directeur de la CIA, John McCone, était également convaincu qu’il y avait eu plusieurs tireurs. Dans les pages du livre de Talbot, j’ai appris que des douzaines de personnalités éminentes et bien informées exprimaient en privé un scepticisme extrême à l’égard de la « théorie du tireur isolé » de la Commission Warren, bien que de tels doutes aient rarement été exprimés en public ou sur les ondes.
Pour un nombre de raisons complexes, les principaux organes médiatiques nationaux – les hauts dirigeants de notre « Pravda américaine » – approuvèrent presque immédiatement la « théorie du tireur isolé » et, à quelques exceptions près, maintinrent cette position au cours du demi-siècle suivant. Avec quelques critiques éminents désireux de contester publiquement cette idée et avec une forte tendance des médias à ignorer ou à minimiser ces exceptions, des observateurs occasionnels comme moi-même avaient généralement reçu une vision très déformée de la situation.
Si les deux premières douzaines de pages du livre de Talbot ont complètement renversé ma compréhension de l’assassinat de JFK, j’ai trouvé la partie finale presque aussi choquante. Avec la guerre du Vietnam comme fardeau politique sur les épaules, le président Johnson décida de ne pas se représenter en 1968, ouvrant la porte à une entrée de dernière minute de Robert Kennedy dans la course aux primaires du parti Démocrate où il a surmonté des obstacles considérables pour remporter quelques primaires importantes. Puis, le 4 juin 1968, il a gagné la primaire en Californie, État dans lequel le vainqueur prend tout, le plaçant sur un chemin royal vers la nomination et la présidence elle-même, moment où il serait enfin en mesure d’enquêter sur l’assassinat de son frère. Mais quelques minutes après son discours de victoire, il a été abattu et mortellement blessé, prétendument par un autre homme armé, cette fois un immigrant palestinien désorienté nommé Sirhan Sirhan, soi-disant indigné par les positions publiques pro-israéliennes de Kennedy, même si celles-ci n’étaient pas différentes de celles des autres candidats politiques en Amérique.
Tout cela m’était bien connu. Cependant, je ne savais pas que les traces de poudre brûlée prouveraient plus tard que la balle fatale avait été tirée directement derrière la tête de Kennedy à une distance de 8 centimètres, ou moins, alors que Sirhan (le tireur), se tenait à plusieurs pieds devant lui. En outre, des témoignages oculaires et des preuves acoustiques indiquant qu’au moins douze balles avaient été tirées, bien que le revolver de Sirhan ne puisse en contenir que huit, et une combinaison de ces facteurs a conduit le médecin légiste expérimenté de Los Angeles, le Dr Naguchi, qui a conduit l’autopsie, à la conclusion, dans son mémoire de 1983, qu’il y avait probablement un deuxième tireur. Pendant ce temps, des témoins oculaires ont également rapporté avoir vu un garde de sécurité avec son arme au poing juste derrière Kennedy pendant l’attaque, et cette personne avait une profonde haine politique pour les Kennedy. Les enquêteurs de la police ne semblaient pas intéressés par ces éléments hautement suspects, dont aucun n’a été révélé pendant le procès. Avec la mort des deux frères Kennedy, aucun des membres survivants de la famille, ni la plupart de leurs alliés et fidèles ne désiraient enquêter sur les détails de ce dernier assassinat et, dans un certain nombre de cas, ils quittèrent rapidement le pays. La veuve de JFK, Jackie, a confié à ses amis qu’elle était terrifiée pour la vie de ses enfants, et a rapidement épousé Aristote Onassis, un milliardaire grecque qu’elle croyait capable de les protéger.
- La pravda américaine : l’assassinat de JFK, première partie – Que s’est-il passé ?
Ron Unz • The Unz Review • 18 juin 2018 • 4,800 mots - La Pravda américaine. L’assassinat de JFK – 2e partie
Ron Unz • The Unz Review • 25 juin 2018 • 8,000 mots
Dans l’ouvrage de Perlstein, le chapitre faisant suite au résumé superficiel tenant en une phrase de l’assassinat de RFK décrit les événements de la convention républicaine de 1968 à Miami, et l’auteur indique que la nomination triomphale de Richard Nixon a provoqué une crise cardiaque mortelle chez un « libéral âgé » de New York alors qu’il prenait son petit-déjeuner. Par curiosité, j’ai vérifié les notes de fin de l’ouvrage, pour découvrir que la victime était Harry Elmer Barnes, un universitaire de haut calibre, et doyen des historiens révisionnistes des États-Unis, une personnalité qui s’était vue purgée des médias dominants presque trente années plus tôt en raison de son refus obstiné de rallier la ligne du parti de l’establishment. Barnes s’était illustré en qualifiant d’« historiens de cour » les universitaires et journalistes qui rognent les coins anguleux de leurs écrits afin d’éviter de gêner les puissants intérêts qui dominent notre vie politique ou l’industrie de la publication. Il semble donc que Perlstein fût apparemment familier de Barnes et de sa carrière détruite, et ait pu décider d’éviter de risquer le même destin. Qui peut vraiment lui en vouloir ?
Les meurtres raciaux des années 1970
Durant plus de deux générations, l’establishment étasunien et ses alliés, les médias dominants, ont dissimulé la vérité autour de l’assassinat du président John F. Kennedy en 1963, et autour de celui de son jeune frère survenu quelques années plus tard. Les récits qui s’éloignent du narratif officiel sont presque totalement exclus des organes médiatiques respectables, et les livres de Perlstein n’ont fait que se conformer à cette règle non écrite.
Mais discuter franchement sur les sujets raciaux est tout aussi interdit en ces mêmes lieux. Le thème principal des quatre volumes massifs de Perlstein est la résurrection et finalement le triomphe politique du mouvement conservateur étasunien, précédemment marginalisé, et les rudes conflits raciaux des années 1960 et 1970 constituèrent sans doute le facteur le plus important ayant débouché sur cette trajectoire ascendante.
Cette dynamique politique sous-jacente fut largement mise en avant par les médias durant cette période, et de nombreux livres, universitaires ou populaires, ont analysé cette histoire. Perlstein lui-même n’évite pas vraiment le sujet, et le chapitre d’ouverture de son volume Nixonland porte le titre « Enfer dans la Cité des Anges, » et décrit les émeutes meurtrières de Watts de 1965. Ce violent soulèvement a provoqué l’effondrement du comité racial qui avait suivi l’adoption de la loi emblématique Civil Rights Act de l’année précédente, et a préfiguré les autres vagues de violence raciale qui se sont bientôt abattues sur nos centres urbains. Selon l’index, le texte de ce livre contient des dizaines de références à des militants Black Panther ou Black Power, et le volume suivant, The Invisible Bridge, continue de traiter ce même sujet. Mais certains éléments importants de cette histoire raciale restent aujourd’hui trop explosifs pour recevoir plus d’une mention extrêmement brève.
L’un des chapitres de son dernier volume porte le titre « Hank Aaron », et discute de la réussite du joueur de baseball noir à battre le record établi de longue date par Babe Ruth pour revenir en première base, une réussite d’autant plus méritoire au vu de l’animosité raciale manifestée par des fans fanatiques. Mais enterré dans la première page, au milieu d’un vaste pot pourri citant divers récits médiatiques, on trouve la demi-phrase suivante :
… à San Francisco également, deux adolescents qui pratiquaient l’auto-stop ont constitué les dixième et onzième victimes d’une frénésie de meurtres commis au hasard sur des citoyens blancs par des hommes noirs, dans ce que la police a appelé la tuerie « Zebra ».
Sur les 3500 pages de Perlstein, ces mots constituent la seule référence à ce qui fut sans doute la pire frénésie de meurtres perpétrés pour des raisons raciales au cours du dernier siècle de l’histoire des États-Unis. Je pense que l’un des paragraphes tiré d’un de mes articles est très pertinent à ce sujet :
Notre inclinaison naturelle est de penser naïvement que nos médias présentent de manière fiable les événements actuels et passés de notre monde. Mais au lieu de cela, l’image qu’ils nous en donnent est bien souvent une suite d’images totalement distordues venant d’un miroir déformant au beau milieu d’un cirque. Les petits événements peuvent être présentés comme immenses, et de grands événements sont présentés comme insignifiants. Les contours de la réalité historique peuvent se voir entourés de formes presque impossibles à reconnaître, des éléments importants disparaissant totalement du récit, tandis que d’autres éléments venant du néant s’y voient ajoutés. J’ai souvent émis l’idée que nos médias créent notre réalité, mais au vu de telles omissions et de telles distorsions, la réalité qu’ils produisent est bien souvent très empreinte de fiction. Il est relativement commun de critiquer la propagande absurde qui sévissait au plus haut des purges de Staline ou lors de la famine en Ukraine, mais nos propres médias, à leur façon, nous servent des récits tout aussi malhonnêtes et absurdes. Et jusqu’à l’arrivée d’internet, la plupart d’entre nous ne pouvait pas même entrevoir sans difficulté l’énormité de ce problème.
Cet extrait est tiré d’un article que j’ai écrit en 2016, discutant en détail l’histoire presque totalement supprimée et oubliée de cette vague massive de meurtres raciaux remontant au début des années 1970, et ces faits sont assez importants pour qu’on les cite :
L’avantage de s’intéresser au sujet des meurtres du zèbre est qu’il n’en existe qu’un seul récit détaillé, relativement contemporain des faits. Il y a un ou deux ans, ma curiosité l’emporta, et je commandai ce livre sur Amazon. Zebra se vit publié en 1979 par Clark Howard, un auteur de romans noirs récompensé à moult reprises, qui s’est basé fortement sur les archives des journaux, les témoignages du procès, et diverses interviews des personnes concernées, et son texte court sur plus de 400 pages.
L’histoire des tueurs du Zèbre semble sortir tout droit d’un film, mais aucun film ne s’en est pourtant jamais inspiré. Pendant des décennies, la Nation d’Islam – les auto-proclamés « musulmans noirs » – avaient répété dans leurs sermons que les blancs étaient « des diables », le produit d’une expérience de reproduction contrôlée par quelque scientifique fou, et que le meurtre de ces « diables » constituait un acte de foi religieuse. Et, courant 1972, certains membres de la secte décidèrent de mettre le dogme religieux en pratique, et lancèrent une campagne organisée visant à tuer autant d’hommes, de femmes et d’enfants blancs qu’ils le pouvaient. Ils sévirent un peu partout en Californie, mais avec une préférence pour la région de la Baie et de la ville de San Francisco. L’un de leurs objectifs énoncés était de terroriser les habitants blancs pour qu’ils finissent par quitter la ville, afin de permettre l’établissement d’une cité dominée par les noirs.
Les assaillants noirs sortaient le plus souvent seul ou à deux pour perpétrer leurs meurtres. Il s’en prenaient le plus souvent à une victime apparaissant comme vulnérable, dans la rue, dans l’obscurité ou la pénombre, avec diverses armes allant du pistolet, à la hache, ou à la machette. Certaines victimes étaient kidnappées et amenées dans quelque lieu isolé, où elles étaient torturées et tuées en groupes, leurs corps étaient alors ensuite démembrés et jetés.
À en croire le dernier témoignage fait à la barre du procès, les membres noirs de la secte devaient chacun démontrer l’assassinat de neuf hommes blancs pour se voir octroyer le titre d’« Ange de la Mort », titre qui leur octroyait le droit d’avoir leur photo dans les lieux de rencontre des Musulmans noirs. Les assassinats de femmes et d’enfants blancs comptaient peu ou prou double, ces meurtres étant considérés comme psychologiquement plus difficiles à réaliser. Sur la base des critères permettant de qualifier ces assassinats – des hommes noirs bien habillés s’en prenant au hasard à des blancs – la direction de la police établit une estimation fixant à 70 le nombre minimum de victimes de ces crimes en Californie. Mais Howard, sur la base des ses recherches fouillées, a chiffré son estimation pour l’État de Californie plus proche de 270 morts.
Ces meurtres se déroulèrent sur presque six mois, et après que les journaux et le public prirent conscience de la situation, la ville de San Francisco se retrouva empreinte d’un sentiment de terreur, et les responsables politiques locaux désespérés d’en finir avec cette affaire. Il arrivait même qu’une personne en lien avec les milieux politiques figurât au nombre des victimes, Art Agnos, le futur maire de la ville en personne, échappa de peu à une attaque au pistolet qui le cibla comme victime prise au hasard. De désespoir, le maire Joseph Alioto, libéral acharné, lança une campagne de patrouilles de contrôles et fouilles ciblant la majorité des hommes noirs adultes comme tueurs possibles. En fin de compte, huit suspects furent arrêtés grâce à un informateur, quatre d’entre eux se virent condamnés à la prison à vie, et les attaques cessèrent à ce moment-là. Mais il semble bien que la majorité des participants à ces crimes ne fut jamais inquiétée, et donc jamais punie.
On peut acheter le livre Zebra pour la modique somme de 4 dollars sur Amazon, frais de port compris, et on peut en trouver une version PDF en ligne, ainsi que dans divers autres formats, sur archive.org. Mais pour qui n’aurait pas le temps de lire ce livre, on peut trouver un résumé très court de l’histoire dans un article de 2001, publié par le conservateur James Lubinskas, sous le titre « souvenons-nous des meurtres du zèbre » [Remembering the Zebra Killing, NdT]. La présentation qu’il relate des événements est très proche de celle exposée par le livre, et le San Francisco Chronicle a également publié une courte rétrospective de ces événements en 2002, à l’époque des attaques du Sniper de DC. Il reste également quelques sites internet pour, ça et là, discuter de cette affaire et republier des articles de journaux, dont certains couvraient les événements d’autres villes de la région.
Mais les événements en soi semblent avoir totalement disparus de la mémoire commune. Quand le célèbre auteur David Talbot a publié La saison de la sorcière [Season of the Witch, NdT], couvert d’éloges, couvrant l’histoire générale de San Francisco, il y intégra une discussion des meurtres du zèbre, et divers habitants pourtant bien informés et natifs de San Francisco déclarèrent découvrir cette affaire pour la première fois à cette occasion. En fait, l’absence totale de toute couverture par les médias, ou de toute enquête ultérieure, força Talbot, libéral s’il en est, à citer un blog racialiste obscur dédié à l’affaire Zebra, faute de disposer de meilleure source documentaire sur cette vague de meurtres.
Les meurtres du zèbre représentent non seulement la principale occurrence de meurtres raciaux dans l’histoire de l’Amérique moderne, mais le nombre de victimes qu’ils ont fait dépasse même de beaucoup le total combiné de tous les autres exemples que l’on retrouve dans les 100 dernières années de notre histoire. Quand on prend conscience de cette réalité, le trou noir quasiment absolu des médias sur cette affaire apparaît comme proprement orwellien, et il est profondément dérangeant. Avant le développement d’internet, ni moi ni quiconque n’aurait pu retomber sur cette histoire importante, et je soupçonne que quiconque nous aurait mis sous le nez les faits tels qu’ils se sont produits à l’époque aurait été vite fait catalogué comme lunatique délirant.
• La Pravda américaine. Le KKK et les meurtres raciaux de masse
Ron Unz • The Unz Review • 19 septembre 2016 • 3,200 mots
Un narratif historique pesant, et des nouilles au micro-onde
Début 2020, les premiers confinements pour cause de Covid ont commencé ici, dans la Silicon Valley, ordonnés par le Dr. Sarah Cody et ses collègues responsables locaux de la santé publique de la région de la baie de San Francisco. Sans guère prévenir, on nous a indiqué que les magasins et restaurants étaient sur le point d’être fermés, potentiellement pour une durée de quelques semaines seulement, mais peut-être nettement plus longtemps, et que les habitants allaient pour la plupart se trouver confinés dans leurs logements pour cette période. Rien de tel ne s’était jamais produit dans les États-Unis modernes, si bien que chacun s’est bien entendu appliqué à grossir les rangs des files d’attente dans les magasins d’alimentation.
J’ai acheté quelques boîtes de nouilles instantanées micro-ondables, un produit que je n’avais pas mangé depuis des décennies, et ai découvert que la technologie avait fortement évolué. Les nouilles déshydratées en soi étaient fades et sans le moindre goût, mais à chaque paquet était ajoutés un ou plusieurs sachets d’assaisonnement apportant les arômes et épices nécessaires à rendre le repas savoureux avant d’y ajouter l’eau et de le passer au micro-onde. Ces petits sachets ne constituaient qu’une petite partie du contenu total, et n’apportaient sans doute quasiment aucune calorie ou qualité nutritionnelle, mais ils portaient une importante valeur ajoutée au goût de chaque repas, même si d’autres que moi auraient certes pu les trouver trop piquants pour leur palais.
Les quatre volumes massifs d’histoire politique écrits par Perlstein racontent les histoires importantes de ce qui s’est produit durant deux décennies de la vie publique étasunienne, un récit complet et large, dont les milliers de pages ne contiennent sans doute que peu ou pas d’erreurs significatives, et qui restera sans doute le point de départ standard pour qui voudra à l’avenir étudier cette période. Mais pour les lecteurs capables de tolérer les éléments historiques nettement plus épicés, que l’auteur s’est trouvé par la force des choses contraint d’exclure, en raison des contraintes propres à l’industrie de la publication, je recommanderais fortement d’y ajouter un ou plusieurs sachets de ma suite La Pravda Américaine, sauf, bien entendu, si le résultat risque de les brûler au-delà de ce que peut tolérer leur goût.
Traduit par José Martí, relu par Wayan, pour le Saker Francophone

