Par Ron Unz − Le 5 mai 2025 − Source Unz Review

La semaine passée, j’ai fait paraître un long article explorant l’histoire de Joseph McCarthy, sénateur du Wisconsin, dont la croisade anti-communiste a dominé la politique étasunienne du début des années 1950. Ses activités provoquèrent l’ascension du « maccarthysme, » une forme d’injure, et malgré le passage de trois générations, cette expression reste tellement usitée de nos jours et dispose de son article Wikipédia dédié, long de 14 000 mots.
 Au mois de février 1950, McCarthy reçut une énorme attention de la part des médias lorsqu’il commença à prononcer des discours publics dénonçant les dangers supposés auxquels les États-Unis étaient confrontés en raison des activités subversives des Communistes et des agents soviétiques. Sur la base de mes manuels d’histoire conventionnelle et de la couverture médiatique que j’avais absorbée, j’avais toujours considéré ces affirmations comme fortement exagérées, et j’ai été très surpris de découvrir peu à peu que la menace intérieure posée par les agents communistes soviétiques fut jadis au moins aussi grave que l’énonçait McCarthy.
Au mois de février 1950, McCarthy reçut une énorme attention de la part des médias lorsqu’il commença à prononcer des discours publics dénonçant les dangers supposés auxquels les États-Unis étaient confrontés en raison des activités subversives des Communistes et des agents soviétiques. Sur la base de mes manuels d’histoire conventionnelle et de la couverture médiatique que j’avais absorbée, j’avais toujours considéré ces affirmations comme fortement exagérées, et j’ai été très surpris de découvrir peu à peu que la menace intérieure posée par les agents communistes soviétiques fut jadis au moins aussi grave que l’énonçait McCarthy.
Mais bien que je fus convaincu que la menace d’infiltration communiste avait été des plus réelles, je continuais de considérer le comportement du sénateur comme erratique, avec un McCarthy enclin à lancer des accusations fantasques. Comme je l’ai écrit il y a une bonne dizaine d’années :
À la mi-mars, le Wall Street Journal a mené une longue discussion sur les origines du système de Bretton Woods, le cadre financier international qui gouverna le monde occidental durant les décennies qui suivirent la seconde guerre mondiale. On dispose d’une photo qui présente les deux personnalités qui négocièrent cet accord. La Grande-Bretagne était représentée par John Maynard Keynes, une figure économique centrale de l’époque. Le représentant étasunien était Harry Dexter White, assistant au secrétaire du Trésor, et longtemps architecte de la politique économique des États-Unis, car son supérieur en poste, le secrétaire Henry Morgenthau Jr., était un gentleman farmer sans connaissances en matière de finance. White était également un agent communiste.
Une telle situation n’était guerre unique au sein du gouvernement étasunien durant les années 1930 et les années 1940. Par exemple, en 1945, lorsqu’un Franklin D. Roosevelt à l’article de la mort négocia les contours de l’Europe d’après-guerre avec Joseph Staline au sommet de Yalta, l’un de ses conseillers importants était Alger Hiss, un dirigeant du Département d’État dont la loyauté première allait à la partie soviétique. Au cours des 20 dernières années, John Earl Haynes, Harvey Klehr et d’autres universitaires sont parvenus aux conclusions étayées selon lesquelles ce furent des dizaines, voire des centaines d’agents soviétiques qui infiltrèrent les équipes politiques clés et les structures de recherche nucléaire de notre gouvernement fédéral, totalisant une présence qui approcha possiblement celle qu’évoqua le sénateur Joseph McCarthy, dont la la position perdit peu à peu en crédibilité au fur et à mesure qu’il lança des accusations souvent infondées.
Quelques années plus tard, j’ai lu Blacklisted by History, une défense vibrante de McCarthy et de ses activités écrite par M. Stanton Evans, et le mois dernier, j’ai lu la plupart des autres ouvrages majeurs issus du camp favorable à McCarthy. On trouve parmi ceux-ci Joseph McCarthy, la biographie largement saluée écrite en 1999 par Arthur Herman, Treason, best-seller paru en 2003 sous la plume d’Ann Coulter, le célèbre McCarthy and His Enemies écrit en 1954 par William F. Buckley et L. Brent Bozell, et le roman publié en 1999 par Buckley, The Redhunter, un récit légèrement romancé de la carrière du sénateur du Wisconsin. Pour m’assurer un certain équilibre, j’ai également relu le court mais très influent ouvrage écrit en 1959 par Richard Rovere, Senator Joe McCarthy, qui propose un récit très hostile au sénateur.
À l’exception du livre de Rovere, tous les autres ouvrages furent écrits par les plus fervents défenseurs de McCarthy, mais sur la base des informations factuelles qu’ils produisent, j’ai confirmé mon verdict établi il y a une bonne dizaine d’années. McCarthy avait raison d’affirmer que les États-Unis étaient confrontés à une grande menace induite par la subversion communiste soviétique, mais il se trompa souvent sur à peu près tout le reste.
McCarthy lança souvent des accusations fantasques et injustifiées, et se montra tout aussi malhonnête et désinvolte avec les faits que l’affirment ses critiques dans les médias dominants. Aussi, malgré sa réussite énorme étalée sur plusieurs années, il finit par abîmer fortement sa propre cause. Qui plus est, il était largement nouveau venu sur le sujet du communisme, et très simplement opportuniste. Il devint donc une personnalité publique qui entacha de manière permanente l’important travail accompli avant lui par ses alliés politiques, nettement plus scrupuleux et compétents que lui.
Les auditions Army-McCarthy de 1954, largement diffusées à la télévision, détruisirent sa crédibilité, et quelques mois plus tard, il fut censuré par une majorité écrasante au cours d’un scrutin organisé par ses collègues sénateurs. Après son éclipse politique, il sombra dans l’alcool jusqu’à en mourir quelques années plus tard.
À la fin des années 1950, la nature auto-destructrice des efforts de McCarthy fut largement reconnue, au point d’en devenir un thème de fiction populaire. Par exemple, Richard Condon a publié en 1959 The Manchurian Candidate, son thriller sur le thème de la Guerre Froide, qui fut rapidement adapté au cinéma et produisit un film à succès sous le même titre. Ce travail dépeint les complots extrêmement odieux menés par des agents communistes afin de prendre le contrôle des États-Unis, mais chose ironique, le personnage politique ressemblant à McCarthy s’avère dans cette œuvre constituer une dupe communiste, manipulée par nos ennemis étrangers pour détruire notre société et ses libertés tout en permettant la capture du gouvernement étasunien par les conspirateurs communistes le contrôlant en secret.
- La Pravda Américaine : Le Maccarthysme. 1ère partie : l’homme
Ron Unz • The Unz Review • le 28 avril 2025 • 12,700 mots
Vers le début de mon long article, je décris la manière dont la déclassification, dans les années 1990, des Venona Decrypts a confirmé l’énorme influence que les agents du communisme soviétique avaient acquis sur le gouvernement fédéral des États-Unis dans les années 1930 et les années 1940. À la fin des années 1940, la découverte d’un grand nombre d’agents soviétiques de très haut rang, comme Alger Hiss ou Harry Dexter White, a facilement expliqué l’attention énorme que s’attira McCarthy en lançant sa croisade anti-communiste dans un discours public au mois de février 1950, et l’arrestation de Julius et Ethel Rosenberg plus tard la même année pour espionnage sur les armes nucléaires sembla accroître fortement la crédibilité de ses dires. Aussi, bien que les accusations de McCarthy fussent souvent pompeuses et injustifiées, elles résonnèrent profondément chez un public qui s’était fait de plus en plus soupçonneux vis-à-vis de l’idée que les dirigeants élus des États-Unis dissimulaient la véritable portée de la subversion communiste en cours.
L’existence documentée de tous ces importants agents soviétiques fut évidemment le facteur premier derrière le vaste soutien populaire que la croisade politique de McCarthy attira rapidement. Mais je pense que le maccarthysme s’enracina également sur un terrain très profond, au travers de racines qui ont presque toujours été ignorées dans le récit historique qui est fait concernant cette période, qu’il fût écrit par les nombreux critiques du courant dominant envers le sénateur, ou par la petite poignée de défenseurs dont il disposa. Cet étrange silence semble découler de la nature controversée de cette histoire plus ancienne, mais on peut trouver un indice important de ce contexte dans un livre influent publié à l’époque.
En 1955, Daniel Bell publia The New American Right, une collection d’essais écrits par 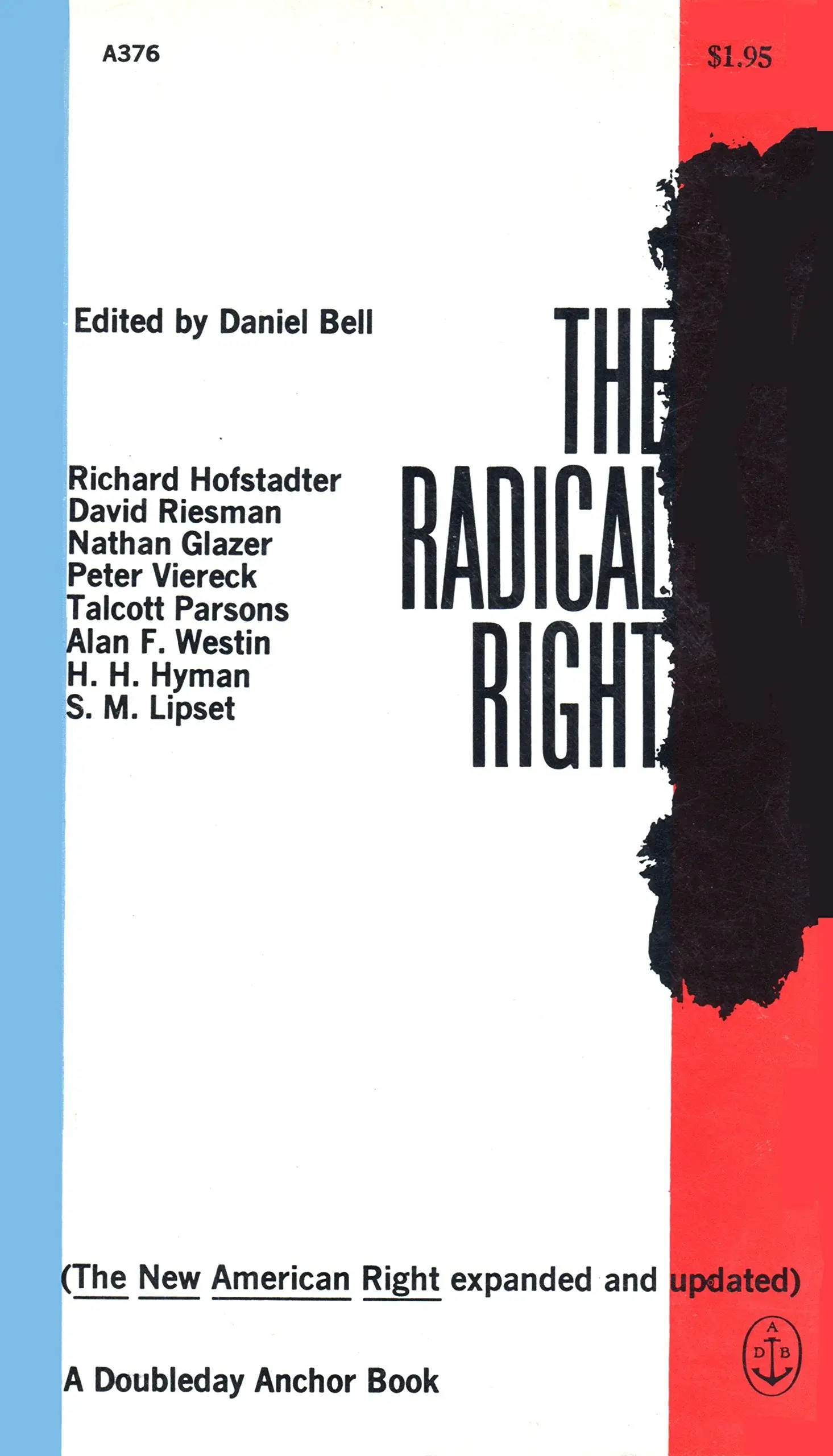 des universitaires étasuniens du courant dominant, et en 1963, il a republié le même ouvrage sous une forme très étendue sous le titre The Radical Right. Le maccarthysme constitue une partie importante de l’analyse, et les deux derniers essais, centrés sur ce sujet et écrits par le sociologue Seymour Martin Lipset, totalisent plus de 140 pages. Lipset démontre que la campagne politique du sénateur du Wisconsin partagea de nombreuses racines idéologiques et de sa base sociale avec le mouvement plus ancien du Père Charles Coughlin durant les années 1930, un prêcheur radiophonique anti-communiste très populaire, issu du Michigan voisin.
des universitaires étasuniens du courant dominant, et en 1963, il a republié le même ouvrage sous une forme très étendue sous le titre The Radical Right. Le maccarthysme constitue une partie importante de l’analyse, et les deux derniers essais, centrés sur ce sujet et écrits par le sociologue Seymour Martin Lipset, totalisent plus de 140 pages. Lipset démontre que la campagne politique du sénateur du Wisconsin partagea de nombreuses racines idéologiques et de sa base sociale avec le mouvement plus ancien du Père Charles Coughlin durant les années 1930, un prêcheur radiophonique anti-communiste très populaire, issu du Michigan voisin.
Lancée à la fin des années 1920, l’émission radio diffusée sur plusieurs fréquences finit par devenir politique, et immensément populaire. Au pic de son succès, dans les années 1930, Coughlin avait amassé une audience nationale énorme, estimée à 30 millions d’auditeurs réguliers, soit environ un quart de la population totale des États-Unis, ce qui fit sans doute de lui l’animateur le plus influent au monde. En 1934, le prêcheur recevait quotidiennement plus de 10 000 lettres, considérablement plus que le président Franklin Roosevelt ou que n’importe qui d’autre.
Coughlin démarra comme l’un des premiers fervents soutiens de Franklin D. Roosevelt et de ses réformes du New Deal, et inventa les phrases populaires : « Roosevelt ou la ruine » ainsi que « Le New Deal est le Deal du Christ. » Mais il perdit peu à peu ses illusions vis-à-vis de Roosevelt et ses politiques, les considérant comme trop peu audacieuses et beaucoup trop redevables aux intérêts financiers de Wall Street. Coughlin se mit donc plutôt à encourager les ambitions politiques du sénateur de Louisiane, Huey Long, une figure populiste qui avait pour projet de défier Roosevelt pour l’élection de 1936, et qui avait pour slogan de campagne radicale : « Partager la Richesse. »
Les histoires jumelles de Coughlin et de Long ainsi que leur relation complexe sont 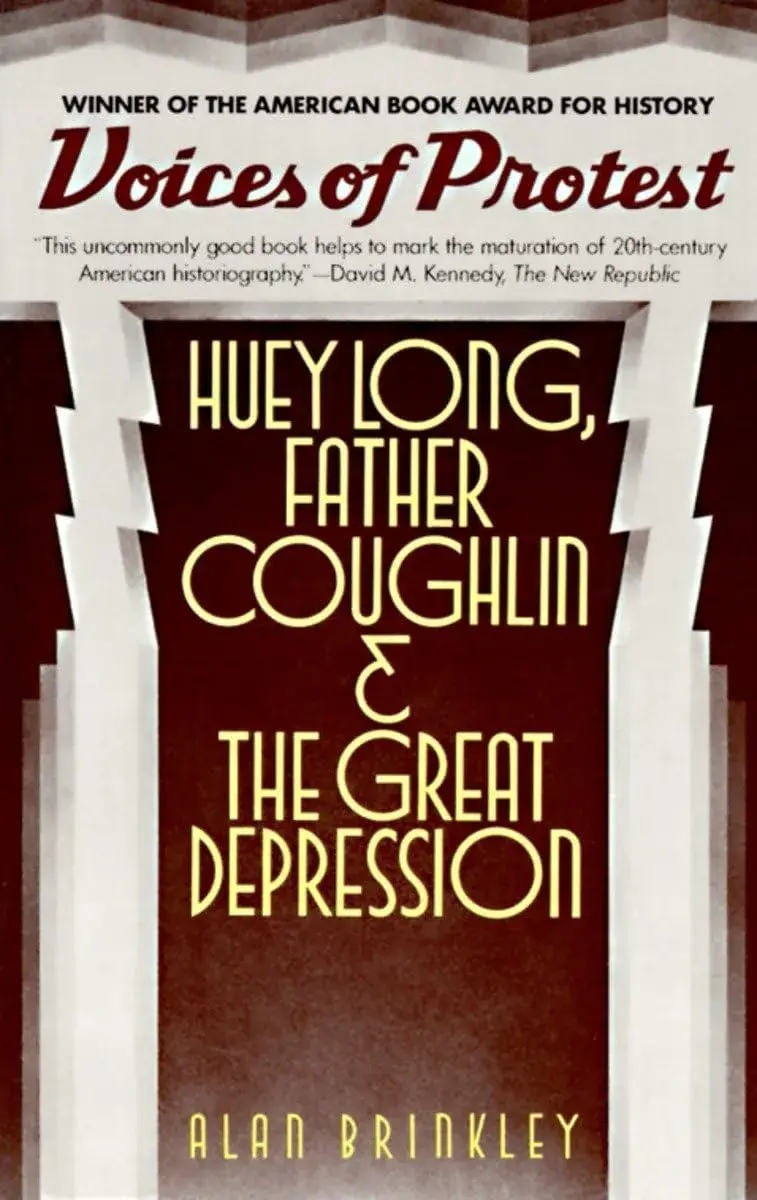 racontées dans Voices of Protest, un livre primé, paru en 1982 sous la plume d’Alan Brinkley, l’historien distingué, qui suggère qu’un tel partenariat entre Long et Coughlin aurait pu rendre difficile la réélection de Roosevelt en 1936. Mais ces projets connurent un effondrement soudain au mois de septembre 1935, lorsque Long fut assassiné par un tireur solitaire dérangé, qui fut lui-même abattu sur-le-champ. Cet événement fortuit permit à FDR de bouleverser la situation l’année suivante en se faisant réélire face à un opposant républicain faible, dont les politiques conservatrices traditionnelles n’attiraient guère le public.
racontées dans Voices of Protest, un livre primé, paru en 1982 sous la plume d’Alan Brinkley, l’historien distingué, qui suggère qu’un tel partenariat entre Long et Coughlin aurait pu rendre difficile la réélection de Roosevelt en 1936. Mais ces projets connurent un effondrement soudain au mois de septembre 1935, lorsque Long fut assassiné par un tireur solitaire dérangé, qui fut lui-même abattu sur-le-champ. Cet événement fortuit permit à FDR de bouleverser la situation l’année suivante en se faisant réélire face à un opposant républicain faible, dont les politiques conservatrices traditionnelles n’attiraient guère le public.
Au fil des années qui suivirent, Coughlin se fit de plus en plus critique envers les Juifs et les influences juives, au vu de leur rôle disproportionné comme banquiers de Wall Street, dont il considérait les activités comme très dommageables pour le travailleur étasunien dont il se faisait le champion. Au mois de mars 1936, il commença à publier un hebdomadaire politique dénommé Social Justice, qui atteignit à son plus haut le million d’abonnés à la fin des années 1930, ce qui en fit l’une des publications les plus lues des États-Unis, avec 10 fois plus de lecteurs que la circulation combinée de Nation et de New Republic, les principaux hebdomadaires libéraux. Chose pratique, les archives complètes de Social Justice sont disponibles sur mon site internet.
Coughlin s’était toujours montré hostile envers le communisme, et après l’éclatement de la Guerre Civile en Espagne au mois de juillet 1936, il commença à soutenir fermement les forces nationalistes anti-communistes, qui étaient également soutenues par Hitler et Mussolini. Dans le même temps des groupes juifs soutinrent de manière écrasante la partie loyaliste, opposée, lourdement soutenue par les Communistes étrangers et l’Union soviétique de Staline. Cela provoqua un fort accroissement des soupçons entretenus par Coughlin à l’encontre des Juifs.
Au cours de la même période, des groupes juifs ainsi que la plupart des médias dominants étasuniens se mirent à condamner sévèrement l’Allemagne nazie pour les persécutions envers sa petite minorité de 1% de Juifs, et ces attaques publiques connurent un crescendo après que des dizaines de Juifs furent tués au cours des émeutes de la Nuit de Cristal du mois de novembre 1938, sans doute orchestrées par des dirigeants nazis.
Mais Coughlin affirmait que les banquiers juifs avaient joué un rôle crucial dans la Révolution bolchevique de 1917 qui avait porté le communisme soviétique au pouvoir, alors que le régime très juif ainsi établi s’était rendu responsable de la mort de Chrétiens par millions, ce qui expliquait facilement l’hostilité des Nazis envers les Juifs et leurs influences. Coughlin était naturellement scandalisé par le fait que les médias étasuniens concentrassent une grande attention sur les dizaines de Juifs morts des mains des Nazis allemands, et pas sur les millions de Chrétiens tués par des Juifs bolcheviques.
Ces sujets ont largement été exclus de nos récits dominants historiques plus récents, mais à l’époque, ils connaissaient une vaste circulation. Bien que je n’y ai aucunement fait mention de Coughlin, j’ai discuté certains de ces sujets controversés dans l’un de mes premiers articles de la Pravda Américaine, publié en 2018 :
- La Pravda américaine. La révolution bolchévique et ses conséquences
Ron Unz • The Unz Review • le 23 juillet 2018 • 7,000 mots
En 1938, Coughlin établit une nouvelle organisation politique anti-communiste appelée Christian Front, et selon Wikipédia, celle-ci attira rapidement des milliers de membres, pour la plupart des hommes irlando-américains de New York et d’autres centres urbains de la côte Est. À peu près dans le même temps, Coughlin fut régulièrement diabolisé, présenté comme sympathisant fasciste, et l’administration Roosevelt commença à œuvrer dans le but de le supprimer des ondes. Ces efforts s’intensifièrent après l’éclatement de la seconde guerre au mois de septembre 1939, et Coughlin devint un opposant de premier plan à l’intervention des États-Unis dans ce conflit militaire.
Au mois de janvier 1940, le FBI fit une descente dans le quartier général du Christian Front, situé à Brooklyn, et arrêta 17 hommes, accusés de comploter en vue de renverser le gouvernement des États-Unis. Mais bien que l’un des accusés se suicidât, les procès de tous les autres débouchèrent sur des acquittements ou par des jurys irrésolus, ce qui provoqua l’humiliation des procureurs fédéraux.
Mais la pression continua de s’exercer, et au mois de septembre 1940, Coughlin fut contraint d’arrêter ses émissions radiophoniques. En avril 1942, l’Espionage Act de 1917 fut invoqué pour interdire son journal Social Justice des services postaux, ce qui eut pour conséquence pratique d’éliminer quasiment toute son influence médiatique sur la scène nationale. Ainsi, l’action du gouvernement fut utilisée pour réduire au silence la voix du principal commentateur radio des États-Unis et bannir la distribution de l’un des journaux nationaux les plus lus, des actions nettement plus graves que toute autre durant la campagne intérieure anti-communiste de l’ère de la guerre de Corée, une décennie plus tard.
Cette répression extrême contre Coughlin se poursuivit lorsque Francis Biddle, procureur général de Roosevelt, convoqua un grand jury fédéral pour l’inculper, ainsi que ses publications, sous couvert d’accusations de sédition. Biddle négocia ensuite un accord avec le supérieur ecclésiastique de Coughlin, l’archevêque Edward Mooney, promettant que le département de la Justice des États-Unis mettrait fin à ses poursuites contre le prêtre s’il fermait Social Justice et mettait fin pour de bon à toutes ses activités politiques. Comme Mooney menaçait de suspendre son ministère, Coughlin accepta ces conditions drastiques. Il resta pasteur de son église locale et vécut jusqu’en 1979, mais ses activités politiques et médiatiques étaient terminées pour de bon.
Coughlin ne disposant plus de plateforme médiatique pour se défendre publiquement, ses ennemis jurés furent en mesure de construire un narratif totalement orienté de son histoire et de ses opinions, et au lendemain de la victoire étasunienne sur la seconde guerre mondiale, ce verdict officiel sur la carrière politique de Coughlin devint extrêmement hostile. Des décennies plus tard, mes manuels d’histoire le congédiaient d’une ou deux phrases, le qualifiant de démagogue antisémite populaire présentant de fortes tendances fascistes, une personne promulguant régulièrement diverses théories complotistes peu plausibles au sujet des Juifs et du communisme.
Cette énorme stigmatisation a garanti que lorsqu’une nouvelle génération de dirigeants républicains en ascension, comme McCarthy ou Richard Nixon, entrèrent au Congrès au sortir de l’élection d’après-guerre, en 1946, ils n’avaient apparemment jamais envisagé de s’identifier à une personnalité vaincue et diabolisée telle que Coughlin, dont le souvenir s’étiolait déjà rapidement dans les cercles de Washington DC. En outre, de nombreux nouveaux dirigeants élus avaient façonné leur nom et leur réputation durant la seconde guerre mondiale, ce qui rendit l’opposition radicale de Coughlin à ce conflit particulièrement toxique.
Et ce rejet brutal de Coughlin ne fit que croître au fil des générations qui ont suivi, après que toute mémoire directe de son influence nationale jadis énorme fût tombée dans l’oubli. Tout ce qui en est resté est l’image très négative insérée dans nos livres d’histoire : un démagogue politique antisémite, ayant raté son objectif, et qui avait soutenu nos ennemis de l’Axe.
Au vu de ces réalités, il n’est guère surprenant que McCarthy et ses alliés politiques aient fait tout leur possible pour se dissocier de Coughlin, et il en va exactement de même de tous les auteurs conservateurs qui par la suite tentèrent de défendre ou de réhabiliter le sénateur du Wisconsin. Le nom de Coughlin n’apparaît qu’à peine dans les livres produits par ces auteurs favorables à McCarthy, au mieux brièvement mentionné comme une personnalité discréditée depuis longtemps que les libéraux intégrèrent fallacieusement dans leurs attaques diffamatoires contre McCarthy.
Mais bien que McCarthy et son camp évitassent soigneusement Coughlin, je pense que le destin de ce personnage peut néanmoins avoir plané de manière funeste sur nombre des soutiens ordinaires du sénateur.
Prenons le fait que la croisade politique de McCarthy contre le communisme commença moins d’une décennie après que Coughlin ait été contraint de se retirer de la vie publique, et des millions de disciples du prêtre ont dû entretenir une mémoire intense de la manière suivant laquelle le gouvernement aura purgé politiquement et réduit au silence l’homme qu’ils avaient jadis tant admiré.
Les représailles gouvernementales de FDR contre Coughlin et son organisation anti-communiste semblent avoir été nettement plus sévères et extrêmes que toute mesure qu’aient pu par la suite soutenir McCarthy ou la plupart de ses alliés contre les communistes étasuniens, sans mentionner les politiques qui furent réellement mises en œuvre en fin de compte.
Qui plus est, Coughlin et ses adeptes semblent avoir été des patriotes absolument loyaux envers leur pays et sans lien significatif avec une puissance étrangère, une situation très différente de celle des Communistes étasuniens ou de leur parti. Sans doute les millions de soutiens de Coughlin pensaient-ils que si le gouvernement étasunien pouvait bannir ses organes médiatiques, menacer de le poursuivre, lui et ses disciples, et de détruire son organisation, il n’était pas déraisonnable que des actions semblables pussent être entreprises contre les Communistes étasuniens, qui servent de toute évidence la cause du grand adversaire étranger des États-Unis.
Au vu de ces faits, je pense que le lien étroit entre les mouvements politiques de Coughlin et de McCarthy suggérés par Lipset et les autres universitaires présentés dans la collection d’essais de Bell était sans doute avéré, et que l’on peut en réalité pousser les choses nettement plus loin. Ce point est relié à un omission historique nettement plus importante que j’ai remarquée dans la majorité écrasante des récits qui décrivent l’ascension de McCarthy et de son mouvement politique.
Comme je l’ai mentionné, le sénateur républicain du Wisconsin, d’ascendance irlandaise et allemande, lança ses efforts en 1950, et sa croisade anti-communiste devint bientôt un véhicule politique populaire pour attaquer la carrière de personnalités de gauches ou libérales. Cela impliqua souvent des tentatives de purger ces personnes de leurs positions élevées dans les médias ou les universités au travers d’accusations, justifiées ou non, de sympathies communistes ou de déloyauté envers les États-Unis.
Pourtant, ces récits n’évoquent que très rarement le fait qu’à peine une décennie plus tôt, on avait observé quasiment la même situation, mais avec des rôles de victime et de bourreau idéologiques totalement inversées. Ainsi, nombre des personnes et organisations soutenant le maccarthysme recherchaient sans doute un châtiment, car eux-mêmes et leurs alliés avaient subi le même type d’attaques vers 1940, et que nombre des victimes s’étaient vues diabolisées et purgées de la vie médiatique et publique. Coughlin n’était vraiment pas seul.
Mais le récit de ces purges idéologiques étasuniennes est resté quasiment totalement exclu de nos manuels d’histoire standards, et rares sont de nos jours les conservateurs, même ceux qui défendent McCarthy, à faire montre de la moindre sympathie envers la plupart de ces victimes de la première heure.
De tous les livres pro-McCarthy que j’aie lus, seul Herman fait brièvement allusion à ces faits. Par exemple, le livre de Coulter ne fait jamais la moindre mention au nom de Coughlin, pas plus que l’un ou l’autre des ouvrages de Buckley. Je doute donc que ne serait-ce que 5% des lecteurs des divers livres qui défendent McCarthy aient jamais eu conscience de cet élément de contexte important du mouvement politique de McCarthy.
J’avais ignoré l’importante affaire Coughlin, mais en 2018, j’ai publié un article décrivant cette vaste purge idéologique des années 1940, tombée dans l’oubli depuis longtemps, menée par FDR et ses alliés libéraux à l’encontre de tant d’universitaires et de journalistes d’importance. Comme je l’ai écrit :
Prenons le cas de John T. Flynn, probablement inconnu aujourd’hui de tous les Américains sauf un sur cent, et encore. Suite à mes explorations idéologiques beaucoup plus larges, je l’avais parfois vu être salué comme une figure importante de l’ancienne droite, un des fondateurs de l’American First Committee et ami des sénateurs Joseph McCarthy et de la John Birch Society, bien que faussement diffamé par ses opposants en tant que proto-fasciste ou sympathisant des nazis. Ce genre de description semblait former dans mon esprit une image cohérente, bien que quelque peu contestée.
Alors, imaginez ma surprise de découvrir que, tout au long des années 1930, il avait été l’une des voix libérales les plus influentes de la société américaine, un écrivain en économie et en politique dont le statut aurait pu être, à peu de choses prés, proche de celui de Paul Krugman, mais avec une forte tendance à chercher le scandale. Sa chronique hebdomadaire dans The New Republic lui permit de servir de locomotive pour les élites progressistes américaines, tandis que ses apparitions régulières dans Colliers, hebdomadaire illustré de grande diffusion, atteignant plusieurs millions d’Américains, lui fournissaient une plate-forme comparable à celle d’une personnalité de l’âge d’or des réseaux de télévision.
Dans une certaine mesure, l’importance de Flynn peut être objectivement quantifiée. Il y a quelques années, j’ai eu l’occasion de mentionner son nom devant une libérale cultivée et engagée née dans les années 1930. Sans surprise, elle a séché, mais s’est demandé s’il aurait pu être un peu comme Walter Lippmann, le très célèbre chroniqueur de cette époque. Lorsque j’ai vérifié, j’ai constaté que dans des centaines de périodiques de mon système d’archivage, il n’y avait que 23 articles publiés par Lippmann dans les années 1930 mais 489 par Flynn.
L’importance de Flynn au début de sa carrière vient de son rôle capital au sein de la Commission sénatoriale Pecora en 1932, qui avait mis au pilori les notables de Wall Street pour l’effondrement du marché boursier en 1929 et dont les recommandations avaient finalement abouti à la création de la Securities and Exchange Commission et d’autres réformes financières importantes. Après une carrière impressionnante dans le journalisme de presse écrite, il était devenu chroniqueur hebdomadaire pour The New Republic en 1930. Bien que sympathisant, au départ, avec les objectifs de Franklin Roosevelt, il devint rapidement sceptique quant à l’efficacité de ses méthodes, notant la lenteur de l’expansion des projets de travaux publics et se demandant si la NRA [National Recovery Administration] tant vantée n’était pas, en fait, plus profitable au big business qu’aux travailleurs ordinaires.
Au fil des années, ses critiques à l’encontre de l’administration Roosevelt se firent plus sévères pour des raisons économiques et, finalement, de politique étrangère, ce qui entraîna une très forte hostilité de l’administration. Roosevelt a commencé à envoyer des lettres personnelles à des rédacteurs en chef exigeant que Flynn soit exclu de tout organe de presse américain de premier plan. En conséquence il a peut-être perdu la rubrique qu’il tenait à New Republic, immédiatement après la réélection de FDR en 1940, et son nom a disparu des périodiques grand public.
On ne devrait pas trop être surpris qu’au début des années 1950, Flynn se distingua pour son important soutien envers McCarthy.
Flynn était peut-être la personnalité publique la plus en vue qui a disparu de la visibilité publique à cette époque, mais il n’était guère le seul. Alors que je commençais à explorer le contenu global de tant de publications qui avaient influencé nos idées depuis le XIXe siècle, j’ai détecté une discontinuité significative centrée sur une période donnée. Un certain nombre de personnes – de gauche, de droite et du centre – qui avaient si bien figuré, jusqu’à ce point, disparaissent soudainement, souvent de façon permanente, au début de la Grande Purge américaine des années 1940.
Je m’imaginais parfois un peu comme un jeune chercheur soviétique sérieux des années 1970 qui a commencé à fouiller dans les fichiers d’archives moisies du Kremlin, oubliées depuis longtemps, et fait des découvertes étonnantes. Trotski n’était apparemment pas le célèbre espion nazi ni le traître décrit dans tous les manuels, mais avait été le bras droit du saint Lénine lui-même pendant les jours glorieux de la grande révolution bolchevique, et était resté pendant quelques années dans les rangs les plus élevés de l’élite du parti. Et qui étaient ces autres personnages – Zinoviev, Kamenev, Boukharine, Rykov – qui ont également passé ces premières années au sommet de la hiérarchie communiste ? Dans les cours d’histoire, ils étaient à peine mentionnés, en tant qu’agents capitalistes mineurs qui ont rapidement été démasqués et ont payé leur traîtrise de leur vie. Comment le grand Lénine, père de la Révolution, aurait-il pu être assez idiot pour s’entourer presque exclusivement de traîtres et d’espions ?
Mais contrairement à leurs analogues staliniens quelques années plus tôt, les victimes américaines disparues vers 1940 ne furent ni abattues ni envoyées au goulag, mais simplement exclues des principaux médias qui définissent notre réalité, les effaçant ainsi de notre mémoire, de sorte que les générations futures ont progressivement oublié qu’elles avaient jamais existé.
L’un de ces victimes fut l’historien Harry Elmer Barnes, une personnalité qui m’était quasiment inconnue, mais qui en son temps fut un universitaire d’influence et de stature considérables.
Imaginez mon étonnement après avoir découvert que Barnes avait été l’un des premiers contributeurs du magazine Foreign Affairs, et le principal relecteur de cette vénérable publication depuis sa fondation en 1922, alors que son statut parmi l’un des premiers universitaire libéraux américains se manifestait par ses nombreuses apparitions dans The Nation et The New Republic au cours des années 1920. En effet, on lui attribue un rôle central dans la « révision » de l’histoire de la Première Guerre mondiale, afin d’effacer l’image caricaturale de l’innommable méchanceté allemande, laissée en héritage de la malhonnête propagande de guerre produite par les gouvernements opposants, britannique et américain. Et sa stature professionnelle a été démontrée par ses trente-cinq livres ou plus, dont bon nombre d’ouvrages académiques influents, ainsi que par ses nombreux articles dans The American Historical Review, Political Science Quarterly et d’autres revues de premier plan.
Il y a quelques années, je parlais de Barnes à un éminent universitaire américain dont les activités en sciences politiques et en politique étrangère étaient très similaires, et pourtant le nom ne lui disait rien. À la fin des années 1930, Barnes était devenu un critique de premier plan des propositions de participation américaine à la Seconde Guerre mondiale. En conséquence, il avait définitivement « disparu », ignoré par tous les grands médias, alors qu’une importante chaîne de journaux était fortement incitée à mettre fin brutalement, en mai 1940, à sa rubrique nationale publiée de longue date.
À de nombreux égards, la situation de Barnes était caractéristique de ceux qui étaient condamnés à la purge. Bien que beaucoup de critiques féroces de la présidence du FDR semblent avoir souffert de nombreuses enquêtes gouvernementales et du harcèlement du fisc au cours des années 1930, le mouvement américain contre une implication dans une nouvelle guerre mondiale semble avoir été le facteur principal d’une vaste purge d’intellectuels publics et d’autres opposants politiques. L’influence combinée de l’establishment de la côte Est pro-britannique et de puissants groupes juifs a été utilisée pour se débarrasser des opposants dans les médias, et après que les Allemands ont rompu le pacte Hitler-Staline en attaquant l’URSS en juin 1941, les communistes et autres gauchistes on également participé à cet effort. Les sondages semblent avoir montré que près de 80 % de l’opinion publique américaine était opposée à une telle implication militaire. Toute personnalité politique ou médiatique influente donnant la parole à cette super-majorité populaire devait être réduite au silence.
Plus d’une douzaine d’années après sa disparition de notre paysage médiatique national, Barnes a réussi à publier La
Guerre Perpétuelle pour une Paix Perpétuelle, un long recueil d’essais d’érudits et autres experts traitant des circonstances entourant l’entrée de l’Amérique dans la Seconde Guerre mondiale. Il a été édité et distribué par un petit imprimeur de l’Idaho. Sa propre contribution consistait en un essai de 30 000 mots intitulé « Le révisionnisme et le blackout historique », qui abordait les énormes obstacles rencontrés par les penseurs dissidents de cette période.
Le livre lui-même était dédié à la mémoire de son ami l’historien Charles A. Beard. Depuis le début du XXe siècle, Beard était une figure intellectuelle de haute stature et de très grande influence, cofondateur de The New School à New York et président de l’American Historical Association et de l’American Political Science Association. En tant que principal partisan de la politique économique du New Deal, il a été extrêmement loué pour ses opinions.
Pourtant, une fois qu’il s’est retourné contre la politique étrangère belliqueuse de Roosevelt, les éditeurs lui ont fermé leurs portes et seule son amitié personnelle avec le responsable de la presse de l’Université de Yale a permis à son volume critique de 1948, Le président Roosevelt, et l’avènement de la guerre, 1941 de paraître. La réputation immense de Beard semble avoir commencé à décliner rapidement à partir de ce moment, de sorte que l’historien Richard Hofstadter pouvait écrire en 1968 : « La réputation de Beard se présente aujourd’hui comme une ruine imposante dans le paysage de l’historiographie américaine. Ce qui était autrefois la plus grande maison du pays est maintenant une survivance ravagée ». En fait, « l’interprétation économique de l’histoire », autrefois dominante, de Beard pourrait presque être considérée comme faisant la promotion de « dangereuses théories du complot », et je suppose que peu de non-historiens ont même entendu parler de lui.
Un autre contributeur majeur au volume de Barnes fut William Henry Chamberlin, qui pendant des décennies avait été classé parmi les principaux journalistes de politique étrangère des États-Unis, avec plus de quinze livres à son actif, la plupart d’entre eux ayant fait l’objet de nombreuses critiques favorables. Pourtant, America’s Second Crusade, son analyse critique, publiée en 1950, de l’entrée de l’Amérique dans la Seconde Guerre mondiale, n’a pas réussi à trouver un éditeur traditionnel et a été largement ignorée par les critiques. Avant sa publication, sa signature apparaissait régulièrement dans nos magazines nationaux les plus influents, tels que The Atlantic Monthly et Harpers. Mais par la suite, son activité s’est presque entièrement limitée à des lettres d’information et à des périodiques de faible tirage, appréciés par un public conservateur ou libertarien restreint.
- Pravda américaine : notre grande purge des années 1940
Ron Unz • The Unz Review • le 11 juin 2018 • 5,500 mots
Il y a un demi-siècle, au début de sa carrière longue et distinguée, le réputé historien 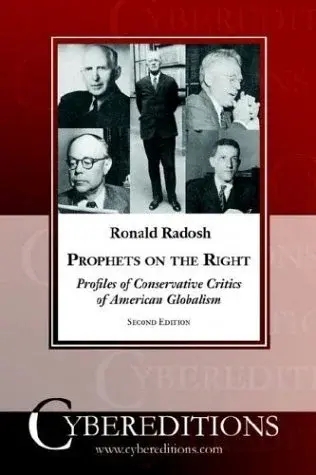 Ronald Radosh a publié Prophets on the Right, un livre paru en 1975 proposant des portraits sympathiques de plusieurs de ces personnalités, y compris deux chapitre sur John T. Flynn, Charles A. Beard et Oswald Garrison Villard, décrivant les forces politiques que FDR déploya pour supprimer chacune de ces personnalités vers 1940.
Ronald Radosh a publié Prophets on the Right, un livre paru en 1975 proposant des portraits sympathiques de plusieurs de ces personnalités, y compris deux chapitre sur John T. Flynn, Charles A. Beard et Oswald Garrison Villard, décrivant les forces politiques que FDR déploya pour supprimer chacune de ces personnalités vers 1940.
Certains des universitaires et journalistes qui se virent purgés vers 1940 étaient d’une stature nettement plus grande que quiconque dont la carrière fut détruite par McCarthy ou par tout autre croisé anti-communiste de cette ère d’après-guerre. Qui plus est, contrairement à presque toutes ces victimes répertoriées par la suite, aucune des personnalités purgées au départ n’avait la moindre trace d’une quelconque connexion étrangère ou la moindre trace de déloyauté. Au lieu de cela, ils furent tous détruits uniquement pour leurs désaccords sincères avec les politiques de Roosevelt.
Mais la victime qui fut de loin la plus éminente de cette grande purge idéologique du début des années 1940 fut le célèbre aviateur Charles A. Lindbergh, une personnalité publique incontournable qui durant deux décennies fut considéré comme le plus grand héros national étasunien.
Exactement comme McCarthy s’y prenait pour salir ses cibles en les qualifiant de Communistes ou de sympathisants au communisme, en usant souvent de tactiques déloyales pour détruire leur réputation, en 1940 et 1941, Lindbergh fut bassement attaqué comme Nazi ou sympathisant nazi pour son opposition sincère à l’entrée des États-Unis dans la seconde guerre mondiale. Dès le mois de mai 1940, le président Roosevelt commença à lancer ces accusations au cours de conversations et de correspondances privées avec des membres importants de son Cabinet, s’assurant ainsi que ces affirmations fussent relayées dans des cercles plus étendus :
Le 20 mai, lendemain du discours prononcé par Lindbergh au sujet de la défense aérienne, le président déjeuna avec son secrétaire au Trésor, Henry Morgenthau. Après une brève discussion sur cette allocution radiophonique, le président posa sa fourchette, se tourna en direction de la personnalité du Cabinet à laquelle il accordait toute sa confiance, et déclara : « Si je devais mourir demain, je veux que vous que vous sachiez ceci. Je suis absolument convaincu que Lindbergh est nazi. »
« À la lecture du discours de Lindbergh, j’ai pensé que Goebbels en personne n’aurait pas fait mieux, » écrivit le président à Henry Stimson, un homme politique républicain à qui Roosevelt avait récemment demandé d’accepter le poste de secrétaire à la guerre. « Quelle tristesse de voir ce jeune homme abandonner totalement sa foi dans notre forme de gouvernement, et accepter les méthodes nazies en raison du fait qu’elles paraissent efficaces. »
Les déclarations privées de FDR furent de plus en plus reprises par de vastes pans des médias dominants, et en juillet 1941, Harold Ickes, secrétaire de l’intérieur, attaqua publiquement Lindbergh sur la même ligne. Comme je l’ai discuté dans un long article en début d’année, cette campagne massive de diabolisation publique alla croissant après le discours controversé de Lindbergh prononcé en septembre 1941 :
Alarmé par la crainte grandissante de voir les États-Unis attirés dans une autre guerre mondiale sans que les électeurs aient eu voix au chapitre, un groupe d’étudiants en droit de Yale a lancé une organisation politique anti-interventionniste qu’ils ont baptisée « The America First Committee ». Ce groupe a rapidement atteint 800 000 membres, devenant ainsi la plus grande organisation politique de base dans notre histoire nationale. De nombreuses personnalités publiques l’ont rejoint ou l’ont soutenu, avec à sa tête le PDG de Sears, Roebuck, et parmi ses jeunes membres on trouvait les futurs présidents John F. Kennedy et Gerald Ford, ainsi que d’autres notables tels que Gore Vidal, Potter Stewart et Sargent Schriver. Flynn a officié comme président du chapitre de la ville de New York, et le principal porte-parole de l’organisation était le célèbre aviateur Charles Lindbergh qui, depuis des décennies, était probablement classé comme le plus grand héros national des États-Unis.
Pendant toute l’année 1941, une foule considérable à travers le pays a assisté aux rassemblements anti-guerre menés par Lindbergh et d’autres dirigeants, avec des millions d’autres écoutant les émissions de radio des événements. Mahl montre que les agents britanniques et leurs sympathisants américains ont entre-temps poursuivi leurs opérations secrètes pour contrer cet effort en organisant divers groupes politiques activistes prônant l’implication de l’armée américaine, en employant des moyens, normaux ou illégaux, pour neutraliser leurs opposants politiques. Des individus et des organisations juifs semblent avoir joué un rôle extrêmement disproportionné dans cet effort.
Parallèlement, l’administration Roosevelt a intensifié sa guerre non déclarée contre les sous-marins allemands et d’autres forces navales de l’Atlantique, cherchant sans succès à provoquer un incident susceptible d’entraîner le pays dans la guerre. FDR a également inventé les propagandes les plus bizarres et les plus ridicules visant à terrifier les Américains naïfs, par exemple en prétendant avoir la preuve que les Allemands – qui ne possédaient pas de marine de surface importante et étaient complètement bloqués par la Manche – avaient ourdi des plans concrets pour franchir des milliers de kilomètres dans l’océan Atlantique afin de prendre le contrôle de l’Amérique latine. Des agents britanniques ont fourni des falsifications grossières à titre de preuve.
Ces faits, maintenant fermement établis par des décennies d’études, fournissent le contexte nécessaire au discours célèbre et controversé de Lindbergh lors d’un rassemblement de l’America First en septembre 1941. Lors de cet événement il a accusé trois groupes « de pousser ce pays à la guerre, les Britanniques, les Juifs et le gouvernement Roosevelt », déclenchant ainsi une énorme tempête d’attaques et de dénonciations de la part des médias, notamment des accusations généralisées d’antisémitisme et de sympathies nazies. Étant donné les réalités de la situation politique, la déclaration de Lindbergh constitue une illustration parfaite de la fameuse boutade de Michael Kinsley selon laquelle « une gaffe, c’est quand un politicien dit la vérité – une vérité évidente qu’il n’est pas supposé dire ». Mais en conséquence, la réputation autrefois héroïque de Lindbergh a subi des dommages énormes et permanents, les échos de la campagne de diffamation ont été entendus pendant les trois dernières décennies de sa vie, et même bien au-delà. Bien qu’il n’ait pas été totalement exclu de la vie publique, sa réputation n’a plus jamais été la même.
- La Pravda Américaine : Charles A. Lindbergh et le mouvement America First
Ron Unz • The Unz Review • le 10 février 2025 • 15,600 mots
Les sévère accusations anti-communistes de McCarthy mirent fin à la carrière de nombreux sénateurs et membres du Congrès durant les élections de 1952 et de 1954, mais quelques années plus tôt à peine, des campagnes de diabolisation très similaires avaient produit le même effet sur les alliés politiques réputés de Lindbergh. Gerald Nye, sénateur du Dakota du Nord, tomba en 1944, et le sénateur du Montana, Burton K. Wheeler, perdit son siège en 1946. Bien que ce dernier ait passé l’ensemble de sa carrière sous la casquette d’un Démocrate très progressiste, il fut dénoncé comme sympathisant du fascisme dans des documents de campagne distribués par des organisations politiques alignées sur le parti communiste, et ne parvint à pas à remporter ses propres primaires.
Sans doute l’exemple le plus infamant de méthodes électorales révoltantes employées par McCarthy se produisit-il en 1952, lorsque le sénateur du Wisconsin parvint à déloger Millard Tydings, sénateur du Maryland, un notable Démocrate qui apparaissait comme invincible après 24 années en poste.
Au cours de cette campagne, les proches alliés politiques de McCarthy distribuèrent à grande échelle un montage photographique trafiqué montrant Tydings discutant amicalement avec Earl Browder, suggérant que le Démocrate réactionnaire et ségrégationniste étant un compagnon d’arme proche du haut dirigeant du parti communiste étasunien, et cela a pu semer la confusion dans l’esprit d’un nombre suffisant d’électeurs crédules pour faire perdre le sénateur sortant. Cet incident célèbre est longtemps resté un élément de base des récits opposés à McCarthy, mais il est probable que seule une fraction des lecteurs sache que ces tactiques malhonnêtes ne faisaient que résonner avec quelque chose de très semblable utilisé pour vaincre un Républicain important quelques années plus tôt.
Après vingt-quatre ans en poste, Hamilton Fish, le représentant de la zone Nord de New York était devenu l’un des Républicains les plus expérimentés de la Chambre, haut placé au sein du Comité des Relations Étrangères, et il constituait une épine dans le pied du président car il était le Représentant de FDR lui-même. Mais en 1944, ce rejeton d’une dynastie politique locale solidement établie finit par perdre sa réélection suite à une campagne publicitaire ordurière que le décrivit comme fréquentant Fritz Kuhn, le dirigeant du parti nazi étasunien. Fish affirma par la suite que l’énorme vague de financements responsable de sa destruction politique était venue de Communistes de la ville de New York.
D’autres Républicains importants n’échappèrent que de peu à un sort similaire. Fils aîné d’un ancien président et juge à la Cour Suprême, Robert Taft, sénateur de l’Ohio, se fit connaître sous le nom de « Mr. Republican, » dirigeant son parti au Sénat et faillit être nominé pour les élections présidentielles en 1940, 1948 et 1952. Mais il faillit perdre sa réélection en 1944 lorsqu’un comité politique aligné sur les Communistes distribua à grande échelle une brochure l’accusant d’être ami de Hitler et de Hirohito.
De fait, un best-seller national paru en 1943 sous le titre Under Cover sous le pseudonyme de John Roy Carlson suggéra que de nombreux Républicains éminents étaient des soutiens fascistes de Hitler, et ce livre fit l’objet d’une couverture énorme dans les organes médiatiques dominants, amplifiée par les soutiens et alliés de Franklin D. Roosevelt.
Ces deux derniers exemples sont très brièvement mentionnés dans l’excellent livre de Herman sur McCarthy, qui consacre quelques pages à ce type d’histoires des années 1940. De la même manière que les discours publics du sénateur du Wisconsin et les divers livres et brochures produits par ses alliés politiques avaient décrit leurs ennemis politique en les accusant de manière répétée — et à tort — de se montrer « laxistes avec le communisme, » une dizaine d’année plus tôt, le même type de fausses affirmations énonçant des sympathies nazies avait été lancé dans l’autre direction, souvent par des groupes ou des personnalités orientés vers le communisme.
Cependant, le livre de Herman se révèle constituer l’exception qui révèle ces points. Malgré des parallèles évidents et étayés entre ces deux campagnes politiques de calomnies et les purges idéologiques en miroir qu’elles parvinrent à accomplir à quelques années d’écart, on n’a que rarement accordé de l’attention à ce sujet dans les récits concernant McCarthy et son ascension au pouvoir, que ce soit dans nos manuels standards ou dans des ouvrages consacrés à la carrière du sénateur du Wisconsin.
Le livre d’Evans sur McCarthy couvre 700 pages et ignore totalement cet aspect de 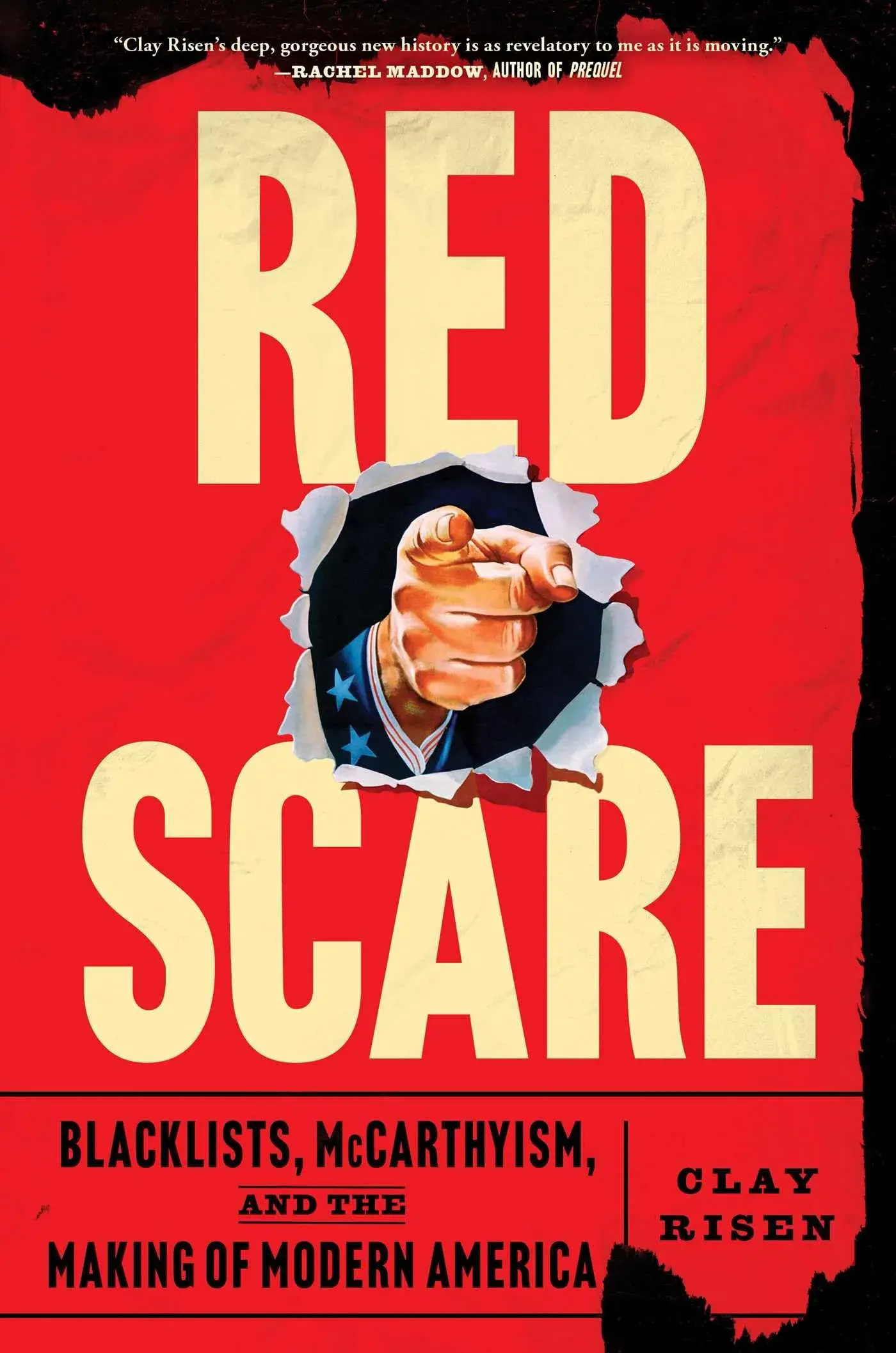 l’histoire, et il en va de même des ouvrages de Rovere, Coulter ou Buckley et Bozell. Et bien que je n’aie pas encore eu l’opportunité de le lire, Red Scare, publié sous la plume de Clay Risen il y a quelques semaines, semble tout aussi silencieux sur ce récit central qui a inspiré le maccarthysme du début des années 1950.
l’histoire, et il en va de même des ouvrages de Rovere, Coulter ou Buckley et Bozell. Et bien que je n’aie pas encore eu l’opportunité de le lire, Red Scare, publié sous la plume de Clay Risen il y a quelques semaines, semble tout aussi silencieux sur ce récit central qui a inspiré le maccarthysme du début des années 1950.
Ce contexte historique fut évidemment d’une importance telle que Herman aurait sans doute dû lui consacrer tout un chapitre, au lieu de quelques pages. Mais ces quelques pages n’en constituent pas moins bien davantage que tout ce que j’ai pu trouver dans presque tous les autres livres traitant de l’ascension politique de McCarthy.
Le patriarche Joseph Kennedy était un fervent soutien de comité America First qui fut tenu en échec dans ses tentatives d’empêcher l’entrée des États-Unis dans la seconde guerre mondiale, et John F. Kennedy également. Quelques années plus tard, les deux hommes devinrent des supporters enthousiastes de McCarthy. C’est dans le Midwest et chez les irlando-américains et les germano-américains que le mouvement America First s’était le plus fermement implanté, et ces groupes constituaient une grande partie de la base politique de McCarthy, alors que les plus fermes oppositions à America First se manifestaient parmi les élites WASP de la côte Est, que McCarthy diabolisa par la suite de manière routinière. Pourtant, ces aspects évidents du mouvement McCarthy ne sont quasiment jamais discutés.
Établissons une analogie absurde. Supposons que tous nos récits standards de la seconde guerre mondiale aient toujours soigneusement omis toute mention à la première guerre mondiale, amenant les jeunes lecteurs troublés à se demander pourquoi la numérotation de nos guerres mondiales commence par le chiffre 2. À certains égards, une situation aussi ridicule apparaît très semblable au portrait standard qui est fait des représailles lancées par McCarthy contre des organisations et des personnalités communistes ou pro-communistes. Une grande partie du maccarthysme constitua sans doute un pur et simple retour de bâton politique.
Au cours des trois dernières générations, les critiques libéraux et dominants des investigations anti-communistes de la fin des années 1940 et des années 1950 ont régulièrement condamné, pour des raisons de libertés civiles, l’infrastructure politique qui fut utilisée pour persécuter ces victimes, y intégrant notablement le Comité de la Chambre sur les Activités anti-américaines et le Smith Act, et il est possible que ces critiques soient fondées.
On oublie cependant le plus souvent que le Comité de la Chambre sur les Activités anti-communistes fut établi au départ en 1938 avec un fort soutien libéral et Démocrate, car ses cibles premières furent des anti-communistes de droite comme Coughlin et son Christian Front. Mais après que ce même Comité de la Chambre consacra ses attentions aux Communistes étasuniens, ses anciens soutiens se mirent à le dénoncer ardemment et s’employèrent à l’éliminer, en dissimulant de manière hypocrite l’histoire plus ancienne.
De manière similaire, le Smith Act établit des peines criminelles pour quiconque soutien le renversement du gouvernement étasunien, et fut utilisé comme véhicule légal pour réaliser environ deux cents inculpations jusqu’à être frappé d’inconstitutionnalité par une suite de décisions de la Cour Suprême en 1957. Au départ, en 1949, des dizaines de membres du parti communiste furent inculpés et poursuivis pour leur seules opinions politiques en vertu de cette loi célèbre, et certains furent condamnés à des peines de prison, et cette attaque légale contre les libertés constitutionnelles des États-Unis fut considérée comme l’une des violations les plus flagrantes du début de l’ère de la Guerre Froide.
Mais ici encore, on oublie le plus souvent que le Smith Act fut en réalité institué en 1940 avec un écrasant soutien libéral, car les conservateurs et les personnalités de droite étaient considérées comme ses cibles principales. De fait, selon la page Wikipédia, Roosevelt voulut même utiliser cette loi pour poursuivre ses principaux opposants politiques comme Charles Lindbergh et les éditeurs du Chicago Tribune, du New York Daily News et du Washington Times-Herald, qui figuraient parmi les journaux les plus distribués aux États-Unis.
Les articles parus dans les médias dominants, et divers passages de nos manuels 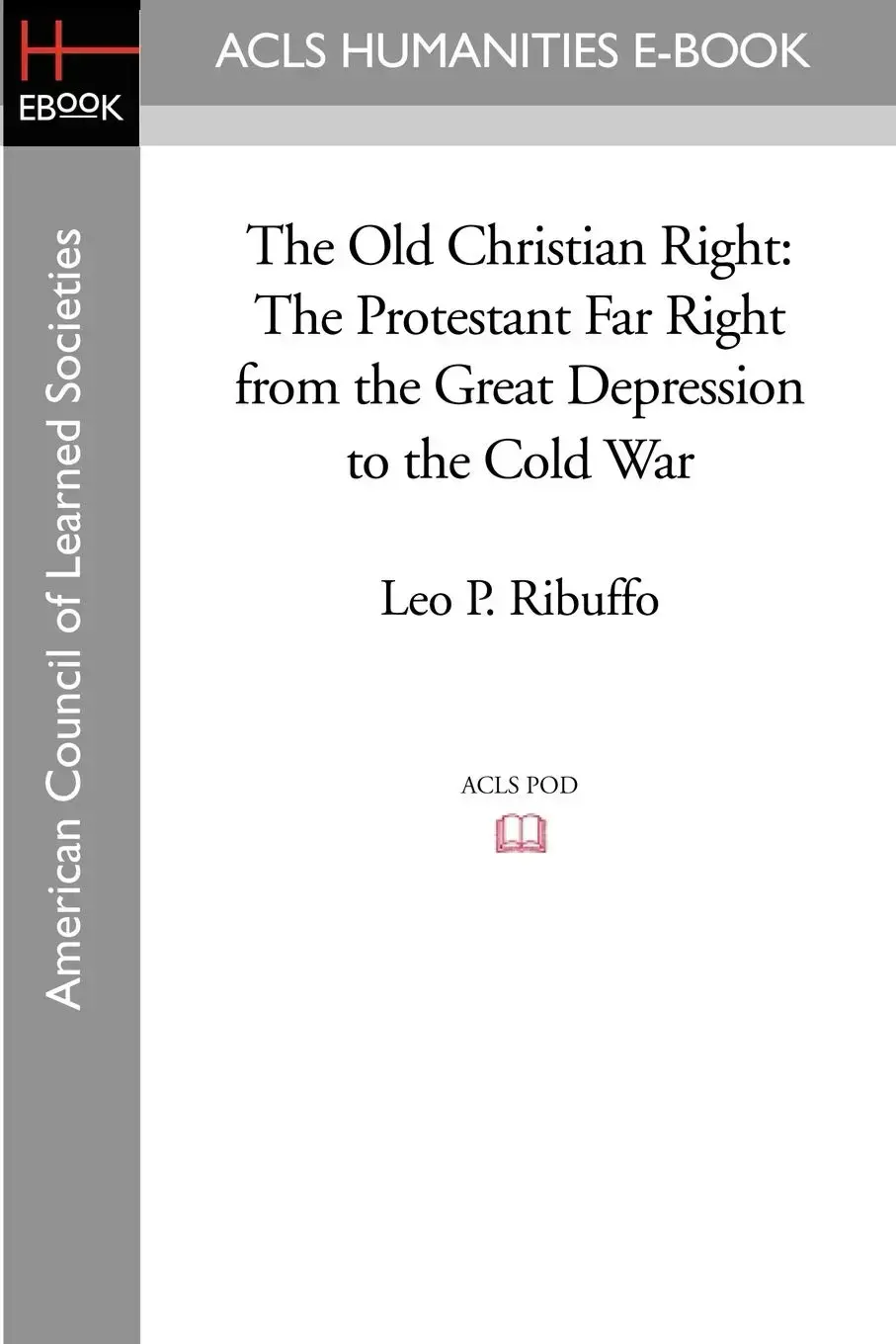 d’histoire décrivent fréquemment la « Peur Rouge » du début des années 1950, étroitement associée aux activités du sénateur Joseph McCarthy. Mais ces récits ne font quasiment jamais mention de la « Peur Marron » qui eut lieu en premier, à la fin des années 1930 et au début des années 1940. Cette formule a été inventée par l’historien Leo Ribuffo dans son important ouvrage de 1983 The Old Christian Right, et l’auteur discute de ce sujet en détail dans un chapitre portant ce nom.
d’histoire décrivent fréquemment la « Peur Rouge » du début des années 1950, étroitement associée aux activités du sénateur Joseph McCarthy. Mais ces récits ne font quasiment jamais mention de la « Peur Marron » qui eut lieu en premier, à la fin des années 1930 et au début des années 1940. Cette formule a été inventée par l’historien Leo Ribuffo dans son important ouvrage de 1983 The Old Christian Right, et l’auteur discute de ce sujet en détail dans un chapitre portant ce nom.
Alors que McCarthy ne fut guère qu’un seul sénateur, certes très influent, et ne disposât d’aucun pouvoir exécutif, Ribuffo explique que durant cette période précédente, le poids tout entier du gouvernement fédéral de Franklin D. Roosevelt et de son FBI fut déployé pour enquêter et harceler ses opposants idéologiques, avec un point haut dans le Grand Procès pour Sedition (Great Sedition Trial) de 1944, l’affaire la plus importante de ce type dans toute l’histoire des États-Unis.
Au cours de ces poursuites juridiques, un assortiment disparate constitué d’accusés de droite, qui pour la plupart ne se connaissaient pas les uns les autres, fut inculpé en vertu du Smith Act, accusés pour l’essentiel d’avoir critiqué le gouvernement. Les poursuites furent menées avec le soutien enthousiaste du parti communiste. Avec des accusés aussi disparates et présentant des traits et des opinions très variées, et dont seuls de rares éléments s’étaient déjà trouvés en contact par le passé, le procès fut exceptionnellement laborieux et complexe, et s’étala sur plusieurs années, jusqu’à ce que le décès du juge débouche sur une annulation des poursuites. À ce stade, la nouvelle administration Truman décida finalement de mettre fin à ce spectacle embarrassant en abandonnant toutes les accusations.
L’un des accusés les plus éminents et érudits, dans le cadre de ce procès, était Lawrence Dennis, ancien élève de Harvard, un ancien diplomate qui avait démissionné par dégoût de l’intervention militaire étasunienne au Nicaragua ; son cadre de pensée idéologique et ses activités politiques sont discutés dans un ou deux chapitre du livre de Radosh.
Dennis devint par la suite un intellectuel public de premier plan après avoir publié une 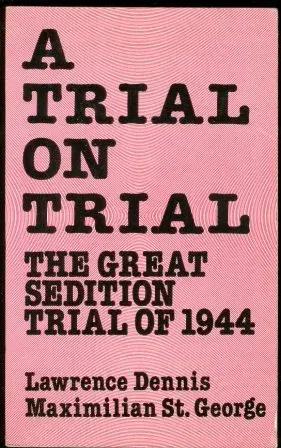 suite d’articles influents dans Nation et dans New Republic, et après son livre de 1932 paru sous le titre Is Capitalism Doomed ? Après l’abandon des accusations de sédition qui avaient été lancées contre lui, il a décrit ses expériences au cours de ce procès du début des années 1940 dans son livre virulent paru en 1946, A Trial On Trial. On en trouve des exemples sur Amazon à un prix exorbitant, mais on peut également trouver l’ouvrage gratuitement sur Archive.org.
suite d’articles influents dans Nation et dans New Republic, et après son livre de 1932 paru sous le titre Is Capitalism Doomed ? Après l’abandon des accusations de sédition qui avaient été lancées contre lui, il a décrit ses expériences au cours de ce procès du début des années 1940 dans son livre virulent paru en 1946, A Trial On Trial. On en trouve des exemples sur Amazon à un prix exorbitant, mais on peut également trouver l’ouvrage gratuitement sur Archive.org.
Chose ironique, des années avant que quiconque entendît parler de McCarthy, le sénateur Wheeler avait eu la prescience de suggérer l’apparition probable du mouvement politique qui finit par être désigné sous le nom de cet homme politique du Wisconsin.
Herman indique qu’en 1943, Wheeler avait prédit à Flynn que des représailles politiques allaient se produire à l’avenir : « Plus les internationalistes s’emploient à salir les gens à présent, plus la réaction contre eux après cette guerre sera importante. » L’auteur déclare ensuite que « Wheeler s’est avéré avoir eu raison — et McCarthy fut à de nombreux égards l’instrument d’une douce vengeance. »
Ron Unz
Traduit par José Martí, relu par Wayan, pour le Saker Francophone
