Préambule Il y a des jours heureux ou l'on découvre des pépites au détour de nos pérégrinations sur le web francophone et le texte que l'on vous propose est de celles là. Le texte est découpé en huit parties et mérite vraiment qu'on s'y attarde. L'auteur, Christian Greiling, a publié ce texte en août 2014. Je vous conseille de commencer cette lecture avec la présentation par l'auteur, qui a lui-même pris le temps de faire un amuse-bouche résumant ce qu'il est indispensable d'avoir à l'esprit pour bien comprendre les mouvements tactiques, stratégiques des grandes puissances et des chefs de guerres. Il est vraiment plaisant de découvrir qu'il existe tant de talent et de travail et notre mission est de vous les faire connaître pour améliorer notre connaissance et notre conscience commune. Alors ne boudons pas notre plaisir d'apprendre. Bonne lecture. Le Saker Francophone
![]() Par Christian Greiling – août 2014 – Source CONFLITS
Par Christian Greiling – août 2014 – Source CONFLITS
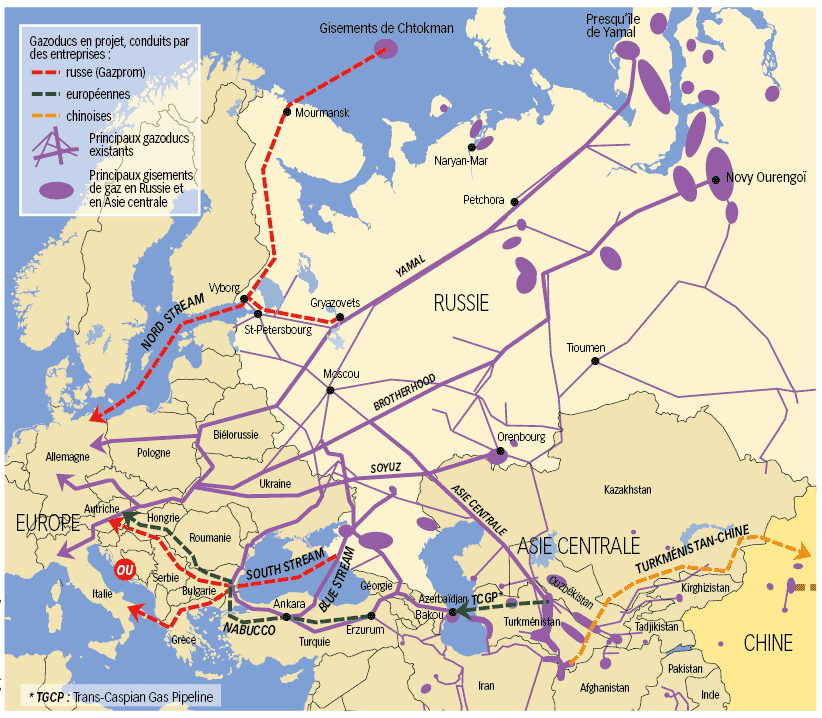
Dans ce contexte, les pipelines jouent évidemment un rôle majeur, leur tracé étant la matérialisation sur le terrain des objectifs stratégiques de leurs promoteurs. Les tubes russes sont autant de flèches visant à percer le Rimland afin de gagner les marchés de consommation européen ou asiatique, ceux promus par Washington courent le long de ce même Rimland et tentent d’isoler la Russie, tandis que l’irruption chinoise vient troubler la scène.
L’équation est encore compliquée du fait de l’émergence d’autres acteurs qui ont également leur mot à dire : Inde, Pakistan, Iran, Japon. Au centre de l’échiquier, les pays producteurs ou de transit jouent un jeu parfois double mais toujours difficile.
Lors des coupures de gaz entre la Russie et l’Ukraine ou des discussions sur le tracé d’un pipeline approvisionnant l’Europe, l’homme de la rue se demandait parfois quel pouvait bien être l’intérêt des États-Unis dans cette histoire et pourquoi ils s’intéressaient autant à la route qu’empruntaient des tubes à 15 000 kilomètres de chez eux. La réponse est qu’il s’agit bien évidemment d’une pièce maîtresse du Grand jeu. Dans un contexte de perte relative de puissance à l’échelle mondiale, l’arme énergétique est une carte maîtresse ; en contrôlant les routes des hydrocarbures, Washington garde un certain levier de pression sur ses concurrents et évite d’être marginalisé. Pour les dirigeants américains, le tracé des pipelines en Asie doit nécessairement suivre celui du Rimland sur un axe est-ouest, encerclant la Russie et désenclavant les pays de l’Asie centrale ou du Caucase. Mais la situation est complexe : au sud de cette ceinture se trouvent des pays avec lesquels les États-Unis sont en conflit ouvert ou couvert – Iran, Irak, Syrie. Le numéro d’équilibriste consiste donc à construire des pipelines dans l’étroite bande séparant ces deux zones, parfois sans considération pour les difficultés économiques ou techniques.
À l’ouest, le Bakou-Tbilissi-Ceyhan (BTC) fut l’une des plus grandes victoires de la diplomatie énergétique de Washington. Ouvert en 2005, il transporte le pétrole caspien de l’Azerbaïdjan à travers la Géorgie et la Turquie, évitant soigneusement le territoire arménien, allié de Moscou. Toutefois, la guerre de Géorgie de 2008, au cours de laquelle la Russie prit rapidement le dessus sur l’armée géorgienne et effectua des bombardements à quelques centaines de mètres de l’oléoduc tout en se gardant bien de le détruire, montra la vulnérabilité du BTC. Est-ce le facteur qui coupa l’herbe sous le pied de Nabucco ? Présenté comme le projet des Européens pour assurer leur indépendance énergétique vis-à-vis de la Russie mais, curieusement beaucoup plus appuyé par les Américains que par ces mêmes Européens, le gazoduc Nabucco devait en effet suivre le même tracé que le BTC, partant de l’Azerbaïdjan et traversant la Géorgie avant de bifurquer vers l’Europe. Bakou n’ayant pas assez de gaz pour le remplir, il était également question d’y ajouter du gaz en provenance du Turkménistan, que l’on aurait fait transiter par un pipeline sous la Caspienne. La réaction de Moscou fut immédiate et multiforme : accélération du projet South Stream, reliant l’Europe par la Mer noire ; manœuvres diplomatiques visant à dissuader le Turkménistan de se joindre au projet ; achat par Gazprom d’énormes quantités de gaz turkmène et azéri afin de vider dans l’œuf toute possibilité de remplir Nabucco ; refus de permettre la construction d’un pipeline sous-marin, qui requiert l’approbation de tous les pays riverains de la Caspienne dont le statut juridique reste flou. On le voit, la partie sur l’échiquier du Grand jeu peut prendre de nombreuses formes. L’ours russe a gardé de sa force de persuasion et il semblerait que les Américains aient plus ou moins jeté l’éponge. Le chantage turc à peine voilé qui utilisait le passage du gazoduc par son territoire pour avancer ses pions dans le dossier de son adhésion à l’Union Européenne ne favorise pas non plus l’aboutissement du projet. Nabucco, qui de plus pâtit de son coût trop élevé, reste une coquille vide et semble avoir dit son dernier mot… Quant à la Russie, elle était, jusqu’au conflit ukrainien actuel, en passe de réussir son pari, malgré les multiples velléités américaines – lobbying en faveur des pipelines non russes (Nabucco, BTC), tentatives de sabotage de tout rapprochement européo-russe et discours sur la nouvelle Europe [de l’Est], retournement de l’Ukraine en 2004 et soutien indéfectible à la politique anti-russe de l’ancien président Iouchenko, campagne d’une certaine presse contre la Russie poutinienne etc. Le gazoduc Nord Stream est entré en service en 2011 et rejoint directement l’Europe occidentale en contournant le glacis de l’Europe nouvelle [de l’Est ] mis en place par Washington qui, par le biais de ses alliés ukrainiens ou polonais, pouvait jusque là couper le robinet à tout moment, comme cela fut le cas à plusieurs reprises lors des conflits gaziers entre l’Ukraine et la Russie dans les années 2000. La construction de son pendant au sud, le South Stream, allait débuter lorsque éclata la crise ukrainienne, gelant le projet. Nous y reviendrons en fin d’article.
En Asie centrale proprement dite, la Russie semble également en position de force. Certes, les compagnies occidentales ont la part belle dans les consortiums exploitant les gisements géants kazakhs de Tengiz (pétrole et gaz, compagnies à capitaux fortement américains) et de Kachagan (pétrole, mis en route cette année et qui devrait rapidement devenir le troisième gisement du monde), mais Moscou garde la haute main sur leurs routes d’évacuation. Si rien n’a encore été décidé pour Kachagan, les pipelines de Rosneft font figure de favoris pour le transit de ses hydrocarbures. Quant au pétrole de Tengiz, il s’engouffre déjà dans les oléoducs russes à destination de Novorossiysk et les tentatives américaines de le faire transiter par le BTC ont peu de chance d’aboutir. Il existe une troisième route, plus économique, préconisée par le français Total : un oléoduc à travers l’Iran. Cette solution de bon sens a évidemment subi le véto de Washington qui tente d’isoler l’Iran depuis la Révolution de 1979. Et l’on touche là du doigt le véritable casse-tête des stratèges américains : comment désenclaver l’Asie centrale et la faire sortir de l’orbite russe tout en évitant les territoires de leurs ennemis dans l’arc de crise allant du Moyen-Orient au Pakistan ?
La première tentative fut aussi l’une des plus curieuses. A la fin des années 90, la société américaine Unocal, avec le plein assentiment de Washington, entreprit des négociations avec le régime des Talibans afin de faire passer un pipeline par l’Afghanistan. Les discussions étaient relativement avancées et une délégation talibane vint même rencontrer les dirigeants d’Unocal au siège texan de la société en décembre 1997. Pour l’administration Clinton, la principale préoccupation était la fin de la guerre civile afghane et l’émergence d’un pouvoir stable, relativement favorable aux intérêts stratégiques et économiques américains, c’est-à-dire permettant d’accéder aux richesses énergétiques de l’Asie centrale. C’est ce qui fit dire à l’époque à un diplomate américain : « Les Talibans vont probablement se développer comme les Saoudiens. Il y aura Aramco [la compagnie nationale saoudienne d’hydrocarbures, NDLR], des pipelines, un émir, pas de parlement et la sharia… On peut s’en arranger » (Ahmed Rashid, Taliban: Militant Islam, Oil and Fundamentalism in Central Asia, Yale University Press, 2000). Ce n’est pas pour des raisons humanitaires mais devant l’incapacité des Talibans à vaincre l’Alliance du nord du commandant Massoud et à mettre fin à l’instabilité du pays que les États-Unis commencèrent à prendre leurs distances avec le régime des étudiants de Dieu [les talibans]. Ces derniers, de plus en plus influencés par Ben Laden qu’ils avaient accueilli en 1996, faisaient également preuve d’un anti-américanisme grandissant. Washington arriva finalement à la conclusion que le régime taliban était incapable de stabiliser l’Afghanistan et de permettre ainsi la pénétration américaine en Asie centrale, et des échos selon lesquels les États-Unis commençaient à planifier l’invasion de l’Afghanistan virent le jour dès la fin de l’année 2000 dans la presse américaine (comme le Washington Post ou l’influent magazine de défense et de stratégie Jane’s Weekly.). L’administration Bush fit toutefois une dernière tentative en juillet 2001 – deux mois avant les attentats du 11 septembre ! – dans une réunion au cours de laquelle les officiels américains demandèrent aux Talibans de constituer un gouvernement d’unité nationale incluant toutes les factions afin de mettre fin à la guerre civile. Selon certaines sources, un représentant américain déclara textuellement : « Soit vous acceptez notre offre et nous vous couvrirons d’un tapis d’or, soit vous refusez et nous vous couvrirons d’un tapis de bombes. » Les Talibans, peu disposés à partager le pouvoir, refusèrent… Deux mois plus tard, les tours du World Trade Center s’effondraient et l’armée américaine intervenait en Afghanistan, ce qui fit dire aux théoriciens du complot que les attentats du 11 septembre n’étaient qu’un écran de fumée. La coïncidence est certes troublante, mais il semble que les États-Unis seraient de toute façon intervenus en Afghanistan, indépendamment des événements du 11 septembre. Le hasard faisant bien les choses, le président Hamid Karzaï et l’ambassadeur des États-Unis en Afghanistan Zalmay Khalilzad avaient tous deux été consultants de la firme Unocal lors des négociations avec les Talibans. Treize ans après, le premier est toujours considéré par une grande partie de la population afghane comme une marionnette américaine, n’ayant pu se maintenir au pouvoir que grâce à une fraude massive durant les élections de 2009 et à un système de corruption généralisée des leaders locaux ou tribaux influents qu’il arrosait avec les dizaines de millions de dollars que lui a versés la CIA pendant plus d’une décennie (With bags of cash CIA seeks influence in Afghanistan, New York Times, 29 avril 2013). Le second avait été un proche collaborateur de Brzezinski, l’auteur du Grand échiquier, à l’université de Columbia puis membre du think tank néo-conservateur Projet pour un nouveau siècle américain qui vise ni plus ni moins à la primauté mondiale des États-Unis. Toutefois, en treize ans de présence, l’armée américaine elle-même s’est révélée totalement incapable de stabiliser l’Afghanistan et les projets de gazoducs sans cesse remis au lendemain, tandis que Gazprom captait toujours plus les richesses énergétiques du bassin de la Caspienne. L’idée ne fut néanmoins pas perdue, comme nous allons le voir…
Malgré leurs échecs répétés pour isoler la Russie et en dépit de l’enlisement afghan, les États-Unis n’en gardent pas moins une certaine influence – certains parlent de capacité de nuisance. Ainsi ont-ils réussi à faire définitivement échouer, semble-t-il, un vieux projet de pipeline entre l’Iran, le Pakistan et l’Inde. Ce gazoduc, appelé Peace Pipeline ou IPI (pour Iran-Pakistan-Inde), devait fournir le gaz dont l’Iran regorge au Pakistan et à l’Inde, dont les besoins énergétiques s’accroissent de manière exponentielle au fur et à mesure de leur développement économique. L’idée tombait sous le sens : trois voisins, dont l’un très riche en énergie et les deux autres forts demandeurs, un tracé relativement simple, sans difficulté technique majeure et qui aurait permis de resserrer les liens de ces trois États aux relations compliquées. C’était sans compter sur Washington et sa volonté de diviser l’Eurasie et d’isoler l’Iran. Après des années de harcèlement, les Américains ont réussi à détacher l’Inde du projet en 2009 avec, à la clé, un accord sur le nucléaire civil. Notons toutefois que New Delhi fait souffler le chaud et le froid, des rumeurs faisant état d’un intérêt toujours persistant pour l’IPI voire pour un pipeline sous-marin Iran-Inde, l’intégration de l’Inde au sein des BRICS et de l’Organisation de Coopération de Shanghai n’y étant peut-être pas pour rien. Le Pakistan, pressé par Washington d’abandonner le projet, persiste dans sa volonté de le mener à bien. En lieu et place du Peace Pipeline, les États-Unis proposent un autre pipeline, le TAPI (Turkménistan-Afghanistan-Pakistan-Inde), qui n’est ni plus ni moins qu’une reprise du projet Unocal.
Sur le plan technique et politique, ce projet est extrêmement compliqué, irréaliste selon certains. Le gazoduc part du Turkménistan où le président-satrape Gurbanguly Berdimuhamedow, gagnant les élections avec des scores soviétiques, a mis en place un véritable culte de la personnalité et semble prendre ses décisions selon l’humeur du moment, témoin ses nombreux retournements, notamment dans le dossier Nabucco. Le TAPI doit ensuite traverser l’Afghanistan et notamment les zones pachtounes en conflit, se frayant un chemin à travers les millions de mines laissées par la guerre de 1980-1989, pour arriver à Quetta, la ville du mollah Omar et de milliers de Talibans réfugiés au Pakistan. Que les États-Unis parviennent à convaincre leurs partenaires d’un projet aussi saugrenu selon le mot de certains spécialistes montre le degré d’influence que Washington conserve dans la région. Surtout, l’on constate que, dans ce Grand jeu de poker menteur planétaire, le facteur stratégique prime sur toute autre considération, qu’elle soit économique ou technique. Mais un jeu, aussi important soit-il, reste divertissant et le dernier rebondissement en date prête à sourire : dès l’accord pour le TAPI conclu en 2012, Vladimir Poutine effectua une visite diplomatique en Afghanistan et au Turkménistan et, sur la demande de ces pays, la Russie s’est invitée dans la partie, par le biais de Gazprom ! Après des années d’efforts pour isoler l’Iran, voilà l’ours russe qui frappe à la porte. Les stratèges américains n’avaient sans doute pas prévu cela…
Tout comme ils n’avaient peut-être pas prévu l’inarrêtable expansion économique de la Chine, l’explosion de ses besoins énergétiques et son irruption dans le Grand jeu. Les regards de Pékin se sont tournés dès les années 90 vers sa région autonome du Xinjiang ou Turkestan chinois, riche en hydrocarbures et peuplé de Ouïghours, turcophones musulmans chez qui l’indépendance nouvelle de leurs cousins des ex-républiques soviétiques avait fait naître des espoirs de liberté et nourri le séparatisme. Cette tendance allait évidemment à l’encontre de l’intérêt accru de Pékin pour sa province occidentale et, à l’instar du Tibet, c’est avec une main de fer que les dirigeants chinois réprimèrent toute menée autonomiste tandis que la colonisation han – l’ethnie majoritaire – s’intensifia. Au-delà de la simple volonté de maintenir son intégrité territoriale, la région du Xinjiang est en effet hautement stratégique pour la Chine. Riche en hydrocarbures et en énergies renouvelables – les forages pétroliers se multiplient dans le désert du Taklamakan tandis que d’immenses parcs d’éoliennes ont vu le jour – en uranium et en terres rares, le Xinjiang a surtout une immense valeur géostratégique : possédant une frontière commune avec huit États, il se trouve au carrefour des routes énergétiques. La majorité de ses approvisionnements provenant d’un Moyen-Orient de plus en plus instable, Pékin a porté son regard sur l’Asie centrale voisine. Une nouvelle Route de la soie sentant fortement le gaz et le pétrole a vu le jour. Un premier oléoduc entre le Kazakhstan et la Chine a été ouvert en 2007. Le gazoduc Trans-Asia ou Turkménistan-Ouzbékistan-Kazakhstan-Chine suivit deux ans plus tard, couvrant environ la moitié des besoins gaziers du dragon avec l’excédent du gaz turkmène que Gazprom ne pouvait acheminer. Dans ces conditions, il ne reste d’ailleurs pas grand-chose pour remplir Nabucco et il semble bien que le projet américano-européen restera à jamais dans les cartons. Récemment, un accord a été signé dans le cadre de l’Organisation de Coopération de Shanghai pour la construction d’un gazoduc Turkménistan-Tadjikistan-Chine qui devrait entrer en service d’ici 2016 et d’ailleurs poser problème pour l’approvisionnement du projet américain TAPI. Par ailleurs, la Chine investit massivement dans les infrastructures énergétiques de ses voisins d’Asie centrale et prend des participations dans leurs gisements par le biais de ses nouveaux géants Sinopec ou PetroChina – respectivement cinquième et sixième entreprises pétrolières mondiales. Cette pénétration chinoise vers le cœur eurasiatique a pris de court Washington comme Moscou. L’influence des États-Unis diminue à mesure que le Grand jeu s’enfonce dans l’intérieur des terres et, malgré une base aérienne au Kirghizstan qui a de toute façon fermé en juin 2014, ils n’ont aucun levier de pression dans la zone steppique qui s’étend de la Mandchourie au Kazakhstan. Quant à la Russie, après quelques hésitations dans les années 2000, elle a finalement accepté bon gré mal gré l’intrusion chinoise qui remet en cause son quasi monopole. Comme il se murmure à Moscou, « du moment que les hydrocarbures ne partent pas du côté américain… » Moscou et Pékin ont des intérêts économiques et stratégiques communs, notamment celui de voir partir les Américains d’Asie centrale, et appartiennent tous deux à l’Organisation de Coopération de Shanghai comme nous le verrons. La crise ukrainienne a encore rapproché leurs positions. Fini le temps où le Kremlin n’hésitait pas à faire des ouvertures au Japon, pour la plus grande fureur de Pékin et laissait traîner les discussions sur les immenses ressources sous-exploitées de la Sibérie orientale et leur acheminement vers la Chine. En mai, après dix ans de négociations, Pékin et Moscou ont signé le contrat du siècle, la Russie fournissant son gaz sibérien pour la somme astronomique de 400 milliards de dollars. Cet accord est le pendant gazier d’un autre méga-contrat, pétrolier celui-là, signé entre Rosneft et le chinois CNPC en juin 2013 et portant sur la somme record de 270 milliards de dollars. Désormais, la subtile et traditionnelle méfiance entre les deux géants eurasiatiques a laissé place à une réelle convergence, ressemblant parfois à une osmose. Nous y reviendrons dans le dernier chapitre traitant des conséquences du conflit ukrainien et de l’accélération de l’intégration eurasienne.
Christian Greiling
À suivre…
Relu par Literato pour Le Saker Francophone
| Article précédent | Article Suivant |


Ping : Twenty Three Years Ago, the U.S. Invaded Afghanistan Over an Oil Pipeline - CovertAction Magazine