Les hyperstitions – la capacité des humains à créer leur propre avenir. Mais s’agit-il d’un génie que nous ne voulons pas laisser sortir de la bouteille ?
Par Simplicius Le Penseur – Le 23 mars 2023 – Source Dark Futura
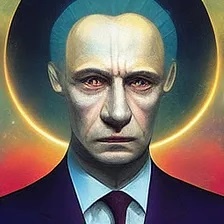
Depuis des années, un mot fait le buzz dans les cercles futuristes : l’hyperstition. Sa définition est à peu près la suivante : les superstitions sont des fictions irrationnelles que les humains créent autour des choses à partir de peurs latentes ou de malentendus, et les hyperstitions en sont les prolongements logiques. Il s’agit d’idées préconçues sur l’avenir, qui se remplissent d’elles-mêmes ; des fictions qui deviennent réalité, simplement parce que nous les avons inconsciemment fait naître en les imaginant.
Mais une tendance inquiétante a vu les futurologues utiliser la pensée hyperstitionnelle pour prôner le rôle de sauveur de l’humanité, en imaginant un « monde meilleur pour nous tous ».
Dans cet article, le futurologue Jorge Camacho décrit bien l’idée des hyperstitions dans le cadre du futurisme. Mais ce qui m’a frappé, c’est la réorientation immédiate du concept vers la recherche de moyens par lesquels, essentiellement, la classe de l’intelligentsia peut « utiliser » et « exploiter » le pouvoir des hyperstitions afin d’orienter l’avenir vers une voie souhaitable. Et qu’est-ce qui est souhaitable, se demande-t-on ? Désirable pour qui, au juste ? Tous les mots d’ordre progressistes habituels peuvent être intercalés : égalitarisme, protection des classes marginalisées et défavorisées, et autres choses de ce genre.
Mais cela nous amène au problème plus large, éclairé ci-dessous, inhérent à toutes les classes d’influence/politiques qui dominent le commun des mortels, qu’il s’agisse de l’intelligentsia, de la classe dirigeante ou de tout autre nom que vous jugerez bon de leur conférer.
Camacho développe l’idée précédente en se référant au magnum opus du futurologue Fred Polak, The Image of the Future :
Dans ce contexte, Polak suggère une possibilité passionnante. L’introduction de l’image du futur dans les sciences sociales pourrait permettre d’aller au-delà d’une simple extension de la boîte à outils de diagnostic de la discipline. « La formulation et la description des images du futur », écrit Polak, « peuvent influencer le futur lui-même, le chercheur en sciences sociales peut réécrire l’histoire du futur ».
De ce point de vue, l’étude, l’évaluation et la formulation des images de l’avenir peuvent permettre au chercheur en sciences sociales – c’est-à-dire au « futurologue » – de mieux participer à l’orientation des cultures humaines vers des avenirs meilleurs.
Il soutient donc que le scientifique, le futurologue – quel que soit le nom qu’on lui donne – ne devrait pas se résigner à l’acte incomplet de simplement enregistrer, cataloguer, diagnostiquer et autres choses aussi basiques, mais devrait plutôt participer directement à la « réécriture de l’histoire de l’avenir » elle-même. Les historiens ne devraient donc pas se contenter d’étudier l’histoire, mais plutôt projeter leurs études sur l’avenir, afin d’influencer les changements qu’ils souhaitent voir se produire.
Cela semble bien intentionné – il n’y a rien de mal à cela, n’est-ce pas ?
Mais la question se pose : pourquoi la classe de l’intelligentsia pharisaïque, qui constitue le monde universitaire et les adeptes du « scientisme », est-elle toujours aussi désireuse d’orienter l’humanité vers un plus grand bien, selon leur vision ? Dans le paradigme globaliste toujours contraignant de la gouvernance centralisée, nous constatons sans cesse que la classe dirigeante adopte invariablement ce manteau de croyance : qu’elle est la seule gardienne de ce manifeste sacré, de ce qui est le mieux et le plus juste pour l’humanité dans son ensemble.
Camacho poursuit en écrivant :
Au niveau le plus élémentaire, comme l’expliquent Lockton et Candy, les images convaincantes d’un avenir souhaitable peuvent « inspirer les gens à travailler pour faire de ces visions une réalité – pour réaliser la prophétie ». Bien entendu, cette idée n’a rien d’étrange pour les personnes travaillant dans le domaine de l’avenir et, dans une large mesure, elle coïncide avec l’idée que Polak se fait de l' »influence-optimisme ». En outre, on peut dire qu’il s’agit de la conviction de travail de nombreux praticiens de l’avenir, au moins depuis que le domaine a commencé à s’éloigner de son ambition prédictive. La meilleure façon de prédire l’avenir, avons-nous coutume de dire, est de le créer.
Ce qu’il sous-entend, c’est que l’ensemble du domaine du « futurisme » est passé d’une simple étude prédictive à une participation réelle à la création de l’avenir lui-même.

Mais d’où vient cet orgueil et cette vanité qui donnent aux gens l’idée qu’ils méritent ou qu’ils ont le droit de déterminer l’avenir de tous les autres ? Il existe une myriade de possibilités, on peut le supposer. Par exemple, certains pourraient considérer qu’il est dangereux de laisser l’avenir « tomber comme il peut » et qu’une sorte de goulasch entropique s’ensuivrait sans l’intervention directe des « sauveurs » bienveillants que sont ces intrépides visionnaires futuristes.
Pour d’autres, il s’agit peut-être d’une variété de pathologies psychosociales – peut-être une soif secrète d’ego pour le pouvoir de commander la vie de tant de personnes involontaires.
À bien des égards, ces orientations psychologiques s’apparentent au « mythe du progrès » mentionné dans un article précédent. En effet, depuis plusieurs centaines d’années, notre classe dirigeante fonctionne selon le principe que la destinée humaine est intrinsèquement liée à une vague notion de « progrès » vers quelque chose de « meilleur », et que nous devrions tous être enclins à travailler perpétuellement vers cet idéal mythique, même si la plupart d’entre nous ne peuvent même pas concevoir vers quoi nous progressons exactement, ni pourquoi.
À bien des égards, ce mythe du progrès est le produit du mercantilisme, puis du capitalisme et du consumérisme, dont la révolution industrielle et la prolétarisation des masses communes ont été les principaux vecteurs.
La théorie de l’accélérationnisme de Nick Land, par exemple, expliquée dans la vidéo suivante, retrace les étapes par lesquelles la pulsion consumériste inhérente au capitalisme engendre une sorte d’égrégore culturel doté d’une vie propre, conduisant à une boucle de rétroaction qui s’auto-perpétue.
Ce qui commence, par exemple, par la création de produits (offre) par des entreprises pour répondre à une demande particulière, déjà existante dans la société, finit par se transformer en un scénario de « queue qui remue le chien ». Les marchés hypercommercialisés dépassent la « demande » organique inhérente à la société, ce qui oblige les entreprises à créer elles-mêmes un nouveau type de demande, pour lequel elles sont naturellement les fournisseurs les mieux préparés.
Une façon plus simple de comprendre cela est la suivante : dans une économie sursaturée et hypercommercialisée, pour que les entreprises puissent poursuivre la croissance sans fin qui est intrinsèque au modèle du « mythe du progrès », elles ne peuvent plus compter sur la simple recherche de demandes naturelles de nouveaux produits de la part de la population, en particulier lorsque l’offre est déjà au coude à coude avec la demande dans un marché sursaturé. Ils doivent au contraire faire surgir la demande de nulle part, en faisant en sorte que la population se réjouisse de quelque chose qui n’a même pas encore été inventé. Pour ce faire, ils les conditionnent à un nouveau besoin, puis leur proposent commodément l’élixir.
Un exemple concret de cette méthode est, par exemple, l’embauche d’influenceurs et de « faiseurs de goût » culturels pour fabriquer et concevoir un nouvel ersatz de « mouvement » viral ou de tendance culturelle, qui crée une marque culturelle identifiable qui peut ensuite être « emballée, produite et vendue » (transformée en marchandise) pour en tirer un profit monétaire.
D’autres itérations modernes, plus sournoises, sont les mouvements Co-Vax et transgenre, qui sont de très récents artifices qui rapportent aujourd’hui de l’argent à l’échelle mondiale.
Vanderbilt opened its trans clinic in 2018. During a lecture the same year, Dr. Shayne Taylor explained how she convinced Nashville to get into the gender transition game. She emphasized that it's a "big money maker," especially because the surgeries require a lot of "follow ups" pic.twitter.com/zedM7HBCBe
— Matt Walsh (@MattWalshBlog) September 20, 2022
Vanderbilt a ouvert sa clinique trans en 2018. Lors d’une conférence donnée la même année, le Dr Shayne Taylor a expliqué comment elle avait convaincu Nashville d’entrer dans le jeu de la transition de genre. Elle a souligné qu’il s’agissait d’une « grosse machine à gagner de l’argent », notamment parce que les chirurgies nécessitent beaucoup de « suivis »
Au cours de la dernière décennie, le public a été conditionné et habitué à sympathiser avec les LGBT, puis avec le mouvement transgenre. Aujourd’hui, ce mouvement a ouvert la voie à des modèles commerciaux entièrement nouveaux.
Le narrateur évoque également des idées tirées de l’ouvrage de Christopher Lasch intitulé The Culture of Narcissism (La culture du narcissisme), en citant Lasch qui affirme que :
L’industrialisation de masse nécessite le développement de la consommation de masse. Et ces consommateurs de masse devront être formés à consommer des versions toujours plus avancées des produits.
Dans le prolongement de ce que j’ai mentionné plus haut, il affirme que bientôt ce processus consistera davantage à « former les consommateurs, plus efficacement, à vouloir votre produit » qu’à trouver des niches, des besoins déjà existants à combler dans la société.
À ce stade, la technologie et le capital ne font que répondre l’un à l’autre, et le consommateur humain a été retiré de l’équation, sauf pour être orienté vers la consommation du produit. L’homme ayant été retiré du cycle de l’évolution, la production et la consommation des choses deviennent de plus en plus abstraites, car le capital et la technologie créent pour eux-mêmes au lieu d’être guidés par les besoins de l’épanouissement humain.
Il poursuit en affirmant qu’à mesure que ce processus s’accélère, il laisse de plus en plus de côté les besoins humains réels. Et c’est ce qui se passe aujourd’hui tout autour de nous. Alors que ces mouvements entièrement fabriqués, conçus et élaborés se développent sans cesse autour de nous, avec une célérité croissante, alimentés par des méga-corporations sans visage, sans être humain, qui font de l’astroturfing, nous constatons que les besoins indélébiles de la société – des êtres humains réels eux-mêmes – sont jetés sur le bord du chemin, ignorés et complètement oubliés. Avez-vous regardé Kensington, à Philadelphie, récemment ?

Les boucles progressent de manière exponentielle jusqu’à ce que l’être humain ne soit plus un client privilégié, mais plutôt un simple rouage, un moyen de parvenir à la fin du comptage numérique d’une expansion sans fin, qui n’est pas sans rappeler celle dont il est question dans mon article sur l’Internet mort.
Pour les entreprises, cependant, les motivations et les incitations sont faciles à comprendre et à traiter. Ils sont simples : le gain monétaire, le profit.
Mais qu’est-ce qui peut bien motiver tant de membres de l’intelligentsia et de la classe dirigeante à aspirer inéluctablement au droit d’orienter l’humanité dans le sens de leur vision ? Dans de nombreux cas, le profit correspond vraisemblablement à leur motivation. Mais dans d’autres cas, il semble que ce soit quelque chose d’inhérent, une souche ancrée dans leur psyché comme une forme de Dunning-Kruger, qui les rend imperméables à la remise en question de la conscience de soi, ce qui empêcherait beaucoup d’entre nous d’émettre des signaux d’alerte.
Mais la plupart d’entre nous agissent en faveur d’une forme ou d’une autre de changement plus important dans le monde, dans notre vie quotidienne. Certains d’entre nous écrivent des blogs sur des questions géopolitiques telles que la guerre en Ukraine, par exemple, espérant par leurs actions qu’un camp ou l’autre gagne, et qu’une cascade de changements mondiaux se ramifie à partir de là. Nous nous efforçons activement de changer l’avenir ; et si nous avions plus de pouvoir pour le faire, beaucoup saisiraient cette chance.
Je dirais cependant qu’il s’agit de changements localisés. Chercher à changer un petit endroit du monde n’équivaut pas à orienter toute la société vers un schéma uniforme et primordial. Ainsi, militer pour la victoire de la Russie dans la guerre d’Ukraine n’équivaut pas à pousser le monde à adopter le mode de vie russe.
Mais des gens comme ces futurologues, qu’ils soient innocents, bienveillants et bien intentionnés ou non, recherchent « l’amélioration » de toute la société, et dans leur propre vision solitaire et isolée de ce qu’une telle amélioration pourrait impliquer.
Dans son article, Camacho explique en outre que les gens forment des boucles de rétroaction hyperstitieuses basées sur des peurs latentes :
Il s’agit là d’une prise de conscience inquiétante. Surtout si l’on considère le moment actuel, plein de menaces claires et présentes telles que l’inégalité croissante, la xénophobie et une urgence climatique sans précédent. Si Polak s’inquiétait d’un tournant nihiliste dans notre imagination de l’avenir, il serait terrifié par notre incapacité culturelle généralisée à imaginer des avenirs autres que l’effondrement.
Il n’est pas surprenant que notre culture commence à donner naissance à de plus en plus d’appels à imaginer des futurs positifs : du projet Hieroglyph : Stories and Visions for a Better Future de l’université d’État de l’Arizona à un magazine comme The Verge qui publie la collection Better Worlds, en passant par l’émergence de genres de science-fiction tels que le solarpunk et l’hopepunk. Que pouvons-nous ajouter à ces développements, en tant que futuristes, du point de vue d’une compréhension hyperstitionnelle des images du futur ?
Tout d’abord, le topos de base à partir duquel l’argument fonctionne est établi, à savoir le paradigme et la vision gauchiste et progressiste de la société ; en bref, une vision étroite et insulaire à partir d’un ensemble de valeurs sociopolitiques.
Il déclare également sans ambages : « Une question importante se pose à ce stade : Pouvons-nous, en tant que futurologues, intervenir et peut-être même cultiver ces processus hyperstitionnels ? »
Ici encore, nous avons la classe universitaire et l’intelligentsia élevées, appelant à une « intervention » directe dans les maux perçus de la société, le tout dans une perspective étroite ; une perspective qui présuppose que la société dans son ensemble n’est pas seulement d’accord avec le récit, mais aussi, ce qui est plus critique, avec le traitement prescrit.
 Il ne s’agit pas ici d’opposer la gauche à la droite. Le fait est que personne, quelle que soit sa confession, ne devrait supposer par principe que le reste de la société souhaite être intégré dans sa vision teintée de l’avenir.
Il ne s’agit pas ici d’opposer la gauche à la droite. Le fait est que personne, quelle que soit sa confession, ne devrait supposer par principe que le reste de la société souhaite être intégré dans sa vision teintée de l’avenir.
D’aucuns pourraient affirmer qu’il existe au moins quelques idéaux universels, sur lesquels tout le monde peut s’accorder, et que nous pouvons, en tant qu’ensemble, « pousser vers » en toute sécurité. Peut-être des choses comme la santé et le bien-être pour tous, l’allongement de la durée de vie, etc.
Mais le problème réside dans les méthodes utilisées pour concrétiser ces idéaux. Nous savons tous que les tenants de la gauche culturelle auront des interprétations très différentes des méthodes acceptables pour « s’efforcer » d’améliorer la santé humaine.
Après tout, il suffit d’observer les divisions diamétrales qui ont marqué les mesures gouvernementales de réponse à la crise Covid dans le monde entier. Une partie de l’humanité a considéré qu’il était parfaitement acceptable d’inoculer de force, de masquer, de restreindre, de lier, de kidnapper, de se moquer, d’expulser, de déplatformer et même de refuser cruellement tout traitement médical à l’autre partie.
Dans ces conditions, pourquoi croire que les gens puissent s’entendre de manière holistique sur les questions sociétales les plus fondamentales et apparemment les plus évidentes ?
Mais éclairons ce point un peu plus en détail :
Tout d’abord, nous devons trouver des moyens de désarmer ou de désamorcer les images de l’avenir qui peuvent fonctionner de manière hyperstitionnelle, en particulier les images négatives, c’est-à-dire celles qui fonctionnent par la panique et d’autres effets négatifs. Comment pouvons-nous, en tant que futurologues, mieux contrer et désamorcer ces images de l’avenir – telles que la croyance en une nouvelle récession économique ou la panique généralisée face à l’automatisation – qui deviennent actuellement des prophéties autoréalisatrices ?
Deuxièmement, et c’est le plus important, nous devons trouver des moyens de cultiver et de développer des hyperstitions fondées sur des images positives de l’avenir. Comment ?
La « nécessité de désarmer » les conjurations hyperstitieuses que l’on perçoit comme « négatives » me semble très proche de la « censure ». Pour créer cet « avenir utopique », il suffit d’exciser, de couper, de tronquer et d’éluder ces petites « mauvaises pensées » de la classe à laquelle nous ferons porter le chapeau ? Tout cela a l’air d’une réunion aseptisée du conseil d’administration de Twitter sur la « confiance et la sécurité », avant Elon Musk.
Après tout, comment annuler ces dangereuses « images du futur », telles que « la croyance en une nouvelle récession économique ou une panique généralisée face à l’automatisation », si ce n’est en s’assurant simplement que les gens ne sont pas en mesure d’exprimer de tels sentiments sur les médias sociaux et ailleurs ? Et comment faire ?
Nous connaissons tous la réponse.

Les techno-pharisiens savent ce qui est bon pour notre avenir.
En fin de compte, il existe une relation étrange entre les universitaires et les futurologues de la populace de l’intelligentsia, et l’avenir qu’ils aspirent si impatiemment à instancier. Cela rappelle presque le tic nerveux de certaines personnes qui, faute d’avoir quelque chose à dire, bavardent sans réfléchir pour remplir l’espace, le silence redouté de l’abîme.
Chacun d’entre nous l’a probablement fait, et cette tendance est plus ou moins présente chez la plupart des gens. Peut-être l’esprit humain est-il cybernétiquement câblé pour résister à ces ellipses incommodes de l’espace et du temps, programmé pour toujours remplir le vide avec quelque chose, de peur qu’il ne nous engloutisse tout entier.
Ce besoin, cette urgence impérissable, chez les humains, d’écrire constamment l’avenir pour tous les autres, en dehors d’eux-mêmes, est-il lié à ce trait atavique ? Ou peut-on l’assimiler à un simple produit de l’égocentrisme ? Difficile à dire, mais ce qui est certain, c’est que l’avenir ne devrait pas appartenir uniquement à une caste radicale de techno-pharisiens progressistes. Créez vos étranges utopies hyper-égalitaires dans le cyberespace, mettez-y des piquets numériques et profitez-en à votre guise.
Mais laissez les autres tranquilles.
Simplicius Le Penseur
Traduit par Hervé, relu par Wayan, pour le Saker Francophone
