un livre de Michel J. Cuny qui bouleverse l’analyse du champ institutionnel français
Par Christine Cuny − Juillet 2020
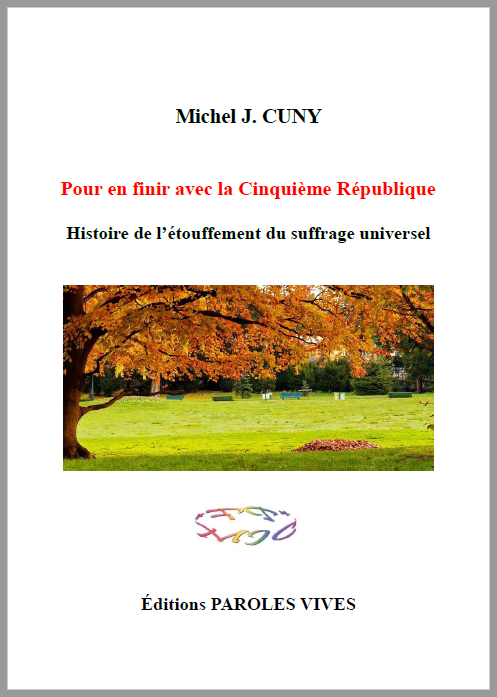 Voici maintenant un peu plus d’un demi-siècle que le peuple français vit sous la coupe de la Constitution de 1958 et de l’institution à laquelle elle a donné naissance : la Cinquième République. Pour autant, nos concitoyen(ne)s ont-ils vraiment conscience de ce qu’elles sont réellement, et de l’impact qu’elles ont, tant sur leur vie quotidienne, que sur les relations que la France est vouée à nouer avec les autres pays du monde ?
Voici maintenant un peu plus d’un demi-siècle que le peuple français vit sous la coupe de la Constitution de 1958 et de l’institution à laquelle elle a donné naissance : la Cinquième République. Pour autant, nos concitoyen(ne)s ont-ils vraiment conscience de ce qu’elles sont réellement, et de l’impact qu’elles ont, tant sur leur vie quotidienne, que sur les relations que la France est vouée à nouer avec les autres pays du monde ?
Il ne faut pas se le dissimuler : cette longue période qu’aura couverte, jusqu’aujourd’hui, la Cinquième République a été marquée par des crises plus ou moins graves qui constituent autant de symptômes d’un malaise profond mais latent, dont on a pu finalement mesurer toute l’ampleur à travers le mouvement des Gilets jaunes.
En fait, n’y aurait-il pas, au delà des problématiques posées par ce qui est devenu, désormais, un chômage de masse et, surtout, de ce qui est présenté comme une sorte de solution miracle qui consisterait, pour les plus modestes, à reconquérir du « pouvoir d’achat », la persistance d’un questionnement politique de premier plan qui toucherait de très près – et d’une façon tout à fait essentielle -, à la souveraineté populaire… ?
Ainsi, comment donc notre pays en est-il arrivé à cette chose stupéfiante qui consiste, pour ses dirigeants de quelque bord politique qu’ils soient, à pouvoir lancer sans crier gare l’armée française à travers le monde, sans que le peuple français lui-même, pourtant directement concerné, ait voix au chapitre – ce qui, soit dit en passant, vaut pour tout ce qui régit son quotidien ? A propos de la réforme des régimes de retraite, par exemple, pourquoi en est-il arrivé à devoir descendre dans la rue – en rangs par ailleurs dispersés – pour « défendre ses intérêts » : cela démontrerait-il qu’il est maître de lui-même et de son destin, tout comme est censé l’être un peuple dans une république ?
Il s’agit là d’une problématique de la plus haute importance que Michel J. Cuny a donc choisi d’étudier en s’appuyant, comme à son habitude, sur des documents historiques : en déroulant l’écheveau d’une période clé de l’histoire politique de la France, il a ainsi vu apparaître les péripéties qui ont mené celle-ci à ce qu’elle est désormais, – sans que l’on puisse toutefois s’en rendre bien compte dès le premier abord -, c’est-à-dire, une monarchie élective, dont nous apprenons que la genèse puise sa source au cœur d’un événement tout à fait déterminant dans ses conséquences à long terme pour la France : l’institution, dès les lendemains de la Révolution de 1848, du suffrage universel direct (masculin).
Pour bien faire saisir l’importance de ce qui était alors apparu, du côté de la bourgeoisie, comme un raz-de-marée, Michel J. Cuny restitue les termes que Charles Benoist, futur précepteur du comte de Paris, avait employés en 1905, qualifiant d’« épaisse accumulation » les 8 millions d’électeurs induits par la mise en pratique du suffrage universel, tandis que, jusqu’alors, l’électorat n’avait représenté que quelque 240 000 votants privilégiés lesquels, selon les termes de Charles Benoist, constituaient « un lit d’argent assez mince », ce qui voulait dire : bien trop mince pour être en mesure d’endiguer le déluge qui s’annonçait… [Cité par Michel J. Cuny, Pour en finir avec la Cinquième République, Éditions Paroles Vives, 2016, page 41]
Car cette montée en puissance politique du « Nombre » – terme privilégié par Charles Benoist et, à sa suite, par des théoriciens bourgeois comme André Tardieu dans l’entre-deux guerres, pour qualifier les masses populaires et en accentuer la prétendue ignorance des grands enjeux de société -, ne pouvait que déborder le cercle étroit des gens de bien avec, pour résultat, de leur ôter les prérogatives politiques dont ils avaient bénéficié de manière quasi exclusive depuis la grande Révolution de 1789.
Sur ce point, Michel J. Cuny rapporte le constat fait par Charles Benoist en 1905, à propos de, je cite l’auteur, cette « montée irrésistible de l’impact du suffrage universel sur le vote de la loi « . [Idem, page 5.]
Charles Benoist écrit :
« Tandis qu’auparavant on avait légiféré pour la propriété, et presque uniquement pour elle, maintenant on allait légiférer presque uniquement pour le travail ; ou du moins jamais à présent le travail ne serait oublié, et toujours, dans toute la législation, on se placerait de préférence au point de vue du travail. » [Idem, page 5.]
Comme l’avait bien vu Charles Benoist, les tenants de la propriété privée des moyens de production et d’échange avaient donc toutes les raisons d’être inquiets : dès lors qu’elle prenait appui sur le suffrage universel, la classe ouvrière, née du développement industriel et qui, jusque-là, avait été contrainte pour (sur)vivre de se soumettre à l’offre de travail capitaliste et, par suite, à tout le système d’exploitation qui va avec, ne pouvait que faire basculer le rapport de forces de son côté.
Ainsi, dans la mesure, note Michel J. Cuny, où « le suffrage universel [menaçait] d’être le moyen, pour le travail, de se rendre de plus en plus maître de la loi et, par là, de l’État », il fallait à la bourgeoisie trouver une parade, en particulier, « face à la concentration physique des travailleurs dans le contexte en développement permanent de la grande entreprise. » Or, conclut l’auteur, « [c’était] ici la porte toute trouvée pour un code du travail… » [Idem, page 65.] Un grand projet auquel Charles Benoist apporterait en 1905 une large contribution en proposant, à titre d’exemple à suivre, une initiative qui avait été prise dès 1890 par le voisin d’Outre-Rhin…
Cette Allemagne, des méthodes de laquelle il s’était agi de s’inspirer, n’en restait pas moins, en ce début du XXème siècle, l’ennemie jurée de la France, mais on savait, dans les hautes sphères de la société française, faire abstraction du fait, qu’une trentaine d’années plus tôt, elle avait pu réaliser, au sein même du prestigieux château de Versailles !, sa propre unité sur les oripeaux d’une France vaincue et dépouillée de ses riches provinces d’Alsace et (partiellement) de Lorraine.
Sans doute les élites françaises n’avaient-elles pas oublié que, disposant des plus grandes qualités d’ordre et de discipline, la Prusse d’alors avait su se montrer pour elles une auxiliaire efficace dans l’anéantissement du grand péril intérieur que constituait la Commune de Paris. Du point de vue d’un Charles Benoist qui, pour sa part, était très conscient de l’existence d’une lutte de classes acharnée entre le Capital et le Travail, l’élaboration d’une organisation du travail, dans le sens d’un contrôle étroit exercé sur une classe ouvrière tout particulièrement concentrée dans la grande industrie, n’était-elle pas toute indiquée pour prévenir une sorte de répétition de l’Histoire ?
A quel titre le code du travail allemand, précisément, représentait-il pour lui un modèle à suivre ? En 1905, reprenant les termes d’un intervenant de la conservatrice Revue des Deux mondes dans son Rapport fait au nom de la Commission du travail chargée d’examiner les projets de loi portant codification des lois ouvrières et que cite, par ailleurs Michel J. Cuny, il préconiserait, « un Code du travail, à l’instar de la Gewerbe-ordnung allemande, coordonnant les dispositions protectrices du personnel de fabrique ou de domesticité, complétant ces dispositions à mesure que l’expérience en établira l’insuffisance. (…, cc) » [Idem, page 68.]
Pour illustrer les bienfaits que ces « dispositions protectrices du personnel de fabrique et de domesticité » étaient censées apporter, Charles Benoist n’avait pas hésité à évoquer, dans son Rapport, l’annonce que l’empereur Guillaume II, lui-même, avait faite quelques années auparavant, devant le Parlement impérial…
« A mesure que la population se rendra compte des efforts de l’Empire pour améliorer sa condition, elle prendra une conscience plus claire des maux qu’attirerait sur elle la revendication de réformes excessives et irréalisables. » [Idem, page 67.]
Mais ce qui rendait aussi le code du travail allemand d’un grand intérêt aux yeux de Charles Benoist, c’est le fait qu’il était organisé de façon à enlever au peuple travailleur allemand, non seulement l’envie, mais surtout la possibilité de changer quoi que ce fût dans sa condition. En effet, précise Michel J. Cuny, « la Gewerbe-ordnung était le Code de commerce qui, extérieur au droit civil, établissait et organisait la liberté du commerce en Allemagne. » [Idem, page 68.]
Or, il était, du point de vue de notre théoricien, tout aussi fondamental que le nouveau code du travail fût – de la même manière que la Gewerbe Ordnung allemande l’était vis-à-vis du code civil allemand – indépendant du Code civil français, institué en 1804 par Napoléon Bonaparte, et par la grâce duquel le droit de propriété privée pouvait, depuis lors, s’exercer dans toute sa plénitude. Comme le souligne l’auteur, il était ainsi inimaginable pour Charles Benoist que « le travail, autrement dit, la classe ouvrière, [pu partir] à l’assaut de la propriété en transvasant sa force du Code du travail au Code civil… par le biais de lois élaborées par le suffrage universel. » [Idem, page 68.]
Voilà bien la raison pour laquelle il avait été hors de question pour lui et ses confrères que l’élaboration dudit Code fût confiée au Parlement jugé incompétent en la matière, car « agité par trop de passions, absorbé par trop de soucis ». [Idem, page 69.]
C’est ainsi que mis en œuvre pour ainsi dire en catimini, au sein d’une Commission extraparlementaire dont les réunions avaient lieu au ministère du Commerce et de l’Industrie (!!), le projet de Code du travail tel qu’il avait été voulu par Charles Benoist serait adopté les yeux presque fermés, le 15 avril 1905, par une Chambre des députés réduite à presque rien, la séance ayant été sciemment ouverte, selon le propre aveu de Charles Benoist, avec une demi-heure d’avance… Autant dire que sur les plans constitutionnel et parlementaire, il s’agissait-là d’une manœuvre frauduleuse, mais la tranquillité de la bourgeoisie était à ce prix…
…Sans pour autant qu’elle soit encore parvenue au bout de ses peines, car le nouveau Code destiné à assurer à l’intérieur des fabriques un encadrement en bonne et due forme de la classe ouvrière, n’empêchait en rien le suffrage universel de continuer à peser, telle l’épée de Damoclès, sur la liberté et la propriété. Ainsi, dix ans plus tard, en 1914, Charles Benoist avait dû se rendre à l’évidence que le problème était resté entier…
« le Nombre – c’est le suffrage universel, et dans le suffrage universel, c’est la classe ouvrière représentée surtout par les ouvriers de la grande industrie, qui, s’ils ne sont pas le Nombre mathématiquement, arithmétiquement, le sont néanmoins, du fait de leur concentration, socialement et politiquement. » [Idem, page 53.]
Et le pire était encore à venir… Malgré les efforts produits pour contrer la marche du « Nombre » vers le pouvoir, celui-ci finirait par y accéder en 1936 avec la victoire du Front populaire : toujours sur le pont, Charles Benoist ne passerait pas par quatre chemins pour bien faire sentir la gravité de la situation…
« Le suffrage universel bouleverse l’État tout entier en le dressant en face de l’argent, en le tournant contre l’argent, du fait même qu’il est introduit malgré et contre les censitaires. Il est, du premier jour, anticapitaliste. » [Idem, page 61.]
Et il était donc, par ce fait même, absolument inacceptable pour les « honnêtes gens », et pour les plus zélés de leurs soutiens, à l’instar d’André Tardieu, un révisionniste de droite par ailleurs « disciple » du désormais bien connu Charles Benoist dont, en 1936, il enfourcherait, en quelque sorte, le même cheval de bataille contre le Front populaire. À cette différence près que, fermement décidé à aller bien plus loin encore, il rechercherait les moyens propres à remédier, une fois pour toutes, à ce qu’il considérait comme une grave dérive. Comme le souligne Michel J. Cuny, le Front populaire s’inscrivait, en effet, « dans un processus né dès les premiers jours de la Révolution de 1789. » [Idem, page 88.]
Or, c’est bien pour contrer ce même processus qu’aura été organisée la défaite de 1940… Comme le rappelle l’auteur, celle-ci s’insérait en effet « dans une politique générale de destruction du parti et de l’influence communistes, et de mise au pas du pouvoir législatif envahi, peu à peu, par le suffrage universel, où le travail salarié – et tout particulièrement ouvrier – prenait une place grandissante consécutive à une évolution sociologique irrésistible. » [Idem, page 123.]
Dès lors que le peuple français était anéanti par une fulgurante défaite militaire et qu’il ne savait plus à quel saint se vouer, la grande bourgeoisie avait les coudées franches pour impulser un pouvoir exécutif fort répondant à ses intérêts : c’est dans ces conditions qu’elle remettrait les pleins pouvoirs au maréchal Pétain, afin qu’il redresse le pays et élabore une nouvelle constitution qui puisse enfin réaliser ce qu’elle s’était efforcée d’obtenir depuis 1848 : l’étouffement du suffrage universel.
Vouée dans un premier temps à l’échec, la réalisation de cette grande œuvre serait confiée en 1958, et cette fois-ci avec succès, aux bons soins d’un certain Charles de Gaulle en misant, non plus sur la peur et le désarroi suscités par l’invasion, puis par l’occupation, d’une nation étrangère, mais sur la menace représentée par un putsch militaire à peine déguisé justifiant une reprise en main énergique – autrement dit, par voie de coup d’État – des institutions de la République.
Ainsi le général de Gaulle s’appuiera-t-il sur les événements d’Algérie pour prendre le pouvoir : il n’avait sans doute pas oublié le verdict sans appel qu’en 1935 André Tardieu – qu’il avait fréquenté dans l’entre-deux guerres et dont il avait lu les écrits – avait prononcé à propos de l’État politique de la France, à savoir que celui-ci « ne [pouvait] pas être légalement amélioré « … [Idem, page 123.]
Fille de cet « acte de caractère exceptionnel » que le même André Tardieu appelait de ses vœux et qui se concrétiserait, bien des années plus tard, par le coup d’État de mai 1958, notre Cinquième République n’en finit pas d’assurer l’abaissement de nos consciences et ce, en dépit des quelques modifications de détail qui peuvent être apportées à la Constitution qui l’organise et dont il faut bien reconnaître qu’une grande majorité d’entre nous ne connaît aucun des tenants et aboutissants, lesquels sont pourtant essentiels à la compréhension de ce qui fonde l’état de soumission politique du peuple français aux grands intérêts économiques et financiers.
C’est justement en cela que le travail de recherche fourni par Michel J. Cuny doit nous permettre de mieux saisir en quoi la Constitution de 1958 constitue ce que l’auteur n’hésite pas à qualifier de « chef-d’œuvre absolu » de la grande bourgeoisie française…
Christine Cuny
Pour en finir avec la Cinquième République de Michel J. Cuny est un ouvrage électronique de 500 pages, publié par les Éditions Paroles Vives.
